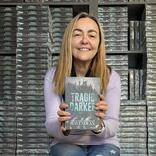Livres Hebdo : Pour vous Brive, c'est quoi ?
Philippe Claudel : J'accepte très rarement ce genre de propositions de présider un festival ou un salon parce que je manque de temps, j'ai trop de choses à faire, trop d'activités. Mais Brive a une saveur particulière. D'un point de vue historique, la foire fait partie des premières manifestations littéraires et a réussi à évoluer au fil du temps délaissant le format classique, où on avait juste des auteurs derrière des livres, pour proposer autre chose, transformer ces moments en véritables rencontres. À Brive, on discute autour de livres actuels, on parle de la rentrée littéraire mais aussi plus largement quand même des auteurs, des artistes, des idées, parce que la Foire du livre de Brive ne se cantonne pas à la simple littérature.
Philippe Claudel, photographié le 18 octobre 2025 à Paris- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Que préparez-vous pour cette édition ?
J'organise une rencontre « Paris / Province », autour des fractures territoriales avec Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée national, Franck Bouysse, écrivain, Daniel Bourrion, bibliothécaire, et Francis Brochet, journaliste. Cela me semblait important car nous vivons dans un pays hypercentralisé. Par exemple, Francis Brochet recense dans son livre, Quand le parisianisme écrase la France (éditions de l'Aube), comment une grande partie des budgets, notamment culturels, sont captés par la capitale au détriment des régions. Pourtant beaucoup d'écrivains vivent en région ! Moi-même, mon port d'attache est la Lorraine. J'y suis vraiment très fidèle et ça m'est indispensable. D'ailleurs, vous savez, une des questions qu'on m'a beaucoup posées quand j'ai commencé à avoir du succès était : « alors vous êtes encore en Lorraine ? » Comme si à partir du moment où on a du succès, on devait migrer vers la capitale.
Autre grand axe de votre programmation, la question carcérale, avec une table ronde dimanche au palais de justice de Brive…
La prison m'a toujours accompagnée. La première fois que j'entre dans une prison, c'est en 1985, pour un stage en tant que jeune professeur. J'y vais car je souhaite voir ce qui s'y passe sur le plan éducatif. Et ce que je découvre, c'est qu'il ne s'y passe rien. Dans la prison où je me rends, à Nancy, il y a bien un instituteur qui fait un petit peu de cours d'alphabétisation mais ce n'est pas suffisant. Je propose donc mes services et commence à donner des cours en 88. C'est véritablement à partir de cette année-là que se mettent en place dans les prisons des activités scolaires. J'ai fait ça pendant douze ans à raison de six à huit heures par semaine. J'ai arrêté en 2000 mais j'ai continué d'aller en prison. J'y suis souvent invité pour parler de mes bouquins et depuis quatre ans, nous avons monté le Goncourt des détenus.
Cette question carcérale vous a-t-elle construit en tant qu'auteur ?
Bien sûr. Il y a eu Le bruit des trousseaux, un livre que j'ai publié chez Stock en 2002, qui m'a permis de raconter mon expérience. De façon plus large, aller en prison m'a permis de comprendre l'espèce humaine. Le fait d'avoir connu ce monde jeune - la première fois que j'y entre, j'ai 23 ans - m'a fait découvrir ce monde dans un moment de ma vie où j'ai encore la connerie de la jeunesse. C'est-à-dire que j'avais la prétention de savoir comment le monde tourne. Et là, j'entre dans un centre de détention et je découvre ce qu'est vraiment l'âme humaine, sa complexité.
« Il faut continuer à parler de Boualem Sansal »
Depuis plusieurs années la culture mais aussi toutes les activités que proposent les prisons sont sur la sellette. En 2022, vous publiez une tribune où vous défendez leur utilité. Pourquoi ?
Quand je travaillais en détention dans les années 1990, je me souviens d'une coiffeuse et d'une esthéticienne qui venaient au quartier femmes pour offrir des soins à des personnes. Cela choquait beaucoup de monde. J'entendais : « Moi je ne peux pas me payer le coiffeur ou l'esthéticienne et puis elles, elles ont ça ». Mais pour moi, la question n'est pas là. Il y a une chose très importante en prison, et encore plus quand on parle de récidive, c'est l'effondrement de l'estime de soi. L'esthéticienne et la coiffeuse, elles sont là pour redonner un petit peu de cette confiance. Parce qu'autrement, très vite, femme ou homme, en quelques semaines de prison, vous sombrez. Un débat comme celui qu'il y aura au palais de justice permet de donner une image juste de ce que peut être la prison et aussi de ce qu'elle devrait être dans une société progressiste comme la nôtre.
Qu'est-ce qu'elle devrait être ?
Elle devrait être plus humaine. Par exemple, le taux de surpopulation est inacceptable. On devrait pouvoir résoudre ce type de problème avec des peines alternatives, qui ont déjà fait leurs preuves, comme les travaux d'intérêt général ou les régimes de semi-liberté. Pour autant, je n'incrimine pas du tout les magistrats. Pour moi, c'est une responsabilité collective. C'est nous-mêmes qui faisons notre prison.
Cette année, vous partagez la présidence avec Boualem Sansal, un écrivain condamné à cinq ans de prison et détenu depuis novembre 2024 en Algérie…
Tout à fait. Nous organisons dans le cadre du cycle « Temps présent » une rencontre qui lui sera consacrée. Cela va faire un an qu'il est emprisonné. Au début, les médias français en parlaient, il ne se passait pas quinze jours sans qu'un journaliste m'appelle pour faire un sujet et puis, l'intérêt s'est essoufflé. Mais moi je trouve qu'il faut continuer d'en parler. Bien entendu, on peut très bien ne pas être d'accord avec ce que Boualem dit ou avec ce qu'il écrit, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'incarcérer une personne pour délit d'opinion. C'est pour ça qu'il faut agir et, surtout, il ne faut pas se taire car il n'y a rien de pire que le silence.
« Je me suis dit : "Zut, ils vivent dans quel monde les écrivains aujourd'hui ?" »
Cette problématique de qui a le droit de parler et d'écrire traverse aussi votre dernier roman, Wanted (Stock).
Wanted s'est écrit très vite. Il part d'une question : comment les États-Unis se sont construits ? Sur la violence, la dépossession, le rapt. On a privé les peuples autochtones de leur terre, on les a tués. On a érigé en héros ceux qui ont une arme et en dieu le dollar. De là m'est venue l'image d'un chasseur de têtes moderne comme… Musk ! De même, cela m'intéressait de voir jusqu'où on peut aller quand on s'affranchit de toutes les règles, comme le fait Trump. Parce qu'en fait les gens ont peur de Trump, que cela soit dans les universités, dans les tribunaux ou dans les journaux. C'est ça le truc. La vraie leçon, elle est là. Et moi, ce qui m'inquiète et ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est qui va être la ou le « Trump français ».
La Foire du livre de Brive est aussi l'occasion de l'une des premières rencontres publiques avec le Goncourt. Comment avez-vous trouvé la sélection cette année ?
Pour être honnête, j'ai été étonné de tout ce que j'ai lu durant cette rentrée littéraire et de ce que peut proposer en 2025 la production littéraire. J'y ai trouvé une avalanche de livres sur la famille, sur l'intime, encore plus que les autres années mais je n'y ai pas trouvé - ou très peu - de livres politiques. Je me suis dit : « Zut, ils vivent dans quel monde les écrivains aujourd'hui ? »
Vous avez l'impression que l'écriture romanesque actuelle est dépolitisée ?
Je sais que les livres sont aussi une science de l'infusion lente, mais j'ai quand même l'impression qu'on manque de textes politiques. Ce n'est pas une question de manque de courage mais plutôt comme si on n'avait plus vraiment foi dans la fiction, comme s'il y avait un repli sur l'intime, car on n'arrive pas à trouver les moyens de parler de tout ça. En tant que lecteur ça me manque et j'espère en trouver bientôt.