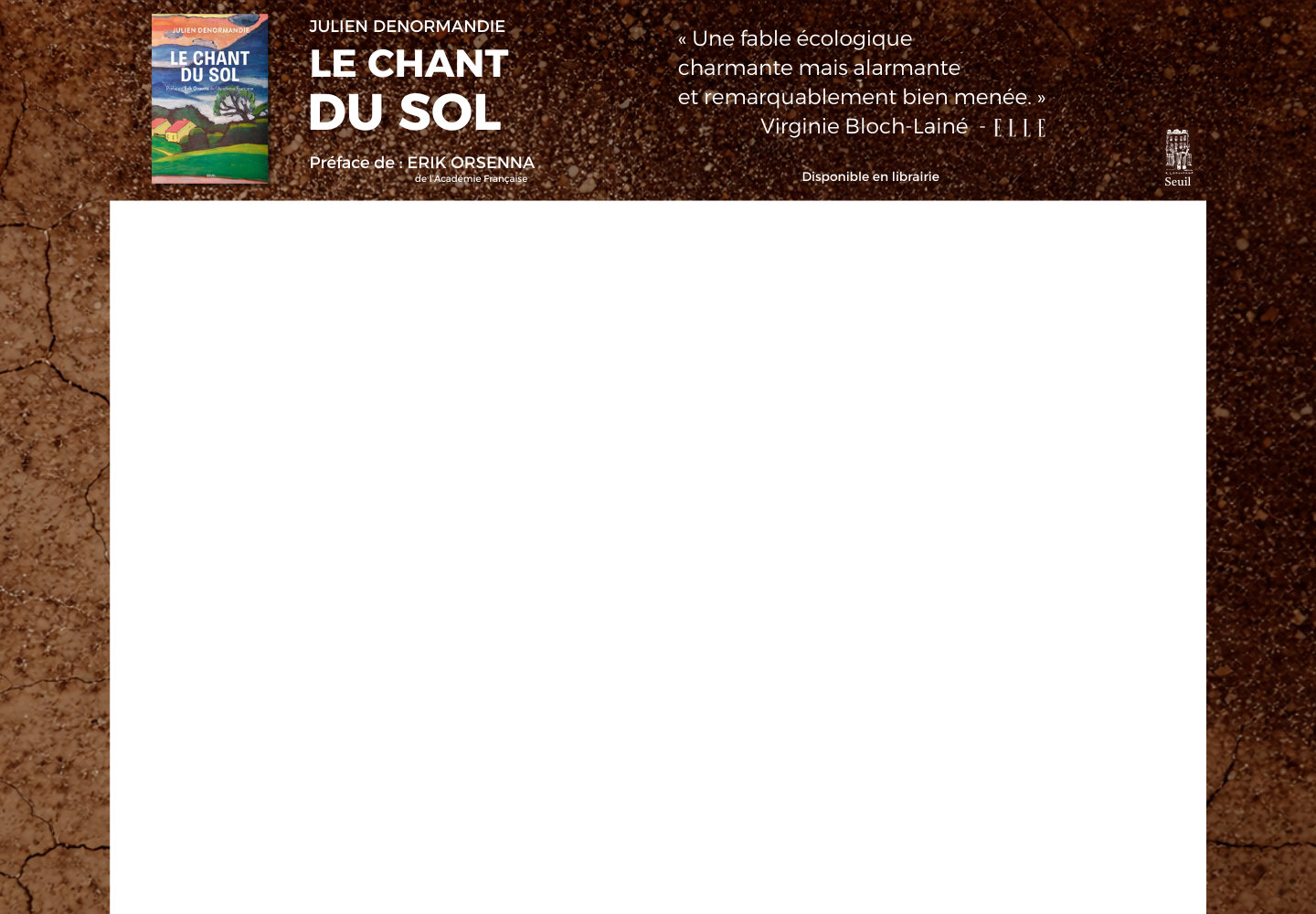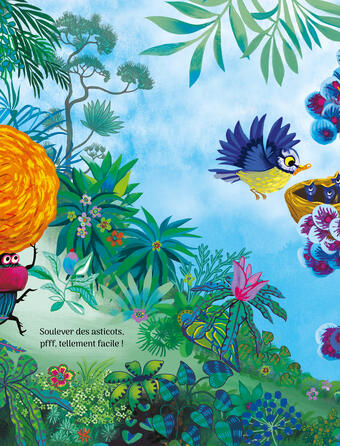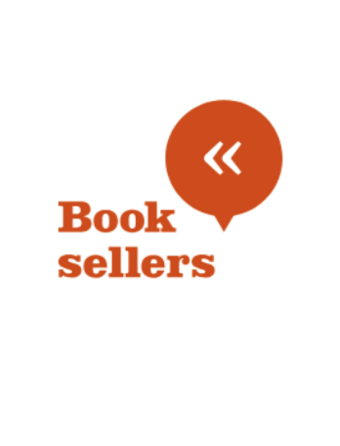Comment est né ce roman sur la genèse des Mille et une nuits ?
Tout a commencé un jour de pluie. Lorsqu'il pleut, je fais du vélo d'intérieur en regardant des documentaires, parce que le travail d'écriture a tendance, sans cela, à me couper du monde. Et là, je tombe par hasard sur la fin d'un reportage sur Arte consacré à ce corpus de textes indéfinissable qu'est Les mille et une nuits. Des textes ajoutés les uns aux autres ou perdus, liés à l'histoire des routes de la soie, mais pas seulement puisqu'il y a aussi peut-être un peu de l'Odyssée dans Sinbad, par exemple. Le reportage parle également d'un certain Antoine Galland, un nom qui évoque des souvenirs lointains dans ma mémoire de professeur de lettres. Le lendemain, je commence mes recherches. Je m'aperçois qu'il avait voyagé très jeune, plusieurs fois, en Orient et au Proche-Orient − qu'on appelait alors le Levant −, qu'il était numismate, qu'il s'était rendu sur des champs de fouilles, qu'il avait vu le Parthénon avant qu'il n'explose, et qu'il était doublement l'inventeur des Mille et une nuits, au sens où il avait découvert les manuscrits, mais les avait aussi, ensuite, transfigurés. À ce moment-là, ça a fait tilt. Parce que, d'une certaine façon, je tenais l'inventeur du roman moderne. Avec lui, il n'est plus question de contes de fées ou d'histoires de chevaliers. Mais surtout, c'est une incroyable histoire éditoriale, puisqu'il a édité les Nuits par « petits paquets », comme il dit, inventant également le principe de la série.
Irène Frain, chez elle à Paris- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Pourquoi ce corpus des Mille et une nuits reste-t-il si passionnant aujourd'hui selon vous ?
Si je me suis lancée dans cette aventure, c'est parce que, face à la dévastation qu'on observe au Proche-Orient − qui atteint des sommets et nous déchire tous −, ce texte représente notre mémoire commune. Il a été transporté sur les routes au début du XVIIIe siècle par Hanna Dyâb, un jeune maronite, un chrétien d'Orient arabophone, de son prénom Youssouf. Notre mémoire la plus ancienne, celle des contes, nous permet de supporter l'angoisse de la nuit. On sait que la matrice des Mille et une nuits est indienne, mais il y a un peu de Chine dedans, de culture musulmane, et probablement grecque ! Tout cela est un creuset indéfini. Telle est aussi la littérature. Un roman, c'est fait de thèmes repris indéfiniment, réinventés. Mon idée sous-jacente, c'est qu'à notre époque, où les hommes ont d'innombrables moyens de se diviser, on a besoin de merveilles pour survivre.
Qu'est-ce qui vous a séduite dans la personnalité d'Antoine Galland ?
J'ai perçu une double personnalité, le savant et le rêveur, et je suis devenue totalement éprise de ce personnage. C'était un choix dans mon histoire, un choix vertigineux puisque le roman est une question de point de vue et de liberté pleine et entière du romancier. Il y a quelques semaines, une fois le livre terminé, j'ai suivi une conférence sur Les mille et une nuits à l'Institut du monde arabe. Là, Emmanuelle Sempère, spécialiste des contes de fées au XVIIIe siècle, brillante, commence par dire qu'il faudrait écrire un roman sur la période où Antoine Galland rencontre Hanna Dyâb, que c'est un personnage extraordinaire, avec une opposition en lui. Je buvais du petit-lait !
Qui est la mystérieuse et fascinante Madame d'O, impliquée dans l'édition des Mille et une nuits ?
Il s'agit de la fille de l'ambassadeur Gabriel de Guilleragues, dont Galland avait été le secrétaire à Constantinople. Saint-Simon parle de Madame d'O et de son époux en termes très dépréciatifs. Ils étaient considérés comme des « gueux ». Ils recevaient des pensions extravagantes. On parle des intrigues du couple d'O, dont l'influence a été manifeste. On sait aussi que Galland a été le professeur de grec moderne de Madame d'O. Cette jeune femme est très romanesque. Dans la version française du conte Les deux sœurs jalouses, l'héroïne Parizade est inspirée de Madame d'O. C'est une femme de goût, certainement très élégante pour avoir été nommée « dame d'atours » de la duchesse de Bourgogne, protégée par Madame de Maintenon grâce à un mariage qui aide Gabriel de Guilleragues, excellent diplomate à Constantinople malgré les circonstances difficiles.
Vous brossez Madame d'O comme une femme à poigne.
Elle monte à cheval, se déguise en homme et n'a peur de rien. C'est une femme qui a retenu les leçons des précieuses, ces féministes avant l'heure qui ont inventé un code − la galanterie − pour que les hommes cessent de leur mettre la main aux fesses, comme nos camarades de #MeToo dans le cinéma. Madame d'O préfigure les intrigantes, plus libertines, avec une élégance et un sens de la manœuvre nécessaires pour survivre à la cour.
Dans votre livre, même le château de Versailles devient surprenant. D'où avez-vous tiré vos informations ?
Tout ce que je raconte sur Versailles est rigoureusement exact, de la chambre de Madame de Maintenon jusqu'aux quarante gardes postés devant sa porte. Cela grâce à Hanna Dyâb. Il a écrit ses mémoires cinquante-cinq ans après avoir voyagé jusqu'en France, et son regard est presque celui d'une caméra GoPro ! Il débarquait de Syrie − la planète Mars comparée à la France −, et il raconte les choses telles qu'il les a vues à la cour durant trois jours, des choses redoutables, qu'il a d'ailleurs euphémisées. Ce qui est surprenant, c'est que les historiens du château soient passés à côté de la traduction du texte d'Hanna, D'Alep à Paris. Les pérégrinations d'un jeune Syrien au temps de Louis XIV, paru en 2015 chez Actes Sud.
Y a-t-il une dimension politique dans Les mille et une nuits ?
Certains contes sont en effet porteurs d'une critique de l'oppression politique, d'autres, comme « Le dormeur éveillé », d'une contestation de l'intégrisme. D'autres encore sont des hymnes au plaisir... Ce qui m'a plu aussi, c'est le goût du livre, et du café. Les contes étaient lus dans les cafés, de la Serbie jusqu'au Caire en passant par la Turquie. On les répétait pour qu'ils ne se perdent pas, mais chaque conteur pouvait ajouter quelque chose. Ces contes sont une métaphore de la littérature et de la liberté. C'est une culture de la route et de l'échange, audible par tous. On peut tous se retrouver dans cette mémoire commune − et aux plus grands diviseurs communs, on peut opposer ce plus grand rassembleur.
L'or de la nuit
Julliard
Tirage: 20 000 ex.
Prix: 22 € ; 256 p.
ISBN: 9782260056652