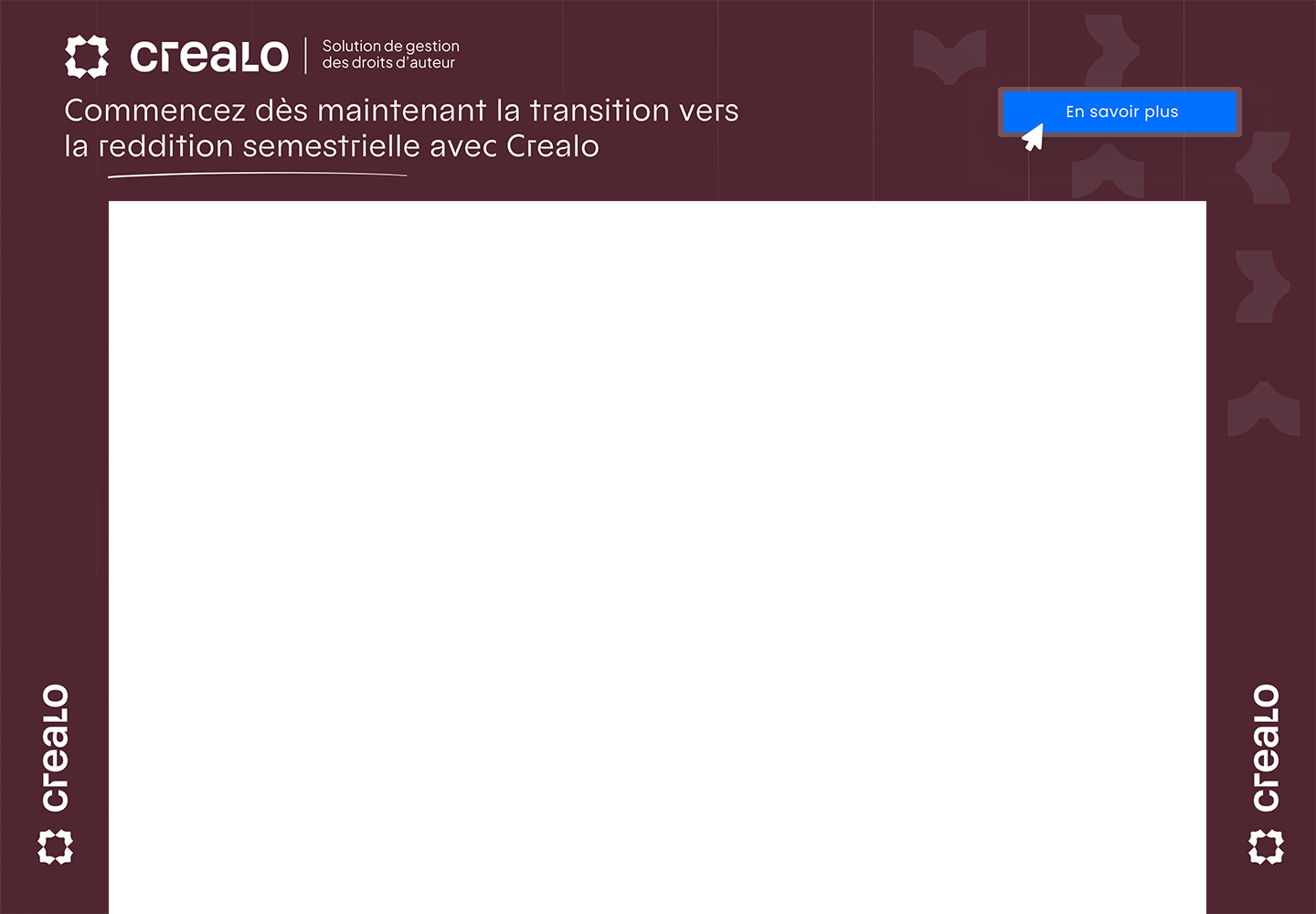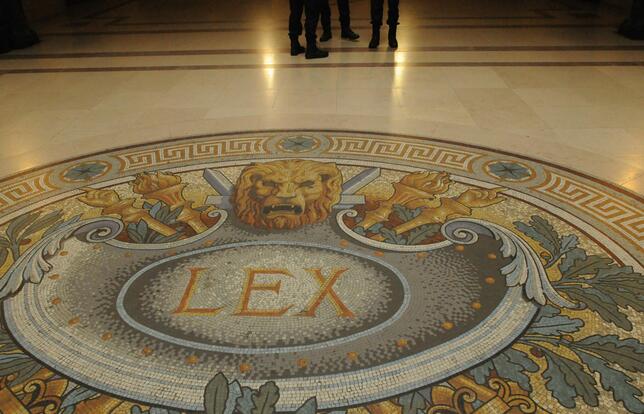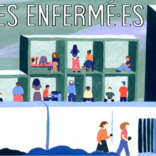L’initiative est née au sein du Conseil de justice économique de la cour d’appel de Paris, avec le soutien de la Direction générale des Entreprises, de la Chancellerie et de la mission stratégique sur l’IA et la justice. Six outils d’IA juridique du marché ont été sélectionnés et confiés à quatre magistrats issus de différents pôles (social, urgences civiles, famille, numérique) pour une évaluation sur des dossiers du quotidien. Cette démarche participative a permis d’associer les utilisateurs finaux dès la phase amont, une première dans l’histoire judiciaire française.
Apports concrets des outils d’IA
Recherche juridique accélérée
Les magistrats ont constaté un bouleversement dans la recherche documentaire. L’IA permet d’obtenir rapidement des réponses hiérarchisées et sourcées à partir de questions en langage naturel, là où la recherche manuelle était fastidieuse et morcelée. Ce gain de temps est jugé « extraordinaire », notamment pour aborder des matières peu familières.
Analyse et traitement automatisé des documents
Les outils testés ont permis d’analyser des pièces de procédure, d’identifier automatiquement les références juridiques et de résumer des conclusions d’avocats. Les éléments pertinents sont détectés et mis en surbrillance, facilitant l’accès direct aux sources. Cette fonctionnalité, bien que variable selon les contentieux, allège la charge cognitive des magistrats.
Synthèse et aide à la rédaction
Certains outils proposent la rédaction de synthèses et même de projets de motivation à partir du sens de la décision fourni par le juge. Ces fonctionnalités sont particulièrement utiles pour dépasser la « page blanche » lors de la rédaction, tout en nécessitant une relecture et une adaptation humaine, surtout dans les dossiers complexes.
Limites et vigilance requise
Exactitude et « hallucinations »
Malgré les gains d’efficacité, l’exactitude des réponses générées par l’IA n’est pas toujours garantie. Certains outils confondent des articles de loi ou produisent des références erronées (« hallucinations »), nécessitant une vigilance accrue de la part des utilisateurs.
Nécessité de formation
L’utilisation optimale de ces outils suppose une formation à la logique probabiliste de l’IA et à la formulation des requêtes, afin de limiter les erreurs et d’exploiter pleinement le potentiel des solutions testées.
Enjeux éthiques, réglementaires et techniques
Protection des données et souveraineté
L’expérimentation a mis en lumière l’impossibilité, à ce stade, d’alimenter des IA privées avec des dossiers réels sans garanties de confidentialité. La question de la souveraineté technologique et du développement d’outils internes, hébergés sur des serveurs sécurisés, est posée en des termes nouveaux.
Dépendance technologique et cadre éthique
La facilité d’utilisation de l’IA peut entraîner une forme de dépendance et une perte de maîtrise humaine. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle du 13 juin 2024 classe d’ailleurs les outils d’IA générative pour la justice parmi les systèmes « à haut risque », soumis à un contrôle strict et à l’exigence d’un contrôle humain systématique.
Sobriété énergétique
L’entraînement et l’utilisation des grands modèles de langage soulèvent également des questions de consommation énergétique, devant être intégrées à l’évaluation des outils.
Perspectives et transformation du métier de magistrat
L’IA ne remplacera pas les juges, mais transformera en profondeur leurs pratiques et l’organisation du travail judiciaire. Elle impose une reconsidération des rôles, des formations et des relations avec les autres acteurs du procès. Les magistrats insistent sur la nécessité d’un encadrement éthique et réglementaire fort, d’investissements publics et d’un accompagnement adapté pour garantir l’accès à des outils sécurisés et performants.
Cette première expérimentation d’outils d’IA à la cour d’appel de Paris marque une étape structurante dans la modernisation de la justice. Elle révèle à la fois le potentiel considérable de l’IA pour améliorer l’efficacité et la qualité du service judiciaire, et la nécessité d’un encadrement rigoureux pour préserver l’indépendance, la sécurité et l’éthique de la justice. À terme, l’intégration raisonnée de l’IA pourrait permettre de concilier efficacité, responsabilité et confiance dans l’institution judiciaire, à condition de maintenir l’humain au cœur du processus décisionnel.
Alexandre Duval-Stalla

Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.