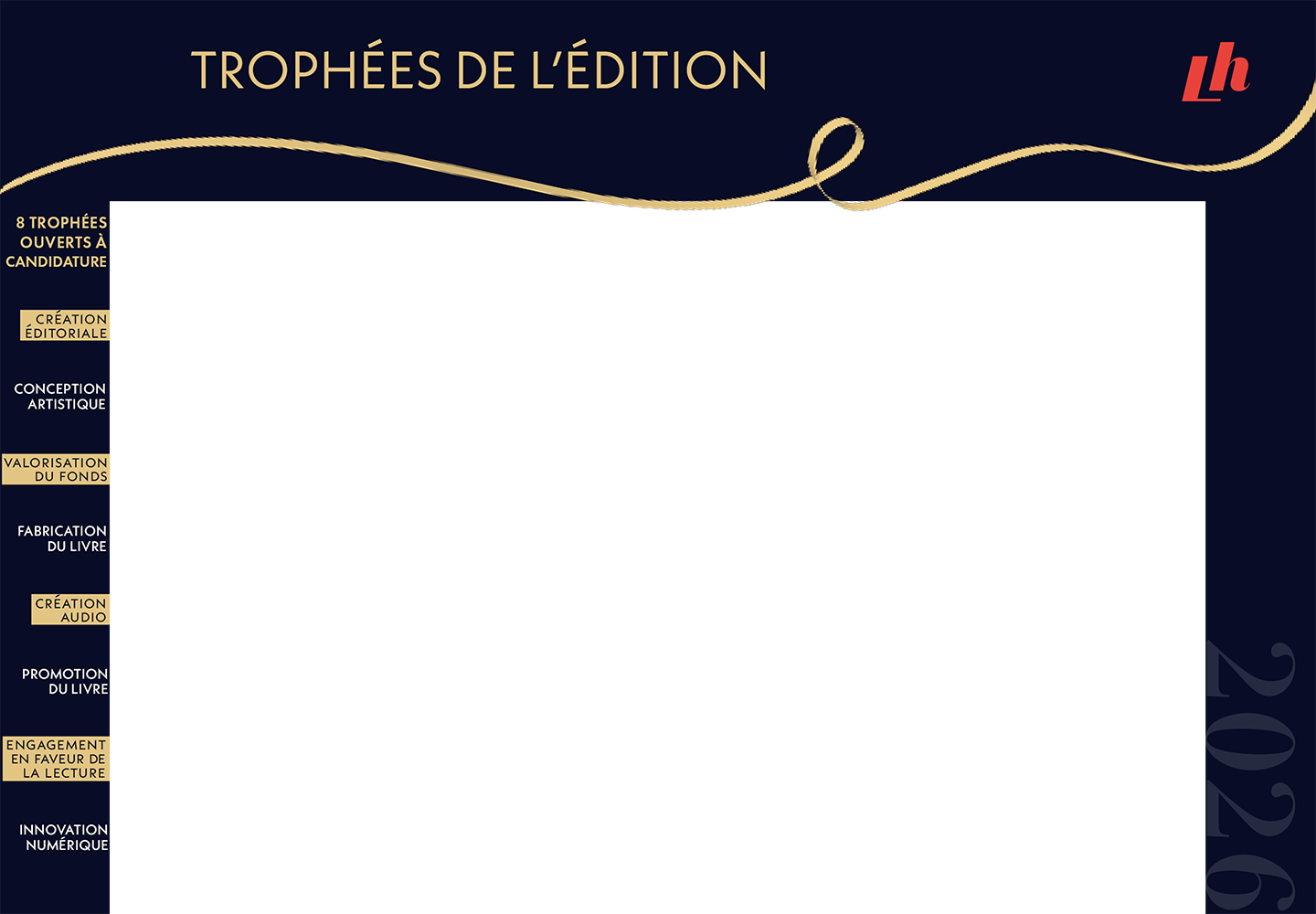À l'abordage ! Tout Marseillais connaît l'histoire de la sardine - en réalité la frégate Sartine - qui a bouché le Vieux-Port en 1780. Il connaît moins celle de la cigogne - du nom de la nef Ciconia - qui fut la cause du siège du même port par une armada envoyée par Barcelone et le roi Alphonse d'Aragon en 1431. La Ciconia était un navire corsaire qui pratiquait la prédation maritime en Méditerranée, notamment envers les bateaux catalans et génois. C'est l'une des saisissantes onze histoires racontées par Laure-Hélène Gouffran dans Corsaires à Marseille. À l'époque, on ne faisait pas la différence entre corsaire et pirate. C'est pour cela que l'historienne, chargée de recherche au CNRS, utilise parfois le terme de « corsopirate ». En puisant dans les registres notariés, elle fait surgir de l'oubli onze personnalités, bien moins documentées que celles de Surcouf ou Drake. Elle fait néanmoins de son mieux pour nous dire ce qu'elle sait de ces aventuriers des mers. Certains, comme le patricien marseillais Bérenger Montane, ne quittèrent jamais le plancher des vaches et se contentèrent d'armer des navires en récoltant les butins. À l'inverse, Georges Ponci s'attaqua aux galères sarrasines et finit dans les geôles barbaresques, à tel point que « de sa vie à terre, nous ne connaissons presque rien ». Ce n'est pas le cas du Génois Baldassare Spinola qui fit de -Brégançon un tel repaire de pirates que les Marseillais signèrent un traité avec lui pour qu'il ne pénètre pas dans leur port. L'homme d'affaires Estève de Brandis, lui, se fit condottiere et forban pour les papes après la Grande Peste. Quant à Diego Gonzálvez de Valderrama, détesté des Génois et des Florentins, à la tête de trois petits navires rapides à voiles latines, il finit à 45 ans, après un dernier accrochage, jeté par-dessus bord et lesté d'une grosse pierre. Il y a aussi une femme, Catherine Bompare qui, après la mort de son mari, finança la piraterie, lutta contre les Maures et s'empara de chargements de corail dont elle fit fabriquer des chapelets. Les portraits de ces corsaires chrétiens entre 1380 et 1440 sont une belle invitation à repenser la course et la piraterie en cette fin de Moyen Âge. Il ne manque à ces filous magnifiques qu'un visage, un tempérament, une vie en somme, réduite ici à quelques fragments. Mais Laure-Hélène Gouffran parvient à tirer de ces documents arides des récits qui donnent chair à ces flibustiers oubliés. Elle révèle surtout l'importance du rôle de la piraterie dans les sociétés médiévales chrétiennes et islamiques - d'un côté, la couronne d'Aragon dans ses multiples composantes à Barcelone, à Majorque, à Valence, en Sardaigne, en Corse et en Sicile avec son adversaire génois ; de l'autre, les Hafsides de Tunis, les Abdalwadides de Tlemcen, les Mérinides de Fès et les Nasrides de Grenade. Marseille, avec sa carte détaillée du port en 1374 et sa chaîne qui en marque l'entrée, est le point commun de ces brigands des mers. Le port provençal apparaît lui aussi comme un personnage central de ces aventures qui devraient passionner bien au-delà de la cité phocéenne.
Corsaires à Marseille. Onze portraits d'aventuriers des mers à la fin du Moyen Âge
Anacharsis
Tirage: 2 000 ex.
Prix: 22 € ; 224 p.
ISBN: 9791027905003