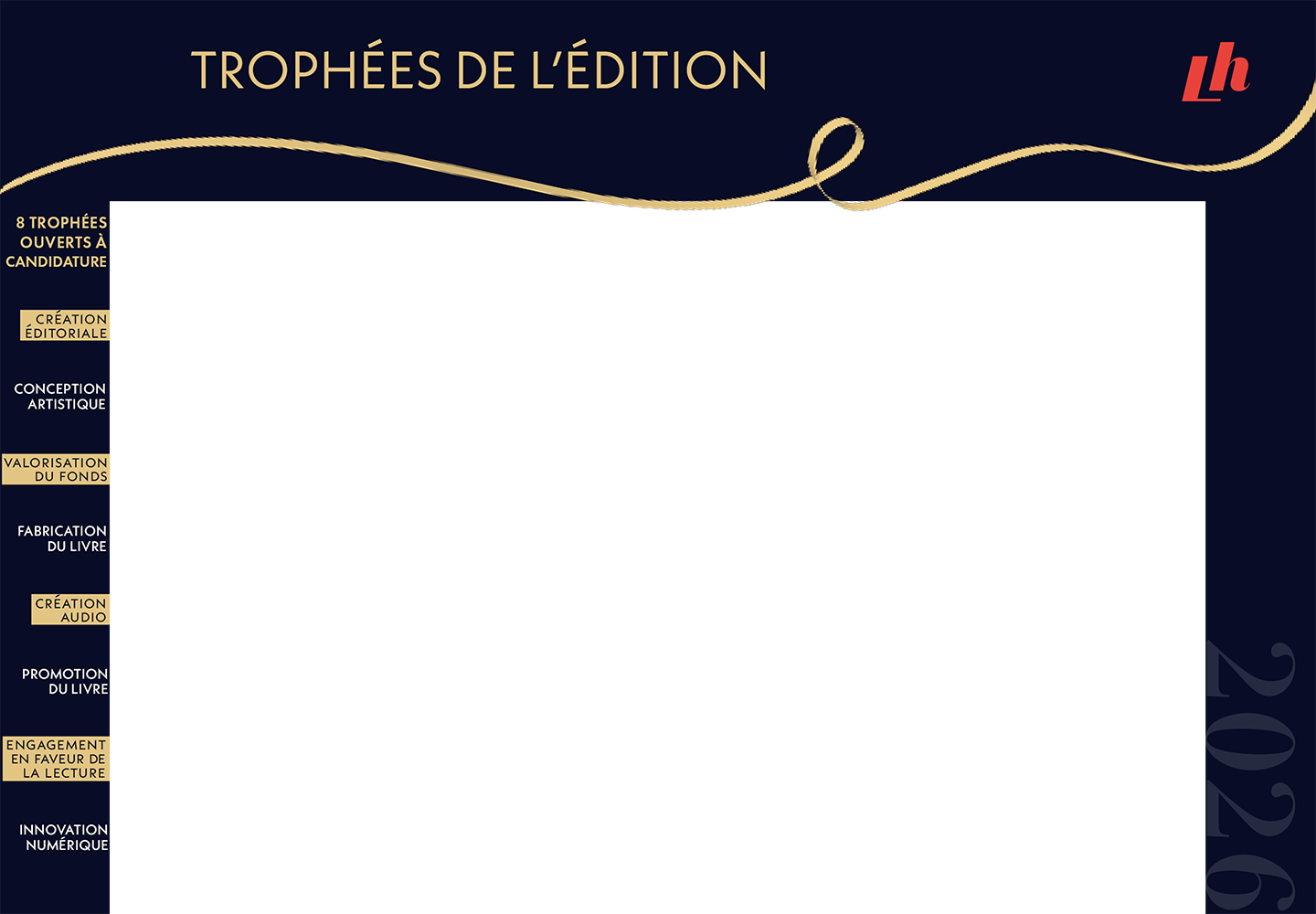L'asymptote d'Aristote. Selon Descartes, « pour règle générale, [...] toutes les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies ». Même si je doute de tout, je sais au moins que c'est moi qui doute. C'est par des idées claires et distinctes qu'on peut prétendre atteindre la vérité, laquelle vérité est figurée dans le langage par des images éblouissantes. La vérité, on veut la faire éclater. Pour signifier la révéler, on dit « faire la lumière ». On parle encore de « soleil de la vérité ». Métaphore qui renvoie au mythe platonicien de la caverne, des ténèbres de laquelle on se libère grâce à la philosophie. Contempler le ciel des idées, c'est voir l'adéquation entre les choses et leur raison d'être, le lien intime entre l'être et la raison. Mais la vérité n'est-elle pas aussi dans le flou, voire l'invisible ? Philosopher, n'est-ce pas l'effort même de distinguer des formes dans les brumes existentielles qui constituent nos vies ? Dans Qu'est-ce que la philosophie ?, Jean-Baptiste Brenet, spécialiste de la philosophie arabe médiévale, pose avec Aristote et à travers quelques passeurs arabes ou persans de la pensée du Stagirite (Averroès, Avicenne) cette question aussi simple que fondamentale.
Contrairement à celui qui fut son maître, le disciple de Platon a élaboré une philosophie qui ne tourne pas le dos au réel. Nous sommes du monde, et ce que tout mortel poursuit sur terre, c'est le bonheur. Aussi Aristote pense-t-il le telos, le sens, des choses dans le monde. La dynamique entre la puissance (le potentiel) et l'acte (la chose accomplie, réalisée) est au cœur de sa pensée. La vue est considérée par Aristote comme le plus élevé des cinq sens : elle nous permet d'accéder de manière plus directe au savoir - voir, c'est déjà saisir l'objet de sa réflexion. Plus directe, mais pas directement. La vue passe par un medium : la lumière, le transparent, « le diaphane » - « un intermédiaire commun dans l'air ou dans l'eau qui sert à convoyer et à manifester des formes ». La lumière n'est pas chez Aristote la vérité, elle est un état, un habitus. L'obscurité qui en est la privation n'est pas l'ignorance, elle est ce grâce à quoi on tend dans un mouvement asymptote vers ce qui devrait être. « Philosopher consiste à penser des privations. » C'est là qu'Aristote devient politique : la philosophie n'est « plus seulement une vision de l'habituel, de l'actuel, de l'effectif, de "l'ayance" », c'est aussi voir « l'envers du décor », une pensée du manque. « Il nous incombe » alors, en déduit l'auteur de Que veut dire penser ? Arabes et Latins (qui ressort en poche chez Rivages), « de contester le manque et ses figures : le vol, la faim, l'écart, l'inégalité, l'extorsion ». Bellement originale que cette lecture d'Aristote que nous livre Jean-Baptiste Brenet dans une langue à la fois limpide et vibrante.
Qu'est-ce que la philosophie ?
Rivages
Tirage: 2 500 ex.
Prix: 13 € ; 96 p.
ISBN: 9782743668402