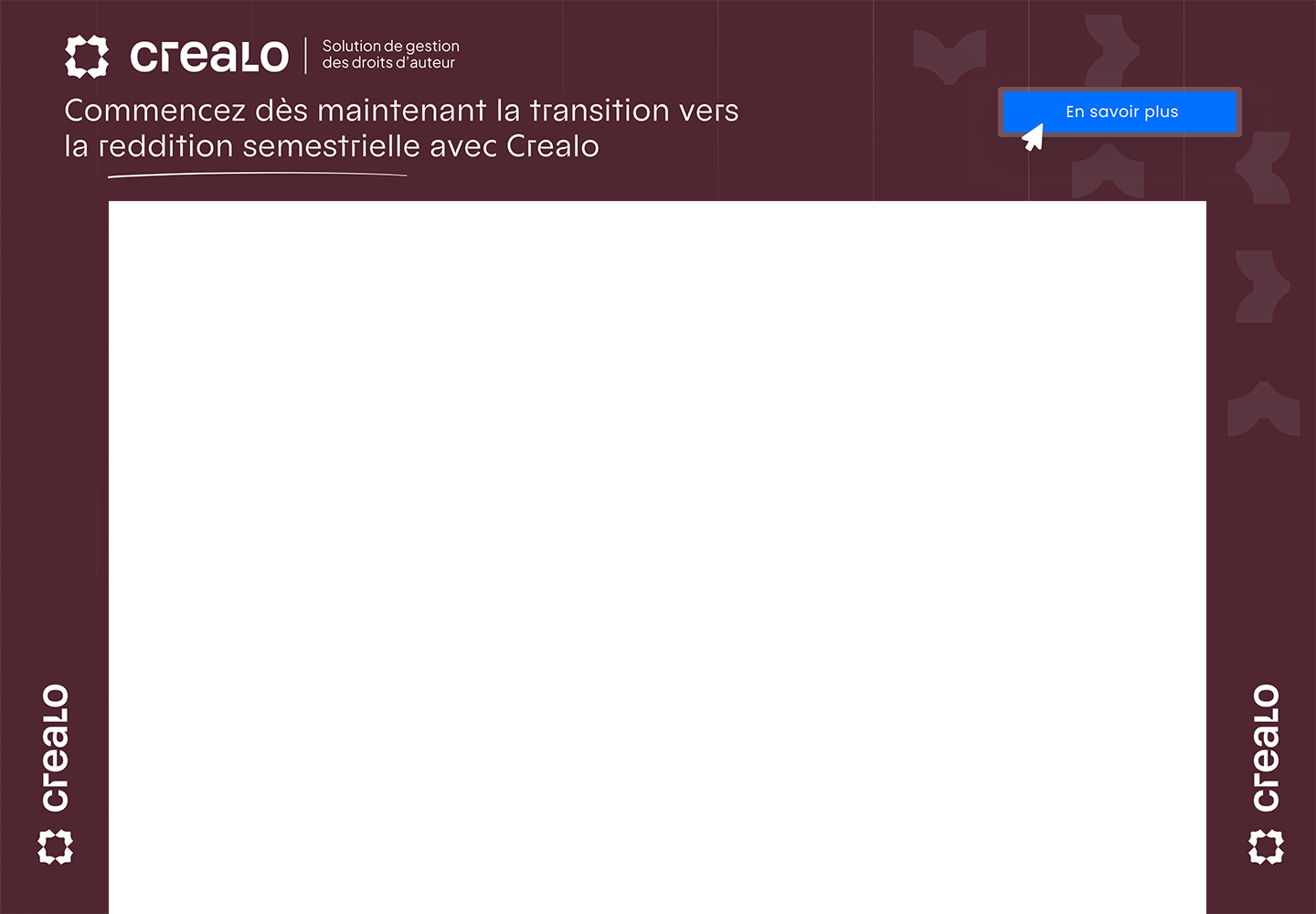Lire aussi : Transition bibliographique : les bibliothèques dans une nouvelle ère
Livres Hebdo : À la fin de l’année, s’achève le programme “Transition bibliographique”. Comment se concrétisera-t-il ?
Laure Jestaz : L’un des buts du modèle est de favoriser les liens entre les différentes publications ou ressources documentaires d’un catalogue. Une œuvre de Goethe déclinée en roman mais aussi en opéra et doté d’un livret et d’une partition musicale, par exemple.
Ce nouveau modèle de données doit aussi permettre de mieux exposer ces données sur la toile. En d’autres termes, il va permettre d’ouvrir plus largement les données des catalogues sur internet. Les utilisateurs vont pouvoir rebondir plus facilement de l’un à l’autre. Cette mise en relation existe aujourd’hui, mais le modèle va les démultiplier.
Étienne Cavalié : Actuellement, un document, dans un catalogue, correspond à un produit éditorial. Or, ce n’est pas l’ISBN qui va intéresser le lecteur ! C’est l'œuvre en elle-même, son univers thématique. Mieux structurer nos métadonnées serait aussi utile pour favoriser la présence de contenus en français dans les moteurs de recherche.
L.J. : Un bénéfice corollaire, c’est que ce mouvement incite à avoir des données plus qualitatives, plus fines. Il a contribué à porter un intérêt plus marqué sur les identifiants — un code unique attribué à un objet (une ressource documentaire, une personne, un lieu, une chose), qui circule de système en système sur la toile et permet que cet objet soit reconnu de manière certaine. Cette univocité aide à la circulation des données, et à leur reconnaissance, quel que soit son univers numérique.
Claire Toussaint : Des données propres et structurées sont plus compréhensibles, plus interrogeables. Les professionnels n’avaient pas l’habitude de manipuler la notion d’identifiant, nous l’avons intégrée à nos formations. Elle est également importante pour la science ouverte par exemple.
E.C. : Jusque-là, les œuvres n’avaient pas forcément d’identifiant dans les catalogues de bibliothèques. L’enjeu de l’identifiant, c’est de s’assurer que l’on décrit tous la même chose. De relier par exemple la notice d’une œuvre et sa page Wikipédia.
L.J. : Ce sont des agences internationales qui attribuent des identifiants (ISBN, ISAN, ORCID, etc.). Ce qui est important pour les bibliothèques, c’est d'aligner leurs identifiants internes avec les identifiants internationaux, se mettre d’accord sur les règles communes d’identification et s’engager à les maintenir aussi longtemps que possible. Ces règles, c’est le code RDA-FR, qui définit les normes de catalogage pour décrire une personne, un lieu…
À ce stade, avez-vous déjà pu tester le potentiel de visibilité sur le web des collections des bibliothèques, que la transition bibliographique doit accroître ?
E.C. : Pour la BNF, sur la plateforme Data BNF, avec les données actuelles du catalogue. On ne pourra pleinement tester le modèle grandeur nature quand on aura totalement refondu les données selon le code RDA-FR. Quand on aura une masse d’informations à proposer.
L.J. : Data BNF forme déjà des grappes par œuvre, et en dessous de telle œuvre, la décline selon les supports (en opéra, en roman…).
C.T. : Les recherches seront ainsi plus structurées.
Avez-vous pris appui sur d’autres pays européens ?
E.C. : Le code RDA-FR est une transposition française du code RDA (Resource Description and Access), code de catalogage anglo-saxon à vocation internationale paru en 2010 et révisé en 2019. Il s’inscrit dans le format Unimarc, le format d’encodage informatique des catalogues. Le comité français a fait remonter les demandes d’évolutions d’Unimarc auprès de l’instance de l’IFLA [Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques] qui maintient le format depuis son origine, le Permanent Unimarc Committee (PUC).
L.J. : Le PUC examine les propositions d’évolution chaque année et les valide. Libre à chaque pays utilisateur du format de les appliquer selon le modèle de catalogage qu’il utilise. La Russie, la Grèce, la Slovénie, l’Italie… sont par exemple membres du PUC et sont intéressés par les évolutions que la France a proposées.
Qu’attendez-vous des bibliothèques ?
L.J. : Elles sont invitées à s’emparer des outils qui ont été élaborés pendant les onze dernières années, ce qui passera sans doute par une phase de réinformatisation. Cela va prendre du temps, chaque bibliothèque ayant son propre calendrier pour le renouvellement de son système. Elles récupèrent d’ores et déjà des notices du réseau Sudoc et de la BnF, elles suivent les évolutions en cours et les exploiteront selon un calendrier qui leur est propre.
C.T. : On retombe sur l’importance des identifiants pour récupérer des notices faites par l’agence bibliographique de l’enseignement supérieur ou la BNF !
E.C. : Chaque établissement va mener sa propre transition bibliographique, sa propre manière de décliner nos outils en différentes options. Deux établissements peuvent choisir des formats de catalogage différents, mais ils reposeront tous deux sur un modèle identique, IFLA LRM.