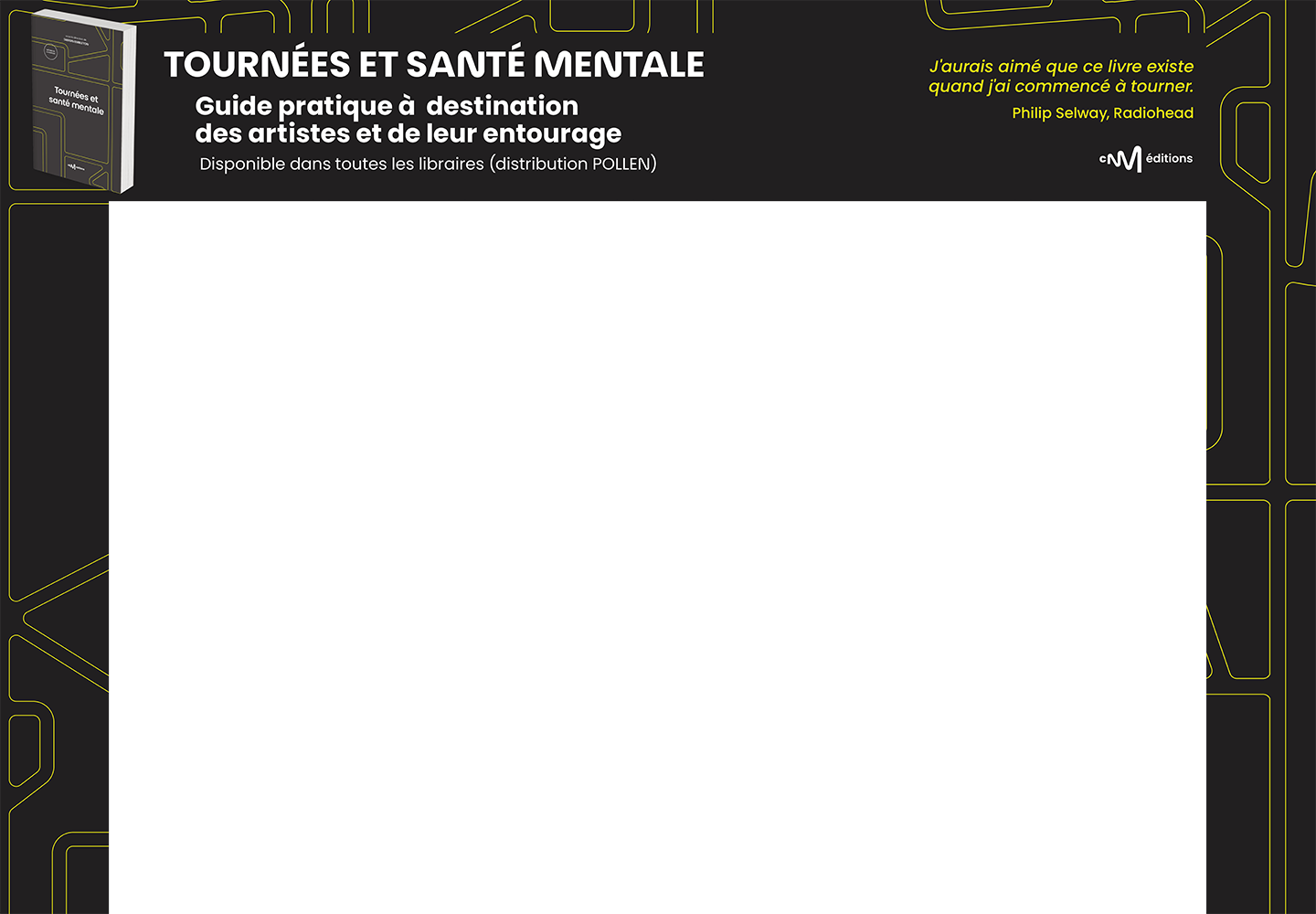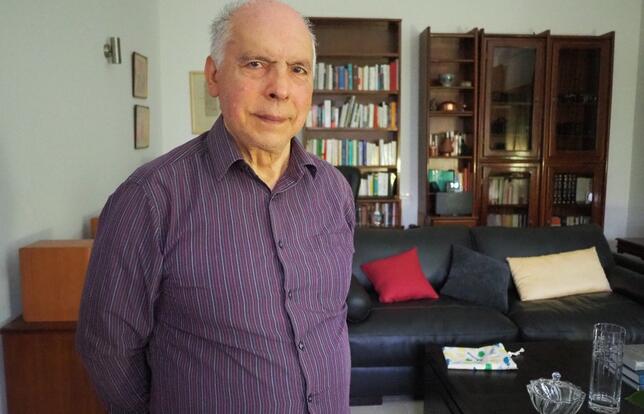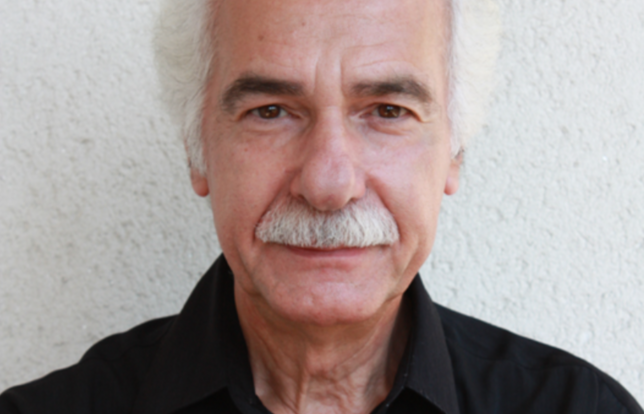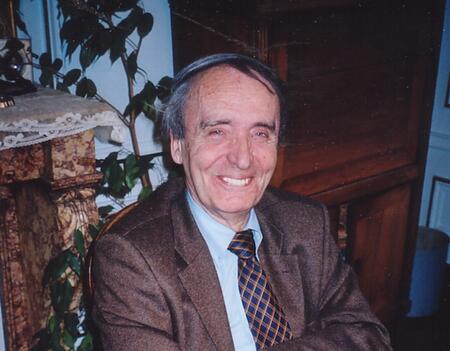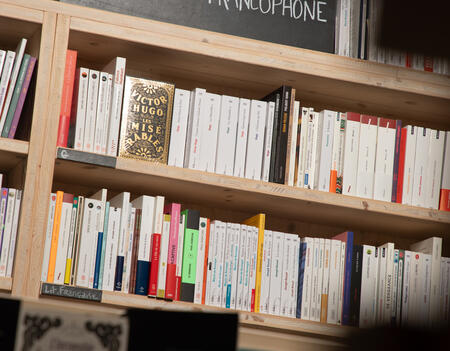Ne choisir « que » dix auteurs dans une galaxie de plusieurs décennies de profondeur et de plusieurs langues d'amplitude est un exercice qui n'a de sens qu'en assumant une liste non exhaustive, établie au terme de longues hésitations. D'abord, les classiques. Souvent des pionniers dans leur langue, comme Driss Chraïbi, dans leur genre littéraire, comme Mohamed Choukri, ou dans leur spécialité, comme Fatema Mernissi. Leurs noms sont connus de tous, leurs œuvres continuent d'être lues et étudiées. Ce sont nos références spontanées et elles continuent d'inspirer les nouvelles générations.
Ensuite, les penseurs : la production en sciences humaines a donné de grands noms dans des domaines comme l'histoire (Abdou Filali-Ansary, mais aussi Abdallah Laroui, Abdelahad Sebti, Halima Ferhat), la théorie littéraire (Abdelfattah Kilito), l'islamologie (Asma Lamrabet), et bien sûr en philosophie (Mohamed Abed Al-Jabri, Abdeslam Benabdelali, Ali Benmakhlouf), en sociologie (Paul Pascon), en sciences politiques (Mohamed Tozy, Abdelhay Moudden), etc. Ces œuvres ont un rayonnement important, au Maroc comme au-delà.
Enfin, les contemporains. Les noms fusent, plus jeunes (Tarik Bekkari, Abdelmajid Sebbata), plus féminins (Siham Bouhlal, Karima Ahdad). Il y a eu les remarquables témoignages sur les années de plomb (Ahmed Marzouki, Mohamed Serifi-Villar), l'émergence de talents dans les diasporas (Saïd Hajji aux Pays-Bas, Najat El Hachmi en Espagne)... Les principales langues de publication au Maroc étant l'arabe puis, loin derrière, le français, et les genres majeurs le roman et la poésie, j'ai retenu un auteur ou une autrice pour chaque genre et chaque langue.
Pour les curieux qui auraient raison de ne pas se satisfaire de cette liste, il y a l'indispensable Dictionnaire des écrivains marocains de Salim Jay, paru en 2005 chez Eddif et Paris Méditerranée : une mine, dont la réédition actualisée serait bienvenue. Bienvenue.
Quelques classiques
Mohamed Choukri : Un cri contre la misère
Dans les années 1950, Mohamed Choukri (1935-2003) rédige en arabe ce qui deviendra un livre culte de la littérature marocaine : الخبز الحافي (Al-Khobz al-hafi, Le pain nu). Aucun éditeur du pays ne prend le risque de le publier. Il est traduit en 1973 en anglais par Paul Bowles et en français en 1980 par Tahar Ben Jelloun. Publié à compte d'auteur en 1982, le livre est saisi et restera censuré au Maroc jusqu'en 2000. Ce que raconte Mohamed Choukri, c'est le quotidien de la misère. C'est un « plus jamais ça » qui n'a depuis cessé d'être clamé, tant par la société civile que par tout un courant de la littérature, à travers des œuvres comme celles de Mohammed Khaïr-Eddine, Mohammed Zafzaf, Mohamed Leftah, Malika Moustadraf, etc. Il n'est pas anodin que ce soit un ancien prisonnier politique, Abdelaziz Mouride, auteur d'On affame bien les rats (Tarik éditions, 2000), qui ait adapté Le pain nu en bande dessinée (Alifbata, 2019).
Ce livre n'a rien perdu de sa justesse, dans ses descriptions au scalpel de la misère noire, et des violences qu'elle entraîne, mais surtout par la force émancipatrice qu'il porte. Cette autobiographie fait la part belle à l'ambivalence, à l'horreur comme au désir, au sordide. illustré par ce moment où, au fond d'un cachot, un homme lui apprend le poème d'Abou el Kacem Chebbi (« Si un jour le peuple désire la vie / Il faut que le destin réponde / La nuit s'achèvera quoi qu'il arrive et le joug se brisera absolument ») et les rudiments de l'alphabet. Cet élan vers le savoir, donc vers la liberté, est plus que jamais d'actualité.
Driss Chraïbi : Le pionnier de la modernité
« J'ai peur que nous n'ayons jamais d'autre avenir que notre passé », écrivait Driss Chraïbi, (1926-2007) dans Succession ouverte (Denoël, 1962). Son premier roman, Le passé simple (Denoël, 1954) lui a valu une entrée fracassante en littérature, et un scandale car, à deux ans de l'Indépendance, la critique des archaïsmes de la société faisait fausse note. Mais sonnait juste. Pour lui, la littérature aussi devait prendre position : pour le savoir ou pour l'ignorance. Les boucs (Denoël, 1955), La civilisation, ma mère ! (Denoël, 1972)... Tous ses livres révèlent une intuition avant-gardiste des questions de société, de l'émancipation des femmes à la condition des immigrés, des fausses indépendances au décalage entre les valeurs proclamées par l'Occident et leur mise en œuvre. Figure pionnière de la modernité littéraire, Driss Chraïbi a marqué autant les auteurs francophones qu'arabophones des générations suivantes. Sa fraîcheur, son sens de l'humour, son amour profond des gens dont il raconte la vie et les travers ont permis à ses œuvres de traverser le temps. Driss Chraïbi n'avait pas seulement le style implacable, mais aussi une immense sensibilité, dont témoignent la richesse avec laquelle il dépeint la société ainsi que la profondeur de ses fresques La mère du printemps (Seuil, 1982), Naissance à l'aube (Seuil, 1986), d'une grande densité imaginaire et philosophique. Il a laissé des mémoires hilarantes (Vu, lu entendu, Denoël, 1998). On le lit et le relit en savourant son courage, sa générosité et sa recherche inlassable d'une humanité plus juste.
Fatema Mernissi : La liberté pour horizon
« Tu deviendras une dame moderne, instruite. » Le rêve de sa grand-mère qu'elle raconte dans Rêves de femmes (d'abord publié en anglais, Dreams of Trespass : Tales of a Harem Girlhood en 1994, puis en français chez Le Fennec en 1997), Fatema Mernissi (1940-2015) l'a amplement réalisé et l'a rendu accessible à toutes et tous. Sociologue, figure majeure de l'université marocaine, elle a consacré sa vie à déconstruire les ressorts du patriarcat, les hiérarchies naturalisées par les discours hégémoniques, les houdoud, les limites de toutes sortes : orientalisme, colonialité, islamophobie, déterminismes sociaux... Pour la petite fille qui s'évadait du harem de Fès en contemplant le ciel au-dessus de la cour carrée, c'est la peur, véhiculée par les stéréotypes, qu'il faut combattre. Dans Le harem politique - Le Prophète et les femmes (Albin Michel, 1987), Fatema Mernissi plaide pour le rétablissement d'une « mémoire-liberté », contre une tradition défigurée par des lectures misogynes. Sultanes oubliées, femmes chefs d'État en islam (Le Fennec/Albin Michel, 1990) fait l'inventaire des femmes de pouvoir que l'historiographie ne saurait voir. Les Aït-Débrouille (Le Fennec, 1997) rend hommage à la vitalité de la société civile rurale. Avec son style vif et enlevé, son art du récit, son humour et sa curiosité insatiable, Fatema Mernissi a laissé une œuvre généreuse, loin de la sécheresse de nombreux écrits académiques. Fine connaisseuse de la littérature arabe classique et du soufisme, elle a construit une œuvre humaniste riche et profondément émancipatrice.
Quelques penseurs
Abdou Filali Ansary : Séparer le religieux et le politique
Abdou Filaly Ansary- Photo DRPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Pour Abdou Filali Ansary, toutes les religions sont soumises à des approches critiques - il ne s'agit pas ici de croyance, mais de débat public. Pour le philosophe, né en 1946 à Meknès et spécialiste de Spinoza et de Bergson, la sécularisation est une nécessité. Abdou Filali Ansary a dirigé la Fondation du roi Abdul Aziz Al Saoud puis l'Institut pour l'étude des civilisations musulmanes de l'Université Aga Khan. Il est un des fondateurs de la revue du livre maghrébine Prologues. Il a consacré sa vie de chercheur à combattre l'intégrisme, la sacralisation de l'histoire et les discours d'autorité. Sans oublier ce qu'il appelle « l'orientalisme des Orientaux ».
Sa méthode ? une lecture historique des concepts et une approche pédagogique, orientée vers l'action. Dans L'islam est-il hostile à la laïcité ? (Le Fennec, 1997) puis Réformer l'islam ? une introduction aux débats contemporains (La Découverte, 2003), Abdou Filali Ansary met en avant les penseurs modernes de l'islam - dont Ali Abderraziq, figure majeure du réformisme égyptien, dont il a traduit en français L'Islam et les fondements du pouvoir (La Découverte, 1994). Par souci de clarté, à propos des sociétés musulmanes contemporaines (Le Fennec, 2001) propose des éclaircissements pour sortir d'une double impasse : celle des discours islamistes et celle des commentateurs occidentaux. Il poursuit ce travail de clarification dans Les musulmans face à leur histoire (Le Fennec, 2018). Le savoir et l'histoire contre les dérives idéologiques et haineuses, au service de la démocratie, de la laïcité et des droits humains.
Abdelfattah Kilito : Penser les cadres de l'imaginaire arabe
Écrivain-lecteur, voyageur dans l'immense corpus littéraire du monde, à l'affût des échos et des palimpsestes, Abdelfattah Kilito est un grand théoricien de la littérature tout autant qu'un conteur hors pair. Il écrit autant en arabe qu'en français, pour l'essai comme pour la fiction. Né à Rabat en 1945, il a une connaissance encyclopédique des grands classiques arabes : Les mille et une nuits, le genre des maqâmât (Les Séances, récit et codes culturels chez Hamadhânî et Harîrî, Sindbad, 1983). Ses essais sont d'un apport majeur sur les transformations du champ littéraire arabe. L'auteur et ses doubles. Essai sur la culture arabe classique (Seuil, 1985), interroge le statut de l'auteur. Dans Les Arabes et l'art du récit. Une étrange familiarité (Sindbad, 2009) Abdelfattah Kilito analyse l'adoption de la tripartition européenne de la littérature (roman, théâtre, poésie) et les liens désormais inextricables entre littérature arabe moderne et littérature européenne. La question des langues est une de ses thématiques de prédilection. La langue d'Adam, (Toubkal, 1995) pense un plurilinguisme originel. لن تتكلم لغتي (Lan tatakallama lughatî, Dar Attali'a, 2002, Tu ne parleras pas ma langue chez Sindbad en 2008), évoque la traduction à l'aune de l'angoisse existentielle de l'acculturation comme symptôme d'une position dominée des auteurs arabes. « Je parle toutes les langues, mais en arabe » pense l'altérité et se demande malicieusement « Comment peut-on être monolingue ? » Chez Abdelfattah Kilito, l'érudition n'est jamais écrasante : c'est l'occasion de faire preuve de curiosité et de tendre un miroir lucide à notre époque.
Asma Lamrabet : Libérer l'islam des dogmes archaïques
Asma Lamrabet- Photo DRPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Médecin biologiste, Asma Lamrabet a un esprit d'analyse hors pair. Née en 1961 à Rabat, elle a grandi en exil, puis a vécu plusieurs années en Amérique latine, où elle s'est familiarisée avec la théologie de la libération, qui l'a amenée à approfondir sa réflexion sur l'islam, en particulier sur le statut des femmes. Son œuvre abondante s'organise en deux axes. D'une part, des livres religieux et spirituels, où elle propose des biographies du Prophète (Le prophète de l'islam et les femmes de sa vie, Albouraq, 2020) ou de grandes figures mystiques, comme Rabi'a al'Adawiyya. Mystique et liberté (Albouraq, 2022). De l'autre, des livres de sciences humaines, où elle invite à une lecture critique des textes, comme dans Islam et femmes, les questions qui fâchent et dans Islam et libertés fondamentales, pour une éthique universelle (En toutes lettres, 2017 et 2023).
Asma Lamrabet défend l'idée que les lectures patriarcales et archaïques de l'islam étouffent le message coranique, beaucoup plus imprégné de l'idée de justice, et invite chacun et chacune à faire sa propre lecture, débarrassée de dogmes qui ne correspondent plus aux évolutions sociétales. Elle a défendu avec courage l'ouverture d'un débat sur la réforme de l'héritage, ce qui lui a valu d'être poussée à la démission, en 2018, de la direction du Centre d'études féminines affilié à la Rabita des Oulama du Maroc. Ses livres, qui mobilisent les ressources de l'histoire, de l'anthropologie, de la linguistique ainsi que des travaux sur le décolonial, ont fait d'elle une figure majeure de la pensée réformiste en islam.
Quelques contemporains
Youssef Fadel : Rêver le réel
Youssef Fadel- Photo © DR/AOULAD-SYAD DAOUDPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Le théâtre (et l'engagement politique) lui a valu huit mois de prison ; le cinéma, la reconnaissance et le roman de nombreux prix. Youssef Fadel est né en 1949 à Casablanca et arpente sa ville avec un regard qui sonde, au-delà des apparences, le mystère des vies volées, des destins fracassés et la couleur de l'époque. « Casablanca n'existe pas. La ville qu'on voit aujourd'hui n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qui reste, cette Casa qui était et qui n'est plus », confiait-il. Ses œuvres, empreintes d'une atmosphère de rêverie, ont mis des mots d'une remarquable justesse sur l'arbitraire des années de plomb, le rapport des hommes au pouvoir, sur le chômage, les problèmes d'enseignement. Youssef Fadel est un témoin lucide, convaincu que souvent la réalité dépasse la fiction. Pas dans le sensationnel, mais dans le faisceau d'éléments qui rayonne à partir des personnages et des lieux et contribue à leur mystère. Sa pièce حلاق درب الفقراء (Hallaq derb Al Fuqara', Le coiffeur du quartier des pauvres) a été adaptée au cinéma par Mohamed Reggab en 1982, devenu un classique. Youssef Fadel est l'auteur d'une dizaine de romans en arabe, dont حشيش (Hashish, Le Fennec, 2000, traduit en 2008 à Media-Plus), طائر أزرق نادر يحلق معي (Ta'ir azraq nadir yuhalliqu ma'i, Dar al Adab, 2013, prix Maroc du livre et finaliste du Booker arabe, traduit en Un oiseau bleu et rare vole avec moi, Sindbad, 2017), قط أبيض جميل يسير معي (Qitt abyad jamil yasiru ma'i, Le Fennec, 2011, traduit en Un joli chat blanc marche derrière moi, Le Fennec, 2014) ;حياة الفراشات (Hayat al-farachat, « La vie des papillons », Al Mutawassit, 2020)... Tout un bestiaire pour s'approcher de l'humanité.
Abdellatif Laâbi : Le chant de la justice
Abdellatif Laâbi- Photo © YLPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Une œuvre de combat. En près de soixante ans de poésie, Abdellatif Laâbi n'a jamais cessé de clamer, comme il l'écrit dans J'atteste contre la barbarie (Rue du monde, 2015) :
« J'atteste qu'il n'y a d'Être humain
que Celui qui combat sans relâche la Haine
en lui et autour de lui ».
Né en 1942 à Fès, Abdellatif Laâbi a fondé et dirigé la revue Souffles, qui demeure le mouvement poétique, intellectuel et artistique le plus important du Maroc indépendant, et qui a revendiqué de mettre la culture au cœur d'un projet de société humaniste. Cela lui a valu torture, condamnation par un des pires procès politiques de l'histoire du pays : huit ans de prison, suivi d'un exil. Il en témoigne dans Chroniques de la citadelle d'exil (Inéditions Barbare, 1978) et Le chemin des Ordalies (Denoël, 1982).
Son œuvre, en français, est immense, couronnée par le Goncourt de la poésie 2009. Sur le mode de la rage tellurique de L'œil et la nuit (Atlantes, 1969), ou plus intimiste de ses derniers recueils parus au Castor astral (La poésie est invincible, 2022 ; À deux pas de l'enfer, 2024), Abdellatif Laâbi s'insurge contre les injustices, toutes les formes de domination, l'impérialisme, la guerre, la peine de mort. Poète citoyen, il pense et panse de ses mots les blessures de l'humanité. Poète de l'amour, il n'a cessé de célébrer son inséparable, Jocelyne, elle-même conteuse et romancière. Passeur infatigable des voix libres de la poésie arabe, il a été le premier à traduire Mahmoud Darwich et n'a cessé de traduire les poètes palestiniens. Face aux risques omniprésents de déshumanisation, il continue à rêver « d'un pays qui fait rêver ses propres enfants. »
Leïla Slimani : Le lien, sans la clôture
Leïla Slimani- Photo CATHERINE HÉLIEPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Chanson douce (Gallimard, 2016) lui a valu le Goncourt en 2016. Leïla Slimani est née à Rabat en 1981, a étudié le théâtre et le journalisme avant de se consacrer à l'écriture. En deux romans, une trilogie et quelques essais, elle s'est imposée comme une voix importante de la littérature franco-marocaine en français, situant ses œuvres en France et au Maroc et revendiquant ses deux ancrages. C'est la question du lien qui traverse ses livres. Le lien toxique de l'addiction sexuelle dans Le jardin de l'ogre, son premier roman (Gallimard, 2014). Le lien meurtrier d'une femme aux enfants qu'elle garde, dans Chanson douce, où elle observe avec justesse les rapports de classe. Dans sa trilogie Le pays des autres (La guerre, la guerre, la guerre, 2020, Regardez-nous danser, 2022 et J'emporterai le feu, 2025), Leïla Slimani relève le défi de retracer quatre-vingts ans d'histoire de deux pays devenus inextricables. Là encore, elle questionne les liens aliénants : ceux de la colonialité d'abord, ceux du pouvoir et de la course à l'argent, ceux de la corruption et de la peur. On y retrouve les causes qui lui sont importantes et pour lesquelles elle s'est publiquement exprimée : la liberté des femmes, le droit de vivre sa sexualité comme chacun.e l'entend, l'avortement... Son plus beau texte, Le parfum des fleurs la nuit (Stock, 2021), rédigé pour la collection « Ma nuit au musée », l'amène à s'interroger sur l'enfermement, en l'occurrence volontaire à la Punta della Dogana de Venise, et au-delà, sur les places assignées, les frontières invisibles, et les questions à laisser sans réponse, car ce sont de ces zones d'ombre qu'elle tire les fils de sa liberté.
Abdallah Zrika : La poésie à l'état d'épure
« Et j'écris / pour sortir de la nuit / de moi-même dans le matin / d'un texte / Et je lis / pour sortir de la nuit / d'un texte dans le matin de / moi-même », confie Abdallah Zrika dans Insecte de l'infini, qu'il a traduit avec Bernard Noël (La Différence, 2007) c'est un des plus grands poètes de langue arabe. Il sonde de recueil en recueil l'inquiétant mystère de l'écriture. Il est né à Casablanca en 1953, a connu la dureté du bidonville, puis de la prison - deux ans pour six poèmes. De رقصة الرأس والوردة (Raqa al-ra's wa-l-warda, « Danse de la tête et de la rose ») et Rires de l'arbre à palabres (L'Harmattan, 1982, traduits par Abdellatif Laâbi) à Petites proses (L'Escampette, 1998, traduit par l'auteur), Échelles de la métaphysique (L'Escampette, traduit par Bernard Noël et l'auteur), ou encore سُكْرُ المَحIvresse de l'effacement (Méridiane, 2020), Abdellah Zrika n'a eu de cesse de déployer une poésie dans la liberté des blancs et des silences. Il ne s'embarrasse pas de lyrisme ni de narration, recherche le dépouillement de l'aphorisme et du mot juste. « Que vaut un trait s'il n'est pas comme le fil du rasoir ? », écrivait-il dans Bougies noires (La Différence, 1998, traduit par Abdellatif Laâbi). Cette quête de l'essentiel a une dimension métaphysique, elle passe par l'expérience de la mort, de « l'abattoir » qui doit écorcher le poème au point que « personne ne le reconnaît même le poète ». Mais il en reste l'impression forte d'une œuvre profonde, fascinée par l'étrangeté des choses, intensément sincère.