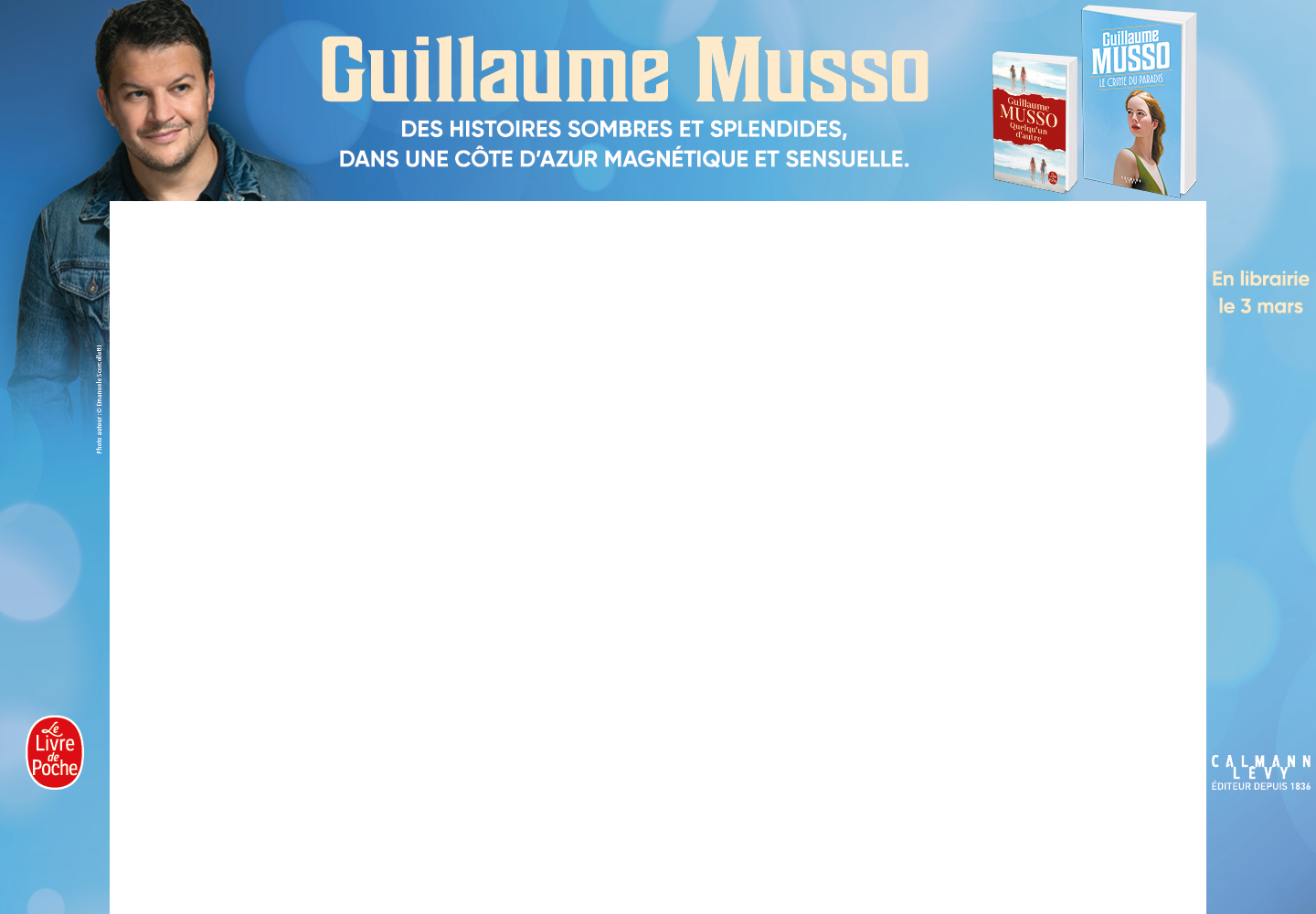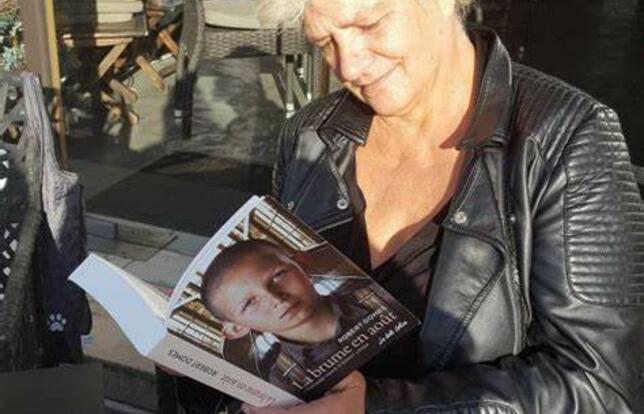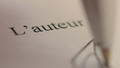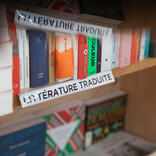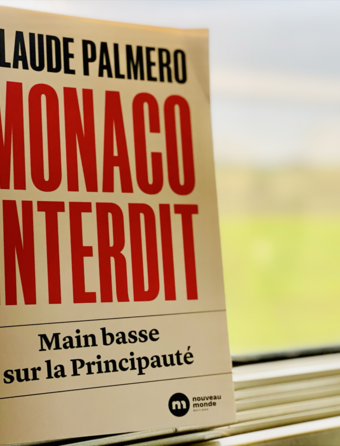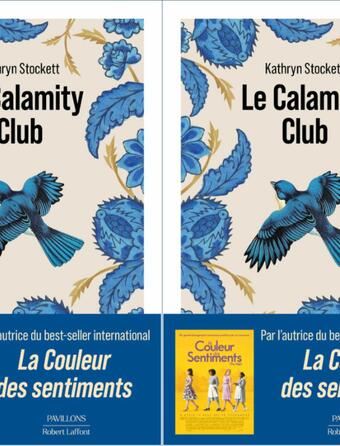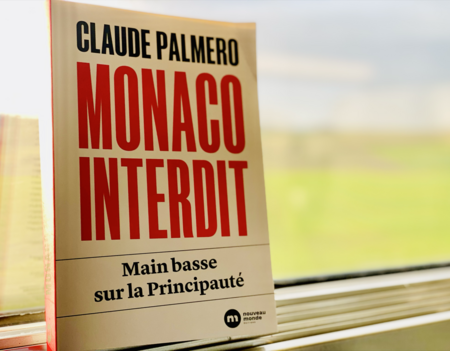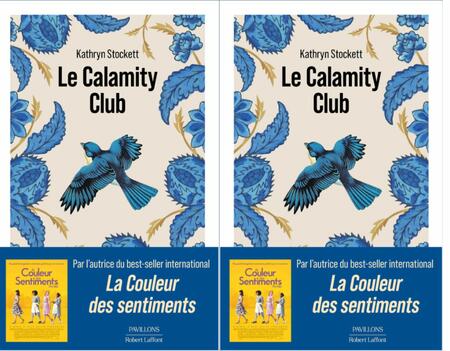« Nous ne sommes pas des chasseurs de fautes, mais les architectes invisibles du sens », lance Wanda Rzewuski, fondatrice de ProLexis, célèbre logiciel d'aide à la correction, et directrice générale de la société Diagonal, qui continue à le développer. Dans les coulisses de la fabrication d'un livre, loin des projecteurs, œuvre une profession aussi discrète qu'elle est vénérable et essentielle : celle des correcteurs d'édition. Réputé précaire, solitaire et mal payé, le métier recouvre de très différentes réalités et est traversé d'enjeux cruciaux, de la précarité au manque de formation, sans oublier le séisme de l'intelligence artificielle.
« Nous exerçons un métier ni structuré, ni réglementé : sans diplôme, sans tarif minimum, ou chacun évolue un peu dans son coin et avec son réseau d'éditeurs... », raconte Édith Noublanche, qui travaille notamment pour La manufacture de livres. Existent seulement quelques associations de correcteurs, et un syndicat, la section des correcteurs du Syndicat général du livre et de la communication écrite CGT, qui compte environ 140 adhérents.
« Il est difficile de connaitre le nombre exact de correcteurs en édition en France, pour deux raisons. D'abord, car la majorité travaille pour plusieurs employeurs. Ensuite, car beaucoup travaillent sous le statut de microentrepreneur et ne sont donc plus comptabilisés dans les effectifs des maisons d'édition », explique Guillaume Goutte, secrétaire délégué SGLCE-CGT, section des correcteurs. Pour le syndicat, combattre précarité et « uberisation » induites par les statuts d'autoentrepreneur et de travailleurs à domicile est la priorité.
Une profession morcelée
Le paysage professionnel des correcteurs demeure en effet très morcelé, entre les (rares) salariés à temps plein des maisons d'édition, les plus instables contrats de travail à domicile, et les plus précaires autoentrepreneurs. Beaucoup de correcteurs mixent l'activité avec une autre. « Pour un écrivain, c'est le métier rêvé », explique par exemple Éric Laurrent, romancier chez Minuit puis Flammarion, mais aussi correcteur depuis vingt-cinq ans. « Le matin, j'écris, l'après-midi et le soir, je corrige. Ceci pour Fayard, Sabine Wespieser, Viviane Hamy, Flammarion... », raconte-t-il.
Édith Noublanche- Photo DRPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Lorsqu'on leur demande de décrire leur métier, tous les correcteurs interrogés dans le cadre de cet article répondent par les mêmes adjectifs : solitaire (ils reçoivent en général les manuscrits chez eux, puis les renvoient), mal payé (les tarifs horaires pratiqués semblent fluctuer entre 15 et 25 euros brut, quand ils ne sont pas fixés au nombre de signes par heure), précaire et cyclique (entre périodes de disette et dizaine de manuscrits à relire par mois). Mais aussi, avant tout, passionnant. « De toute façon, ils sont si mal payés que les correcteurs ne peuvent qu'être passionnés », glisse une éditrice sous couvert d'anonymat... « Corriger 8 000 signes/heure demande une concentration extrême. Et à 8 euros net/heure, beaucoup abandonnent », confirme Éric Laurrent.
La question de la formation
La formation est un point faible de la profession. Le diplôme historique de Formacom en 2015 a disparu au profit de formations plus courtes (Greta-CDMA, EMI-CFD, Edinovo), globalement jugées « insuffisantes» par de nombreux professionnels. « La qualité a vraiment baissé en trente ans, et les modules de trois ou quatre mois proposés aujourd'hui me paraissent courts. La formation a changé, le métier a changé, voire la société a évolué : avant, les correcteurs que je rencontrais étaient extrêmement cultivés. Ce n'est plus du tout le cas, il y a beaucoup de reconversions, de gens venant de milieux pas forcément littéraires », estime Wanda Rzewuski.
« Il y a un problème de formation, c'est certain, il n'y a plus beaucoup d'écoles et, même si nous recrutons toujours de bons éléments, la qualité baisse de manière globale, c'est une certitude », abonde une éditrice. Pour combler ce manque, des correctrices comme Édith Noublanche lancent leurs propres formations en ligne, enseignant notamment la négociation des tarifs et la gestion du statut d'autoentrepreneur. Car au-delà de la maîtrise de l'orthographe, les compétences requises sont vastes : connaissances sectorielles pointues, diplomatie avec les auteurs, endurance cognitive à toute épreuve...
Et chez les éditeurs ?
Du côté des maisons d'édition, les stratégies diffèrent. Certaines d'entre elles restent attachées à des services de corrections solides, d'Albin Michel à Flammarion, en passant par J'ai lu, La Découverte, Libella... En la matière, le service de correction de Gallimard reste remarquable, avec ses 26 travailleurs à domicile et ses six salariés internes, se partageant le travail de préparation de copie, de correction puis de bons à tirer. « Nous portons encore une grande attention à la qualité, car nous avons des lecteurs qui ne pardonnent pas », assure Hélène Valentinelli, cheffe du service préparation et correction présente dans la maison Gallimard depuis trente-huit ans.
D'autres, à l'inverse, semblent beaucoup moins privilégier une correction solide et sérieuse de leurs ouvrages. « Certains éditeurs peu regardants ont opté pour le recours à des prestataires ou des logiciels. De très grands éditeurs ne font plus du tout le travail nécessaire », explique Édith Noublanche, qui a vu les pratiques évoluer en trois décennies et explique avec humour avoir dû « embrasser beaucoup de crapauds avant de trouver mes éditeurs princes charmants ». « Il y a vingt-cinq ans, on corrigeait tout deux fois. Désormais, je remarque des éditions même pas corrigées. Il y a une économie faite sur la correction dans un marché du livre très tendu », confirme Éric Laurrent.
L'IA, la grande inconnue
L'amélioration récente des outils d'IA n'est pas pour rassurer la profession. Si des outils comme ProLexis, pionnier français lancé en 1991, sont perçus comme des filets de sécurité appréciés, l'essor de l'IA générative inquiète. « Cela va sinistrer la profession », estime un correcteur. « Pour les ouvrages techniques, la romance ou les romans de gare sans faits de langue, notre travail est déjà mis en péril », constate un autre.
Mais pour la majorité des professionnels interrogés ici, le métier de correcteur reste si incontournable dans l'industrie de l'écrit qu'aucune IA n'est en mesure, à l'heure actuelle, de le remplacer (lire par ailleurs). « Cela ne me viendrait pas à l'esprit de passer par une IA pour corriger nos ouvrages », affirme José Carlin Pérez, à la tête d'En Exergue du groupe Média-Participations. « Il y a des faits de langue qui ne pourront jamais être traités par des machines, c'est impossible », confirme Éric Laurrent. « Le sens critique et la culture ne sont pas reproductibles par une machine, l'humain doit mettre sa patte. Tout l'enjeu de la machine est d'aider au décoquillage peu intelligent au profit de la vraie culture du correcteur : relire le fond et être capable de relever les anomalies fondamentales », abonde Wanda Rzewuski chez ProLexis.
Pour cette dernière, le vrai danger est plutôt de laisser aux IA trop de place et trop de confiance. « Je constate une tendance chez les jeunes correcteurs à penser que la machine a raison, qu'elle est plus intelligente qu'eux, et à oublier qu'ils sont maîtres. Le sens critique humain reste irremplaçable », martèle-t-elle. « L'IA nous fait risquer une baisse générale de la pensée, et les mots, c'est ce qui traduit la pensée », confirme Hélène Valentinelli, qui conclut : « Il faut se battre avec des humains pour garder une abondance de vocabulaire. La langue française est si riche, il ne faut pas la laisser aux machines et lâcher notre passion commune des mots. »
IA vs correcteurs humains : la parole à l'IA
IA vs correcteurs humains : la parole à l'IA
Édith Noublanche, correctrice : « Je ne fais jamais moins de 2 000 interventions sur un texte »
Correctrice indépendante en édition littéraire depuis une vingtaine d'années, Édith Noublanche vit et travaille dans un hameau d'Occitanie. Pour elle, malgré les contraintes, le métier de correcteur reste fascinant.
Livres Hebdo : Quelles sont les prérogatives pour envisager de se lancer dans la correction pour l'édition ?
Édith Noublanche : Impossible de s'improviser correcteur. Il faut de vraies connaissances, une curiosité illimitée et, surtout, une aptitude à douter de tout. Il faut vérifier tout ce que l'on croit savoir et bien sûr ce dont on n'est pas certain. Être bon en orthographe, aimer lire ou écrire ne saurait suffire, c'est même quasiment nager à contre-courant. Un correcteur effectue une lecture syllabique, à mille lieues de la lecture plaisir par conséquent. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe tellement de maisons que l'on devrait statistiquement toujours trouver chaussure à son pied. Ce n'est pourtant pas le cas. Beaucoup se cassent les dents, faute de s'être assez penchés sur le métier en amont et de savoir pour qui et sur quel support ils veulent ou peuvent travailler.
Comment se passe concrètement la relecture d'un texte ?
Le correcteur indépendant qui s'est entendu sur une mission de correction avec l'éditeur va effectuer une relecture du texte qui lui est adressé. Il peut s'agir d'une préparation de copie ou d'une relecture d'épreuves. Pour un texte de 250 000 signes, il pourra selon la vitesse de relecture (la tâche) travailler 31,25 heures (8 000 signes/h), 25 heures (10 000 signes/h) ou 16,66 heures (15 000 signes/h). Il est donc important de caler précisément non seulement le prix, mais aussi la vitesse de relecture.
Tous les retraits effectués, toutes les charges acquittées, il reste au correcteur environ la moitié de ce qui a été facturé. Autant dire qu'il faut bien fixer ses prix... et beaucoup travailler.
Pourtant, il est impossible mentalement de faire trop d'heures à la suite. C'est une activité qui demande une attention de tous les instants. On doit, dans le même temps, corriger l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, la typographie, la langue, vérifier la cohérence du texte, vérifier les informations. Il faut repérer les répétitions, les maladresses, les erreurs, et procéder à des harmonisations dans l'ensemble du document qui nous a été confié, et tout cela en temps limité. Je ne fais jamais moins de 2 000 interventions sur un texte.
Seuls, à l'arrivée, l'éditeur et l'auteur savent le travail qui a été fourni par le correcteur. Ce que le lecteur voit, c'est en revanche ce que le correcteur aura pu oublier des fautes commises par l'auteur. La correction peut être une tâche ingrate, les éditeurs mentionnent assez rarement le nom des correcteurs.
Quels sont vos rapports avec les maisons avec lesquelles vous collaborez ?
Les maisons d'édition font appel à nous. Elles nous proposent un travail, une mission, que nous allons ou non accepter d'effectuer. Elles sont nos clientes. Certaines maisons l'oublient, qui veulent tout fixer : tarif et délai, oubliant parfois qu'elles nous laissent seuls avec toutes les charges et responsabilités. Il faut donc batailler, car, indépendants, nous avons une entreprise à gérer et des charges à payer. On ne décide pas du tarif payé à un garagiste, à un boulanger ou à un coiffeur. Il doit en aller de même avec les correcteurs, métier pour lequel certaines maisons ont une vision un peu esclavagiste.
Mais quand on arrive à avoir une palette de maisons avec lesquelles on travaille bien et régulièrement, on arrive à dégager du chiffre et à fidéliser. Je fais partie des correctrices heureuses, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Quelle est votre vision sur le recours à l'autoentreprenariat ?
L'autoentrepeneuriat est une aberration puisqu'il est le plus parfait non-statut qui soit. Aucune sécurité, aucun des acquis sociaux à disposition. Pourquoi dès lors y recourir ? Parfois sous la pression indirecte : il faut pouvoir facturer à une maison pour travailler, donc il faut avoir son numéro de Siret, donc être déclaré comme professionnel et payer ses charges à l'Urssaf. Parfois par choix : c'est mon cas. J'ai privilégié ma qualité de vie au quotidien, je vis dans un hameau d'Occitanie : aucune chance de trouver un poste de salariée dans ma branche en restant là où je réside. L'avantage du statut est la liberté : de temps d'exercice, de lieu d'exercice, de clientèle, etc. On nous fait en quelque sorte payer cette liberté.
Qu'est-ce qui vous séduit toujours le plus dans ce métier ?
Un aspect positif du métier est sa grande variété. On apprend tous les jours, et dans de nombreux domaines. Tant d'un point de vue linguistique, car la langue évolue, que du contenu. Mais on doit rester conseiller de l'auteur, et ne jamais se substituer à lui. On propose des choses, l'auteur dispose. Il faut vraiment voir ça comme un travail d'équipe. Si je compare avec le milieu automobile, on dira que nous sommes les mécaniciens ; on voit le pilote, c'est lui que l'on suit, mais l'écurie est essentielle, avec ses mécaniciens triés sur le volet. Nous faisons les réglages, apportons une plus-value au texte pour qu'il aille le plus loin possible et soit le meilleur possible sous la bannière de l'écurie (la maison) qui nous rémunère. Correcteur est une profession incroyable, mais souvent mal présentée.