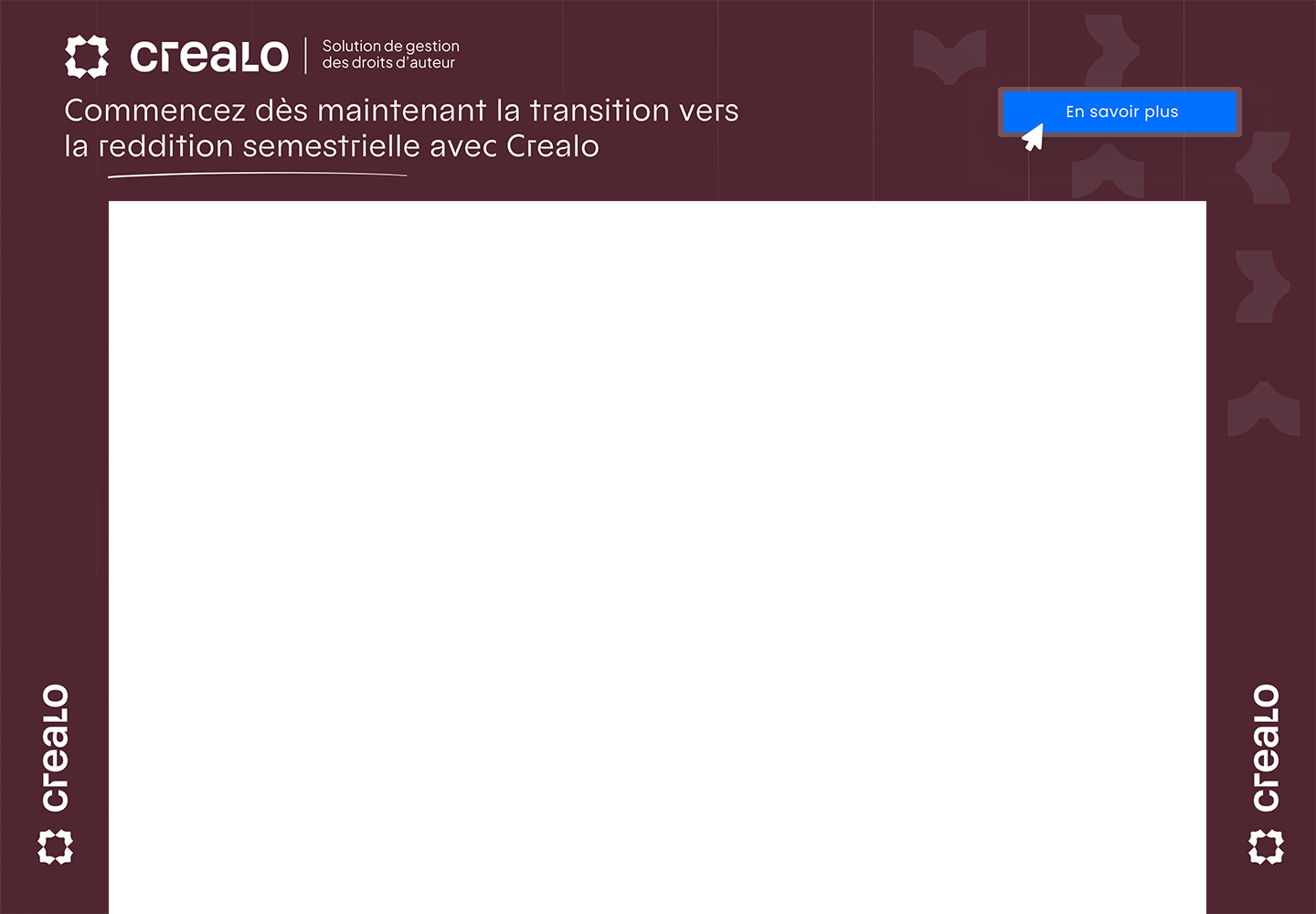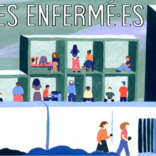L’attentat terroriste perpétré contre la rédaction du journal Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 a conduit à l’assassinat de plusieurs journalistes, dont le dessinateur de renom Tignous. En réaction immédiate à ces événements dramatiques, une édition spéciale du journal a été publiée, intégrant notamment des rééditions de dessins phares réalisés par Tignous. Cette publication posthume a rapidement suscité un conflit juridique complexe opposant les héritiers du dessinateur, représentés par la société Les Petites Teignes, détentrice des droits patrimoniaux hérités, à la société éditrice de Charlie Hebdo, Les Éditions Rotative.
Ce litige examiné par la Cour d'appel de Paris (Pôle 5, Chambre 2, RG n°23/14755) a donné lieu à un l'arrêt rendu le 28 mars 2025 qui constitue une contribution jurisprudentielle et doctrinale essentielle dans le domaine de la propriété intellectuelle relative aux œuvres journalistiques. Cette décision étend et précise l'interprétation des règles régissant la titularité et les modalités concrètes d’exploitation des droits patrimoniaux des journalistes salariés sous le régime spécifique instauré par la loi n°2009-669 du 12 juin 2009, dite loi Hadopi. Cette dernière avait pour ambition de restructurer les relations économiques et contractuelles entre journalistes et entreprises éditoriales, objectif auquel cet arrêt apporte des réponses juridiques particulièrement éclairantes.
Malgré le contexte exceptionnel et tragique, les héritiers ont contesté la légalité de cette réédition, arguant qu'elle constituait une atteinte directe à leurs droits patrimoniaux en l’absence d'autorisation expresse préalable. Cette position était appuyée par la société mandataire, laquelle rappelait que les principes fondamentaux du droit d’auteur exigent impérativement l’obtention préalable de l'autorisation des ayants droit pour toute exploitation posthume des œuvres protégées.
Œuvre collective ou œuvres individuelles autonomes ?
Le cœur du débat juridique portait sur la qualification précise de la nature du numéro spécial litigieux. La Cour devait établir s’il s'agissait d'une œuvre collective ou d'une simple compilation d’œuvres individuelles bénéficiant chacune d'une protection distincte et autonome. Cette question revêt une importance décisive puisqu'elle conditionne directement la répartition des droits d’exploitation entre éditeurs et auteurs individuels ou leurs ayants droit.
En effet, le droit d'exploitation des oeuvres des journalistes salariés dépend de la qualification juridique du journal qui les publie. En l'espèce, la société éditrice du journal soutenait que le n° 1178 de Charlie Hebdo n'était pas une oeuvre collective aux motifs que la publication du numéro n'est pas l'initiative de la seule personne morale mais également de la collectivité de ses journalistes et préposés souhaitant rappeler leur attachement à la liberté d'expression et rendre hommage aux personnes décédées dans l'attentat, et que les contributions qui le composaient étaient signées par leurs auteurs respectifs, ajoutant que les oeuvres en question ont été créées et divulguées avant que naisse l'initiative d'élaborer le numéro 1178 et n'avaient pas vocation à être réunies dans ce numéro 1178, que le promoteur de l'oeuvre collective doit diriger la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration, ce qui n'a pas été le cas puisque les dessinateurs étaient décédés au moment de l'initiative de ce numéro. De son côté, la société héritière des droits de Tignous soutenait qu'il s'agissait d'une oeuvre collective dont elle détenait les droits d'auteur afférents.
Face à ces positions, la Cour d’appel de Paris rappelait les distinctions entre les différentes œuvres, à savoir : Est dite « de collaboration » l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite « composite » l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Est dite « collective » l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
« Dans le cadre de leurs fonctions et pour le compte de leur employeur »
En l'espèce, la Cour d’appel de Paris a considéré que le n° 1178 du journal Charlie Hebdo avait été créé sur l'initiative de la société Éditions Rotative, qui l'a édité, publié et divulgué, sous sa direction et sous son nom et dans lequel la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel il est conçu, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
En conséquence, la Cour a estimé que le n° 1178 du journal Charlie Hebdo était donc une oeuvre collective peu important que la publication soit également à l'initiative des membres du comité de rédaction et des journalistes de Charlie Hebdo dès lors que ces derniers ont agi dans le cadre de leurs fonctions pour le compte de leur employeur qui les a rémunérés en contrepartie et en a assumé seul la charge financière, ou le fait que le journal incorpore des contributions signées par leurs auteurs respectifs dès lors que celles-ci se fondent dans l'ensemble en vue duquel elle sont conçues, ou encore que les oeuvres en question ont été créées et divulguées avant la parution du journal du vivant du ou des dessinateurs concernés dès lors que c'est bien sur l'initiative de la personne morale, que le n° 1178 du journal Charlie Hebdo qui s'inscrit dans la ligne éditoriale des numéros précédents du journal a été publié.
Hadopi et droits des journalistes
Un apport jurisprudentiel majeur de cet arrêt concerne la clarification apportée au régime spécifique institué par la loi Hadopi, particulièrement en ce qui concerne les œuvres journalistiques réalisées après son entrée en vigueur. La Cour a expressément confirmé la validité juridique de la cession automatique des droits patrimoniaux des œuvres créées par des journalistes salariés à leurs employeurs, même sans l'existence préalable d’un accord collectif précisant les modalités de cette cession.
En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 dite Loi Hadopi, qui a modifié les règles applicables aux journalistes salariés, la collaboration entre les journalistes professionnels et l'entreprise de presse, qui les emploie, est régie d'une part, par l'article L. 7111-5-1 du code du travail qui dispose que « la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L 132-5 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle », et d'autre part, par les articles L. 132-35 à L. 132-45 du code de la propriété intellectuelle, qui définissent les conditions de cession des droits d'exploitation sur les oeuvres des journalistes et les rémunérations dues en contrepartie.
De plus, selon l'article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle, « la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé […], qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur, emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées ».
En application de ces dispositions, sauf clause contraire, la société exploitant un titre de presse est cessionnaire des droits d'exploitation sur les oeuvres de ses journalistes, qu'elles soient ou non publiées, mais à la condition qu'elles aient été créées pour le titre en question.
« Nécessité impérative d’une rémunération complémentaire »
Toutefois, en complément indispensable à cette automaticité, la Cour a également affirmé la nécessité impérative d’une rémunération complémentaire à verser aux journalistes pour toute réexploitation de leurs œuvres excédant la période initiale de diffusion prévue. Cette obligation vise directement à garantir une juste et équitable compensation économique, protégeant ainsi les intérêts patrimoniaux des journalistes tout en assurant un équilibre contractuel optimal entre auteurs et éditeurs.
En effet, aux termes de l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, « l'exploitation de l'oeuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse […], a pour seule contrepartie le salaire pendant une période fixée ». Au-delà, selon l'article L. 132-38 du même code « l'exploitation de l'oeuvre dans le titre de presse […] est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif ».
La Cour jugeait donc qu’il résultait de ces dispositions que pour les oeuvres créées par des journalistes salariés depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2009, les droits d'exploitation appartiennent à la société qui exploite le titre de presse, sans autre rémunération que le salaire pour la première publication et dans le délai fixé à l'accord, et que la société exploitante est autorisée à réexploiter les oeuvres de ses journalistes au-delà du délai, mais moyennant le versement d'une rémunération complémentaire.
Conséquences sur les pratiques éditoriales et l’économie des médias
Les répercussions de cet arrêt sont particulièrement étendues sur les plans juridique et économique. En consolidant juridiquement les rapports entre journalistes et employeurs, tout en établissant une obligation explicite de rémunération complémentaire en cas de réexploitation des œuvres, la Cour assure une protection renforcée des intérêts économiques des journalistes. Par ailleurs, cette décision procure aux médias une sécurité juridique accrue, essentielle à la poursuite sereine de leur mission d’information, tout en respectant scrupuleusement les principes fondamentaux du droit d’auteur.
Ainsi, la Cour d’appel de Paris a établi un équilibre entre la nécessaire protection des droits économiques des journalistes et la liberté éditoriale, indispensable à la vitalité démocratique et au pluralisme du secteur médiatique.
Alexandre Duval-Stalla

Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.