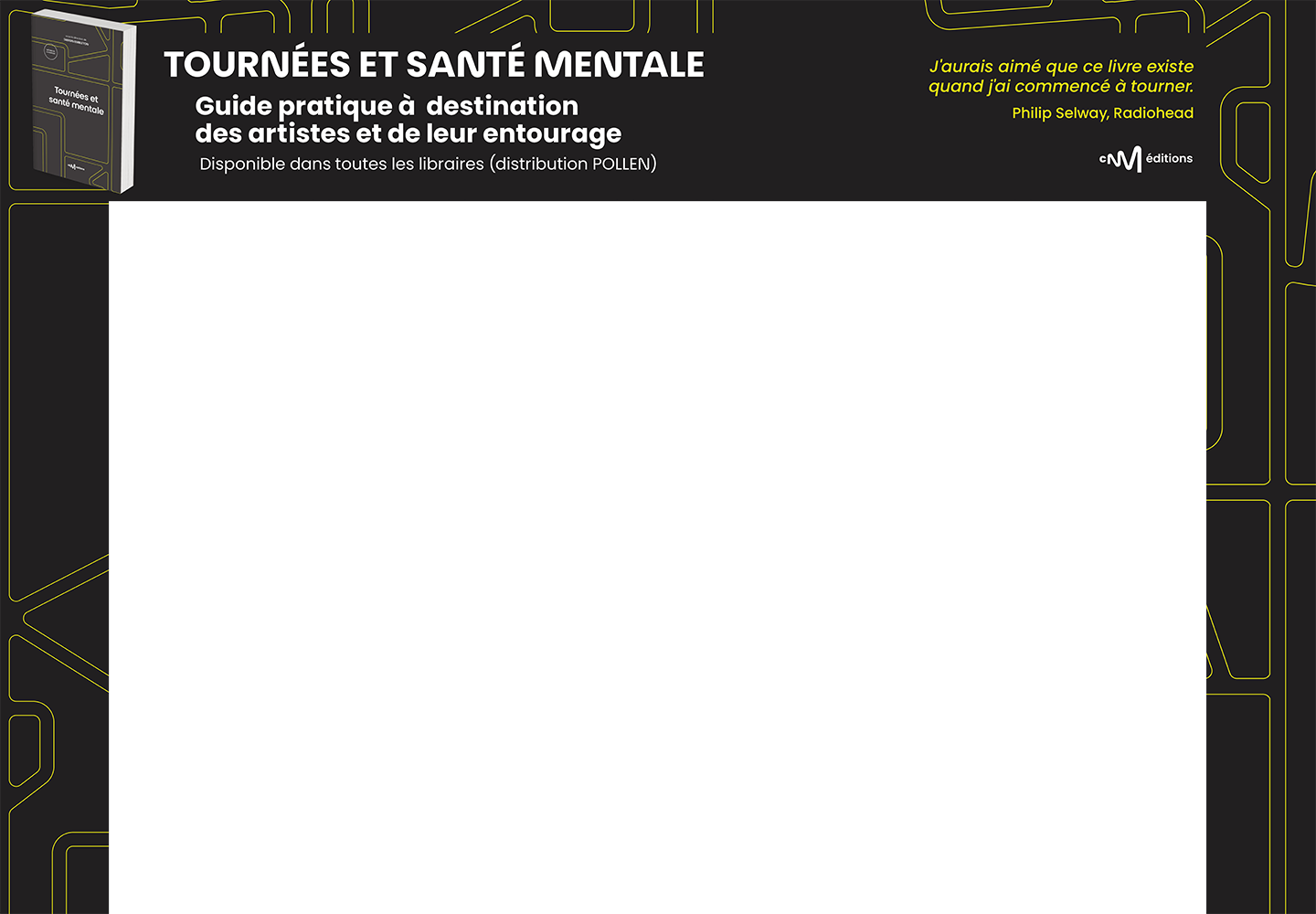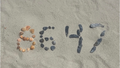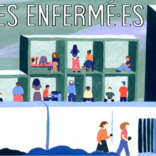Quand Harper Lee écrit Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur (To Kill a Mockingbird, 1960), elle ne parle pas seulement d’un passereau. Elle nous rappelle que la loi, avant d’être un corpus de textes, est un rempart contre l’arbitraire. L’oiseau moqueur, c’est la vérité, cette vérité fragile sans laquelle aucune société ne peut se construire, mais c’est aussi le droit qui fonde nos démocraties et le devoir qui anime ceux qui le servent. « Le courage, c’est de faire ce qui est juste, même quand on a perdu d’avance », pourrait-on dire en écho à Atticus Finch, cet avocat intraitable dans l’Amérique des années 1930, dont le combat transcende les frontières et les époques.
Car la justice n’est pas une mécanique froide : elle est l’engagement de traiter chaque être avec la même dignité, qu’il soit puissant ou anonyme, admiré ou détesté. Cette exigence universelle trouve dans notre tradition juridique française ses lettres de noblesse. Comme Atticus, le juge doit parfois prendre le risque de déplaire. Non par provocation, mais par fidélité à l’idéal d’égalité que Portalis*, dans son discours préliminaire sur le Code civil, résumait en ces termes : « Dans nos tribunaux, tous les hommes sont égaux ; ils doivent l’être aussi devant la loi. »
Une fiction nécessaire à l’État de droit
Certains y verront une fiction. Une utopie, même. Mais c’est une fiction nécessaire, celle qui distingue l’État de droit de la loi du plus fort. Celle qui, dans la nuit du 4 août 1789, a vu la représentation nationale abolir les privilèges de l’Ancien Régime et poser le principe intangible de l’égalité devant la loi. Cette déclaration du 4 août fut l’acte fondateur d’une société où chacun, quel que soit son rang, devait être jugé selon les mêmes règles.
Le juge n’invente pas la loi, il l’applique telle que voulue par le législateur, expression de la souveraineté populaire. Pourtant, son rôle ne se limite pas à une application servile. « Son office n’est pas de plier les lois aux passions du moment, mais de les appliquer avec une rigueur égale pour tous », rappelait Portalis. Cette rigueur, cette indépendance d’esprit, sont ce qui sépare la justice de l’arbitraire. Sans elles, il n’y a plus de garantie pour les droits, plus de protection contre les abus, plus de société où chacun peut se reconnaître dans les règles communes.
Car la justice n’est pas un idéal abstrait. Elle est le ciment invisible qui lie les citoyens entre eux, la promesse que, malgré les inégalités de fait, la loi reste un refuge. « Les lois sont des actes de sagesse, de justice et de raison », ajoutait Portalis. À nous de nous en souvenir, surtout quand les pressions se font plus fortes, les critiques plus vives, et les tentations de l’arbitraire plus pressantes. La loi n’est pas un carcan, mais une boussole. Et le juge, son gardien vigilant.
*Jean-Étienne-Marie Portalis, Conseillé d’État et ministre des cultes de Napoléon.
Vincent Vigneau

Olivier Dion - Vincent Vigneau
Vincent Vigneau est magistrat depuis 1990 et président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation depuis 2023, après avoir été en poste en Normandie et en région parisienne, notamment à la cour d’appel de Versailles et au Tribunal de grande instance de Nanterre. Il est également membre du conseil de résolution de l’ACPR et préside le conseil de discipline des juges des tribunaux de commerce. Il a par ailleurs été professeur associé à l’université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines de 2001 à 2023. Il a coécrit plusieurs ouvrages juridiques et a publié en 2023, son premier roman, Les fleurs de lin (Les presses littéraires) dans lequel il raconte, à travers le personnage principal, son combat contre le cancer.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.