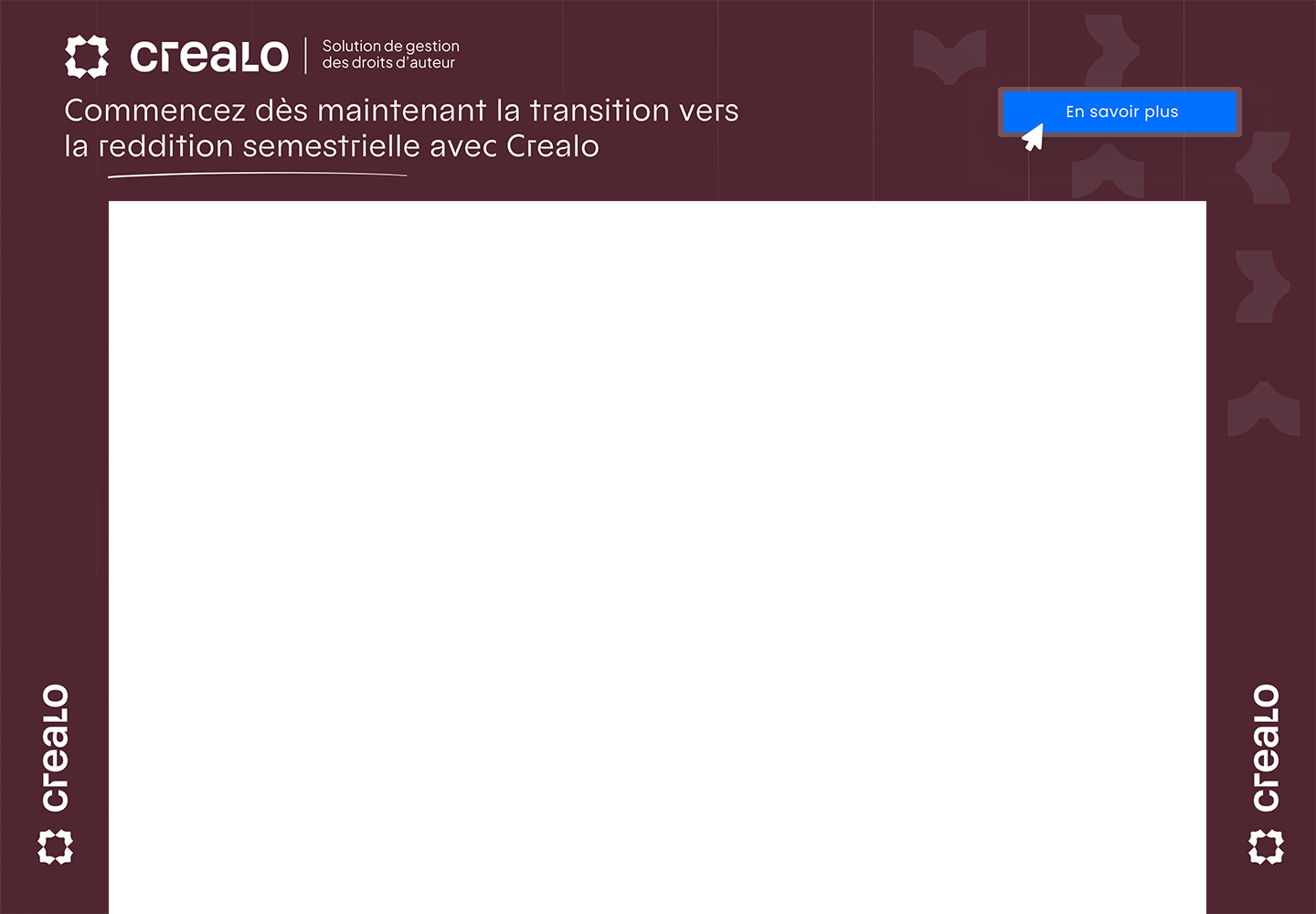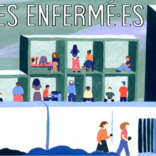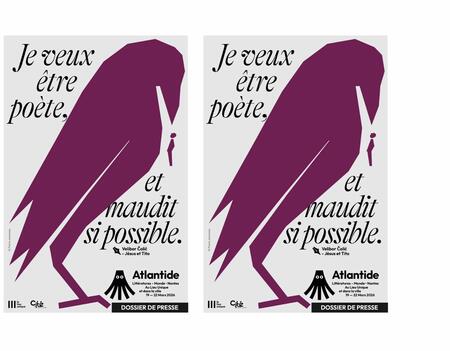« Comme si l’usage du pouvoir ne consistait qu’à faire du mal aux autres ! », Salluste, La conjuration de Catilina
Saison 4 : La série se poursuit. Chacun est dans son personnage. Pour le pire. Le suspense perdure. Mais la fin semble écrite.
Depuis le 1er juillet 2025, la situation de James Comey, ancien directeur du FBI limogé en 2017 par Donald Trump, illustre avec une acuité rare les tensions croissantes entre l’exécutif et le pouvoir judiciaire aux États-Unis. L’enchaînement d’événements impliquant l’ancien haut fonctionnaire et ses proches — licenciements, inculpations, pressions et manœuvres procédurales — dessine un tableau préoccupant d’une justice fédérale soumise à une instrumentalisation politique contraire à la tradition constitutionnelle américaine de séparation des pouvoirs.
Le licenciement de Maurene Comey : une atteinte indirecte à l’impartialité de la fonction publique
Tout commence à la mi-juillet 2025 avec le renvoi de Maurene Comey, fille aînée de James Comey et procureure fédérale au sein du District Sud de New York. Le Department of Justice (DOJ) annonce son licenciement sans justification publique claire. Or, celle-ci est connue pour avoir conduit des affaires médiatiques sensibles, notamment celle de United States v. Maxwell (S.D.N.Y. 2021), dans laquelle elle avait poursuivi Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel dans l’Affaire Epstein. Ce renvoi suscite immédiatement la controverse : plusieurs anciens procureurs fédéraux dénoncent un acte de représailles indirectes contre James Comey. En septembre, Maurene Comey dépose une plainte administrative auprès de l’Office of Special Counsel, invoquant une violation des prohibited personnel practices prévues par le Title 5, § 2 302 (b) du United States Code, interdisant tout licenciement fondé sur des considérations politiques, personnelles ou de parenté. Juridiquement, un tel renvoi, s’il est motivé par des raisons de proximité familiale avec un adversaire politique du président, constituerait un détournement de pouvoir contraire au principe d’impartialité de la fonction publique fédérale.
L’enquête « 86 47 » : la criminalisation du discours politique
L’affaire se complexifie avec la controverse dite du « 86 47 », expression employée par James Comey dans un message Instagram publié en mai 2025, représentant des coquillages formant le nombre 86 à côté du chiffre 47 — une allusion interprétée par certains partisans de Trump comme une menace implicite à l’encontre du « 47ᵉ président » des États-Unis. Eighty-six ou 86 est un terme argotique américain utilisé pour indiquer qu'un article n'est plus disponible dans un bar ou un restaurant. Le terme est maintenant plus généralement utilisé pour signifier se débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un, voire le tuer.
Le 16 mai 2025, le Secret Service et le Department of Homeland Security (DHS) ouvrent alors une enquête. Bien que l’ancien directeur du FBI ait supprimé la publication et affirmé qu’il s’agissait d’une plaisanterie, cette réaction institutionnelle soulève la question de la proportionnalité. Selon la jurisprudence Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969), et Virginia v. Black, 538 U.S. 343 (2003), l’expression politique ne peut être criminalisée qu’en cas d’ « incitation imminente à la violence » ou de « menace véritable » (true threat). En l’espèce, aucune de ces conditions ne semble remplie, ce qui a légitimement alimenté le soupçon d’une utilisation dissuasive du pouvoir d’enquête à des fins politiques.
L’inculpation de James Comey : la résurgence de la « selective prosecution »
Mais c’est surtout à partir de la fin septembre que l’affaire prend un tournant institutionnel majeur. Le 25 septembre 2025, la cour fédérale du Eastern District of Virginia (EDVA) rend publique une mise en accusation (indictment) contre James Comey pour deux chefs : fausses déclarations au Congrès et obstruction d’une procédure parlementaire. Cette décision intervient quelques jours seulement après que Donald Trump ait publiquement réclamé que la Justice « agisse enfin » contre Comey, l’accusant de trahison. Plusieurs sources internes au DOJ indiquent que le précédent procureur en charge du dossier, Erik Siebert, avait recommandé un classement sans suite pour absence de probable cause avant d’être relevé de ses fonctions.
Sa remplaçante, Lindsey Halligan, avocate proche du cercle trumpiste et dépourvue d’expérience en matière de poursuites fédérales, aurait ensuite autorisé l’ouverture des poursuites. L’analyse juridique de cette séquence doit être éclairée à la lumière de la jurisprudence United States v. Armstrong, 517 U.S. 456 (1996), qui reconnaît la possibilité de contester une poursuite sélective lorsqu’il existe des indices de discrimination politique dans le choix des inculpés. En l’espèce, la concomitance entre les déclarations présidentielles et les décisions procédurales, ainsi que la rotation anormale du personnel du DOJ, constituent des éléments susceptibles d’étayer une motion de selective prosecution fondée sur le cinquième amendement.
Les purges internes au DOJ : la déstabilisation du ministère public
Quelques jours après cette inculpation, plusieurs procureurs chevronnés du bureau de l’EDVA ont été limogés ou ont démissionné à la suite de désaccords internes sur le dossier Comey. L’installation d’une direction intérimaire sans expérience et la mise à l’écart de magistrats de carrière traduisent une perte manifeste d’autonomie du ministère public, pourtant garanti par les post-Watergate Guidelines de 1978, instaurées pour éviter les interférences présidentielles dans les poursuites. Ce phénomène d’ « épuration ciblée » fragilise le principe même de la prosecutorial independence, pierre angulaire du système accusatoire américain.
La mise en scène judiciaire : le « perp walk » de James Comey
Enfin, un épisode, survenu début octobre 2025, parachève cette dérive. Le 3 octobre 2025, un agent du FBI aurait été suspendu pour avoir refusé d’organiser un « perp walk », c’est-à-dire la présentation publique, menottée, d’un inculpé devant les médias — en l’occurrence James Comey — alors même qu’aucun mandat d’arrêt n’avait été délivré et que celui-ci s’était déjà présenté volontairement à la justice. Ce refus, motivé par des considérations déontologiques, aurait conduit à une sanction disciplinaire immédiate. Une telle pratique, destinée à produire un effet visuel humiliant, heurte non seulement la présomption d’innocence garantie par le Cinquième Amendement, mais aussi les standards éthiques du Federal Bureau of Investigation interdisant toute mise en scène de l’arrestation en l’absence de nécessité procédurale. Cet épisode illustre l’instrumentalisation symbolique de la justice à des fins politiques et médiatiques.
La remise en cause des principes fondamentaux de la République américaine
Pris ensemble, ces faits révèlent un tableau d’ingérences directes et indirectes de l’exécutif dans le fonctionnement de la justice fédérale. Le renvoi de Maurene Comey relève d’une stratégie de pression familiale ; l’enquête « 86 47 » manifeste une instrumentalisation du droit de la sécurité nationale pour intimider un adversaire ; l’inculpation tardive de James Comey s’inscrit dans une logique de vengeance politique déguisée en poursuite pénale ; et les limogeages internes du DOJ participent d’une volonté d’aligner la chaîne de décision judiciaire sur les impératifs du pouvoir exécutif. Ces atteintes cumulées fragilisent gravement l’architecture constitutionnelle issue de Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803), fondée sur la distinction entre judicial power et executive discretion.
Un pouvoir exécutif revendiquant un contrôle direct sur les instruments de la loi
En conclusion, l’affaire James Comey dépasse la seule dimension personnelle ou partisane. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de remise en cause de la neutralité institutionnelle du DOJ et, plus généralement, de la culture juridique américaine héritée de l’après-Watergate. La judiciarisation sélective d’un ancien directeur du FBI, couplée à l’éviction de procureurs indépendants, démontre que la frontière entre justice et politique, déjà ténue, tend désormais à s’effacer sous l’effet d’un pouvoir exécutif revendiquant un contrôle direct sur les instruments de la loi. Cette évolution n’est pas seulement une crise de gouvernance : elle marque une inflexion historique dans l’équilibre des pouvoirs aux États-Unis, où la justice risque, pour la première fois depuis un demi-siècle, de redevenir un instrument au service du prince.
Alexandre Duval-Stalla

Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.