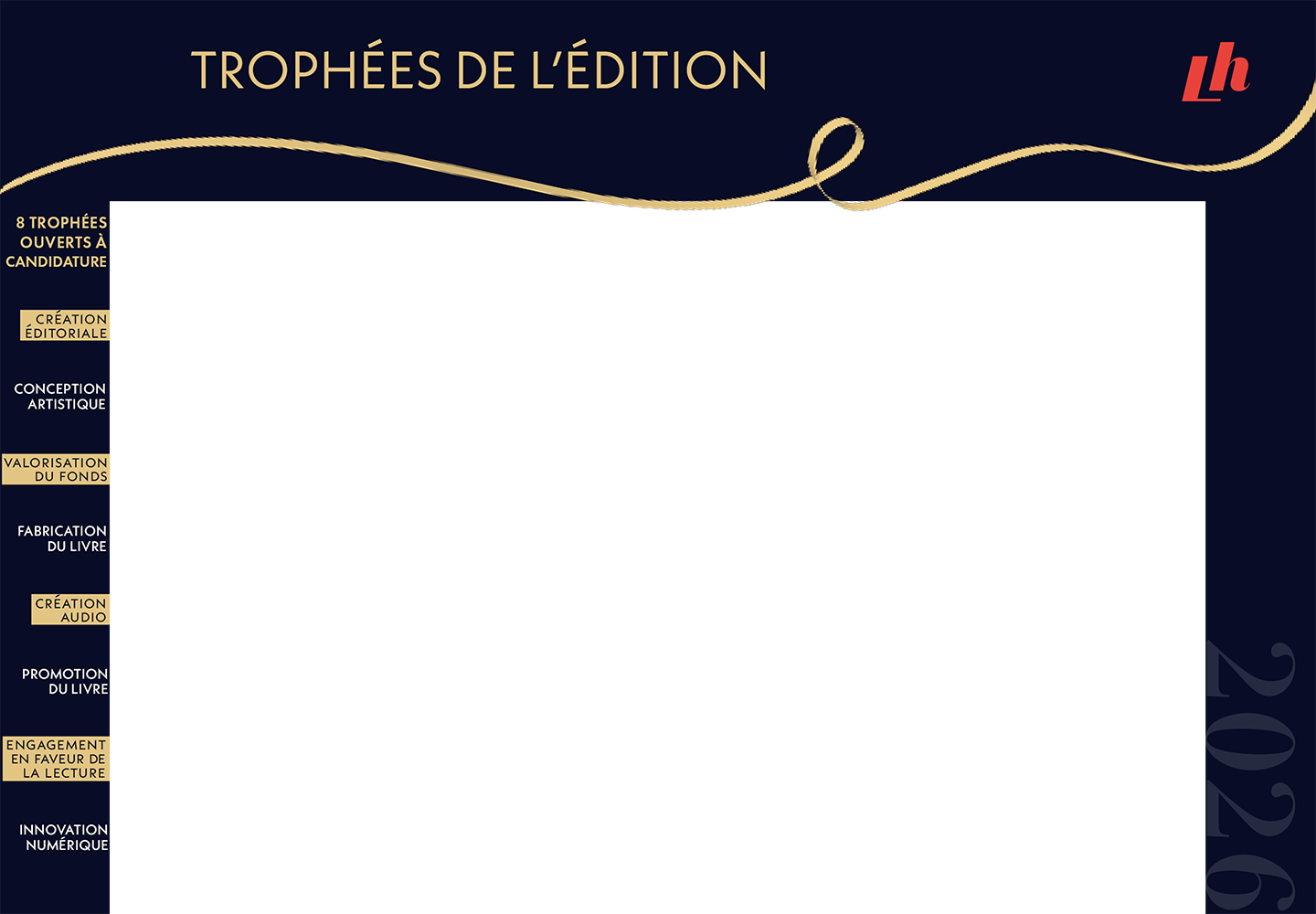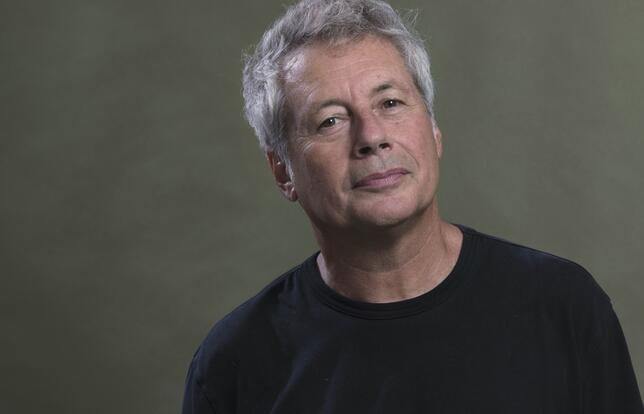Neuf ans après La jeune épouse (Gallimard, 2016), vous publiez une nouvelle fiction, Abel. Mais vous retournez aussi à la littérature de genre que vous aviez explorée dans Sans sang (Albin Michel, 2003), un roman noir, et Smith & Wesson (Gallimard, 2018), une pièce de théatre se déroulant aux abords des chutes du Niagara. Avec Abel, vous nous plongez dans le far west...
Oui, c'est l'Ouest mythique que j'ai déjà visité dans mon roman City. Sans sang relatait une histoire de vendetta, de règlement de compte, liée à la violence, et Smith & Wesson était une pièce au décor certes nord-américain, mais dans un cas comme dans l'autre il ne s'agissait pas de véritable western. Abel, si ! Quoique je prévienne le lecteur au commencement du roman : l'Ouest des westerns est un lieu en grande partie imaginaire, et l'Ouest de mon livre l'est encore plus. Peu importe que les noms ou les lieux aient réellement existé, que les faits se soient réellement passés. On a toujours affaire à un monde inventé, qui n'est autre que le fruit de l'imagination. Avec l'écriture, on a toutes les libertés.
Alessandro Baricco- Photo © FRANCESCA MANTOVANI/GALLIMARDPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Abel est sous-titré « western métaphysique », une notion qu'on a croisée plutôt chez les critiques cinéma que chez les romanciers... C'est difficile de l'expliquer à quiconque n'aurait pas encore lu Abel, car il n'existe pas de critères précis. Il s'agit sans doute d'une question de perception au fil des pages, de sentiments qu'imprime l'histoire une fois qu'on l'a lue... C'est comme une ambiance qu'on ressent et qui donne tout son sens à ce genre que je nomme « western métaphysique ». La définition paraît limpide après lecture. À titre de comparaison, au cinéma, je dirais que Quentin Tarantino ou les frères Coen, c'est du western métaphysique. Les westerns classiques sont horizontaux avec une narration linéaire. Vous avez une petite communauté tranquille sur la frontière, des brigands sèment le chaos, un shérif vient et rétablit l'ordre... Dans Abel, j'ai voulu un récit avec des allers et retours entre le présent et le passé, avec des abîmes. Il y a quelque chose de vertigineux dans les interrogations du protagoniste, on ne sait jamais d'où il parle, les points de vue qu'il tisse s'enchevêtrent, et on ne sait jamais quel âge il a lorsqu'il raconte son histoire. On ne sait pas plus dans quel temps on se trouve. Le western foisonne de figures symboliques : le cowboy, l'Indien, le bandit, le bien, le mal... Mais même s'il use de clichés, le western les incarne de façon matérielle, concrète. Ses codes sont très identifiables, et dans le même temps on peut jouer avec.
Vous avez même féminisé ce genre...
J'y ai introduit des femmes. Trois, voire quatre avec Lilith, la petite sœur d'Abel... Il y a le personnage de « la bruja », la sorcière, la mère d'Abel et de ses frères et sœur, et bien sûr l'amante d'Abel, Hallelujah Wood. Normalement les personnages féminins sont étrangers à la mythologie de l'Ouest ou, s'ils existent, sont relégués au second plan, ne sont guère plus qu'un élément du décor, cantonnés à un emploi de mégère ou de catin. Mais là, ces femmes tiennent un rôle essentiel dans l'existence du protagoniste sans pour autant donner l'impression qu'on a cassé le dispositif. Vous lisez Abel, il y a des femmes et c'est quand même un western. Abel, comme pour la question temporelle, ce traitement non-linéaire des événements, arrive comme un chien dans le jeu de quilles du western et chamboule tout. Ce qui est intéressant, quand on travaille dans le cadre du western, n'est pas de se l'approprier pour se l'approprier, de manière paresseuse, en appliquant au pied de la lettre ses codes, il s'agit plutôt de les détourner pour transformer et renouveler entièrement le genre.
Alessandro Baricco- Photo © FRANCESCA MANTOVANI/GALLIMARDPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
La mort n'est jamais loin... Peut-être est-ce cela − l'horizon de la mort − qui le rend métaphysique ?
Abel grandit au milieu de la mort. La mort est le leitmotiv du western. Qu'est-ce qu'un pistolero, le cowboy du western, sinon quelqu'un qui donne la mort et risque de la recevoir à tout moment ? Le sentiment de la mort infuse toutes les histoires de tueur. C'est leur côté sacré, « au-delà de la vie » qui hante sans cesse. La mort est une espèce de rendez-vous dans la vie d'un cowboy, un rendez-vous constamment ajourné. Mais dans Abel, le problème pour le héros n'est pas de mourir mais de naître. Et c'est un autre motif, moins évident : l'idée de naître à soi-même, cette quête qui permet de comprendre qui on est. Mourir, c'est facile, c'est naître qui est plus difficile. Alors comment naître, réussir à être véritablement soi ? Telle est la question qui traverse l'aventure d'Abel. La seule question qui vaille pour lui et l'obsède. Elle apparaît comme un fil rouge dans les westerns, mais de manière cachée. Vouloir naître à soi-même appartient en vérité à la tradition du western même si le cowboy ne l'admettra jamais parce qu'il doit correspondre à l'image du macho, montrer qu'il est un mâle sûr de lui, un dur à cuire qui n'a que faire de questionnements existentiels et se fiche comme de l'an quarante de la philosophie.
Abel s'y frotte malgré lui quand il en lit à son mentor mal voyant. Et vous n'hésitez pas à écrire le mot « entéléchie » dans un western !
Il y a beaucoup de clins d'œil à la philosophie, elle apparaît de manière ironique, sous forme de personnage, comme David Hume, le philosophe écossais, père du scepticisme, qui finit par se faire descendre. Ou comme une musique. Abel lit des pages entières de Platon, de Spinoza, de saint Anselme à cet as de la gâchette devenu aveugle qui est son maître. Abel n'y comprend rien mais il lui reste quelque chose comme la sensibilité à une couleur particulière. Quant à l'« entéléchie », c'est un mot qu'il découvre et qu'il se fait expliquer. Il s'agit du concept aristotélicien du passage de l'intention à la chose, de la puissance à l'acte.
C'est aussi une prise de conscience pour Abel, une blessure, « la blessure introuvable [qui] vit en nous, comme une force pure qui se tait sous la clarté de la peau, prête à advenir »...
Rien n'est fixe dans la vie du héros, c'est douloureux mais c'est son destin. Sa mère est partie quand il était jeune. La femme qu'il aime est insaisissable. Elle est bien avec lui mais ne reste jamais longtemps auprès de lui... Elle est volatile jusqu'à son nom, Hallelujah, qui sonne comme une chanson, c'est un nom doux et chantant, qui s'évanouit dans les airs. Tout fuit autour d'Abel, le monde est évanescent, fuyant.
Comme l'horizon. Cette frontière de l'Ouest, sans cesse repoussée, n'est-ce pas l'infini de l'espace ?
Le paysage a son importance dans le roman car un western, c'est d'abord un lieu. Mythique, d'où les noms bibliques David, Isaac, Abel... Abel, c'est le nom de la première victime de l'humanité. J'ai trouvé drôle qu'un tueur s'appelle Abel... Le western est la construction d'un paysage, où se déploie un monde sauvage, peuplé d'animaux, où vivent encore les autochtones. Au commencement du livre, Abel se souvient : « Tous ces espaces qui s'étendaient muets, aux marges du connu, dans l'Ouest profond, n'existent plus aujourd'hui, c'est fini. »
Dans un essai précédent, vous évoquiez « l'homme horizontal » qu'est devenu l'homme contemporain. Écrire un western métaphysique, justement, n'est-ce pas une façon de dire votre nostalgie de la verticalité, du monde d'avant ?
On peut être gagné par la nostalgie, et je le suis parfois beaucoup. Rappelons-nous que le XXe siècle a été plein de merveilles comme d'horreurs. Et s'il est vrai qu'aujourd'hui la distance, la hauteur sont des notions qui comptent peu, soyons lucides, il n'y a ni âge d'or ni décadence, il y a juste des mutations. Toutes les époques ont cherché un sens aux choses et quelle que soit l'époque, on est en quête de beauté. Le modèle de la Renaissance diffère de celui du Moyen Âge... En cela, l'ère numérique n'est guère différente. Quoique tout se déconstruise et se reconfigure à une vitesse formidable, nous avons le privilège d'en être le témoin. Alors qu'importe la nostalgie, c'est grisant !
Abel. Un western métaphysique
Gallimard
Traduit de l'italien par Lise Caillat
Tirage: 25 000 ex.
Prix: 20,50 € ; 176 p.
ISBN: 9782073060686