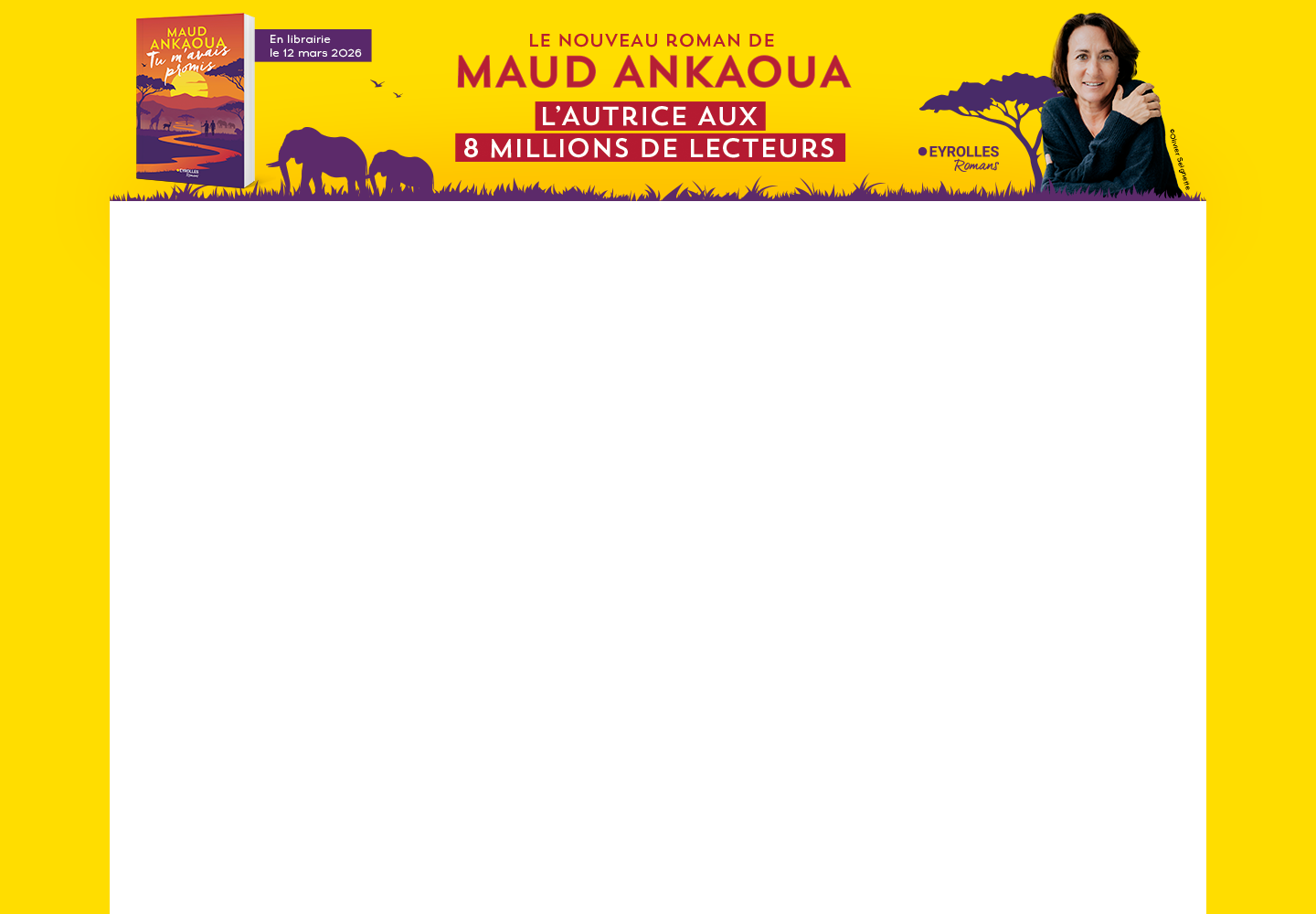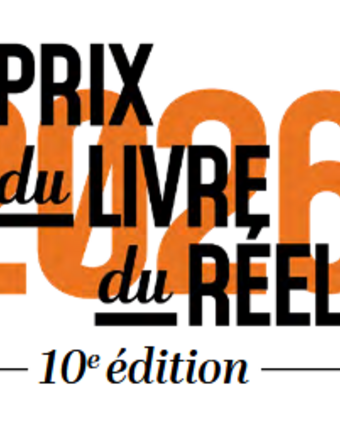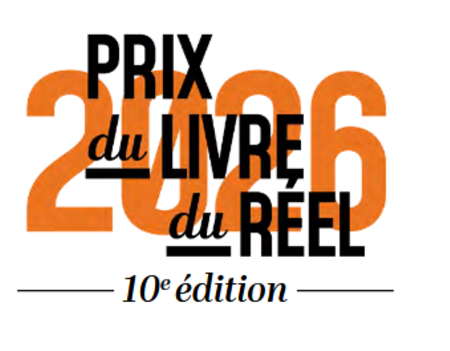Atwood par Atwood. Quel drôle d'exercice que celui d'écrire ses mémoires ! Dans Le livre des vies, qui paraît simultanément dans le monde entier, Margaret Atwood s'est prêtée à l'exercice de l'autobiographie. Alors qu'elle fête ses 86 ans, elle y raconte son existence, riche de plus de cinquante ouvrages, toutes formes littéraires confondues. Parce qu'il est temps, parce qu'elle n'a jamais fait qu'écrire, et qu'à la lecture de ce volume conséquent, on mesure l'importance d'en conserver la genèse.
Écrivaine, poétesse, essayiste et figure de proue du féminisme, la Canadienne d'Ottawa fait commencer sa chronologie avant même sa naissance, rendant hommage à ses parents, les premiers à l'avoir soutenue. On y découvre ensuite une jeune femme déterminée à devenir écrivaine dans un monde masculin où ce mot n'existait pas encore. À ses débuts, celle qui signait encore « Peggy » remplit des tiroirs de manuscrits, essuie des refus polis et finit par adopter les initiales « M. E. Atwood » pour éviter d'être rangée « sous l'étiquette femme ». D'emblée, sa conscience aiguë des limites imposées à son sexe nourrit sa vocation : écrire devient un acte de résistance.
Ce livre mémoire, à la fois introspectif et ironique, explore la naissance d'un « moi » d'écrivaine que Margaret Atwood décrit comme un double inquiétant, son propre « M. Hyde ». « Tout écrivain est au moins deux êtres », écrit-elle. Elle distingue en elle celle qui vit et celle qui écrit. L'une se cache dans l'ombre de l'autre, et le livre tout entier cherche à comprendre laquelle est la vraie Atwood.
L'autrice y consigne également ses éveils politiques comme la lecture d'articles sur les régimes totalitaires ou la découverte du récit censuré par la France coloniale en 1958, La question d'Henri Alleg. Ces préoccupations irrigueront plus tard La servante écarlate, dystopie parue en 1985, où elle imagine les États-Unis devenus théocratie. Margaret Atwood avait commencé tôt à mûrir l'idée de ce roman à partir de faits réels, des enfants enlevés puis élevés par les assassins de leur mère sous la dictature de Pinochet. Le succès de cette projection glaçante où les femmes fertiles sont soumises aux puissants a été démultiplié à l'échelle planétaire avec son adaptation en série télévisée en 2017, portée par l'actrice Elisabeth Moss.
Mais Le livre des vies déborde largement le seul champ littéraire. Il y est question, pêle-mêle, de la thèse que Margaret Atwood a menée à Harvard, de ses petits boulots, de son rapport à l'argent très « Scrooge », de ses nombreux séjours en Europe - dont sa visite des châteaux de la Loire, où elle se nourrit, par économie, de croque-monsieur. L'autrice livre également un immense témoignage d'amour pour l'écrivain et ornithologue Graeme Gibson, son compagnon depuis les années 1970, dont la mémoire commença à s'effacer en 2012, sept ans avant sa mort.
Dans ces pages retraçant une existence ponctuée d'œuvres devenues célèbres et de prix reçus comme s'il en pleuvait, l'écrivaine, drôle toujours, finit par s'interroger sur la vacuité de la célébrité - qui vaut mieux toutefois, dit-elle, que d'avoir « un employeur »... Avec ces copieux mémoires testament, Margaret Atwood tente, enfin, de « bien finir le livre de sa vie », multiple et richement remplie.
Le livre des vies. Mémoires écarlates
Robert Laffont
Traduit de l’anglais (Canada) par Michèle Albaret-Maatsch, Michelle Szkilnik, Nathalie Bru, Anna Gibson, Sarah Tardy et Christine Evain, et coordonné par Michèle Albaret-Maatsch
Tirage: 16 000 ex.
Prix: 25,90 € ; 608 p.
ISBN: 9782221284117