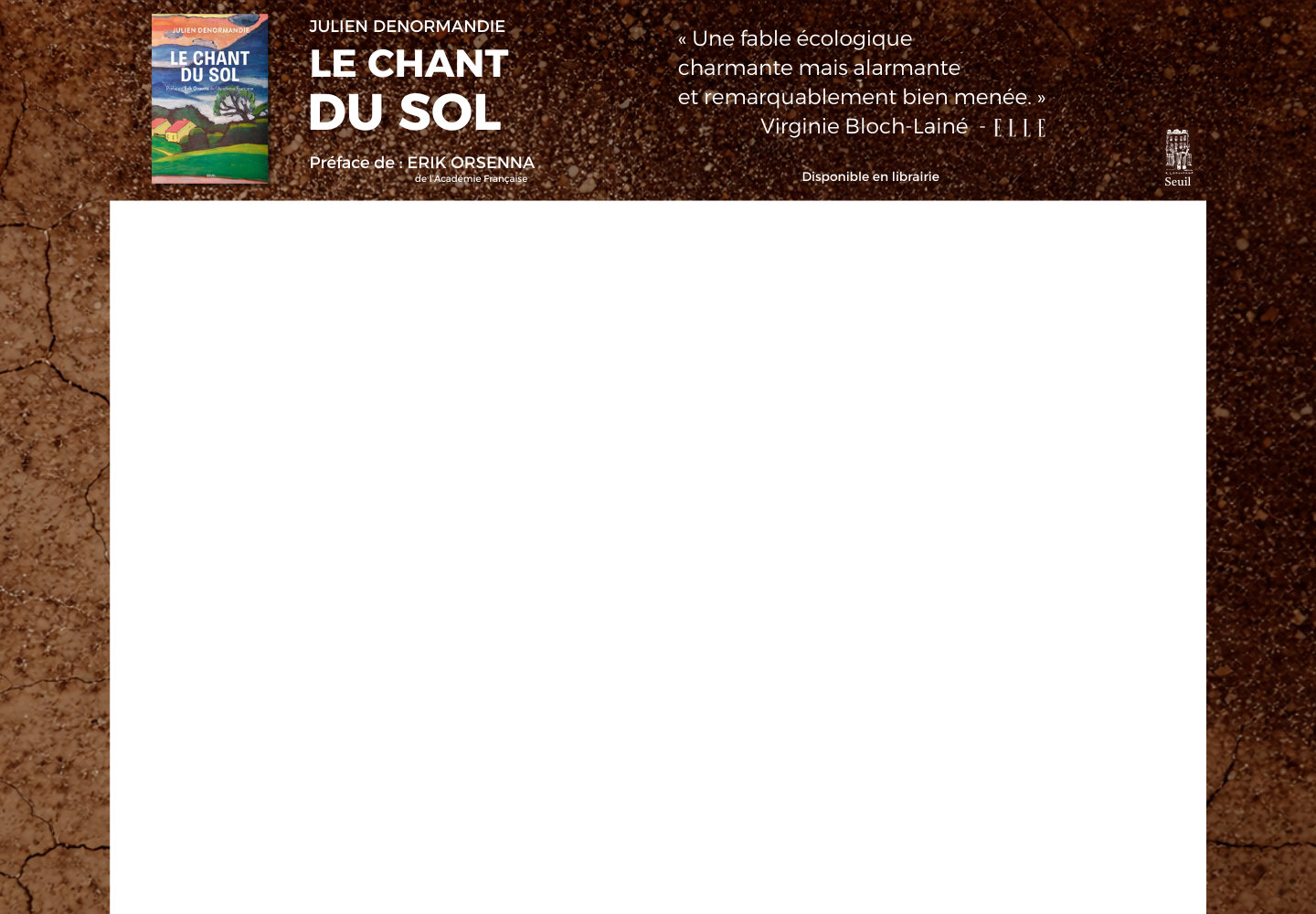High Life, devenu en français La belle vie, a été en 2002 la première publication de la collection "Little house on the bowery", d'une petite maison d'édition américaine, Akashic Books. L'écrivain Dennis Cooper y voit un roman "brillant et féroce", une sorte de "mouton noir". En préface à la réédition du livre en 2008, texte repris dans l'édition française qui paraît dans la "Série noire", Cooper loue les qualités d'un opus qui lui semble aussi important et dérangeant qu'American psycho et Fight club.
Grâce à la traduction d'Antoine Chainas, l'un des plus intéressants auteurs de polars apparus sur la scène littéraire ces dernières années, le lecteur s'apprête à plonger dans un univers particulièrement sombre. Il faut respirer un bon bol d'air frais avant de partir vers un recoin obscur de la Californie, non loin de la jetée de Santa Monica. Là, on trouve à la fois divers déchets humains abîmés par l'alcool et la drogue, et de glorieux représentants de l'industrie du show-business qui paradent.
Jackie, le narrateur de Stokoe, qui avait 5 ans dans les années 1970, est plutôt du genre loser. Ce grand amateur de films, de bières, de cachets et de junk food a un petit boulot au Donut Haven, sur Hollywood Ouest. A Los Angeles, Jackie habite un appartement au second étage d'un immeuble en stuc défraîchi où il a été en ménage avec Karen. Une petite blonde maigrichonne aux cheveux courts qui était junkie et tapineuse. Après avoir disparu pendant quelques jours, Karen a été retrouvée morte dans un parc, et dans un très sale état. Avant cela, la jeune femme avait été capable de beaucoup de choses, comme de monnayer l'un de ses reins...
Cru, sans concession, lancinant, La belle vie parle d'avilissement et de dépendance d'une manière souvent insoutenable. Sous la plume scalpel de Matthew Stokoe, l'usine à rêves de Hollywood broie impitoyablement les faibles.