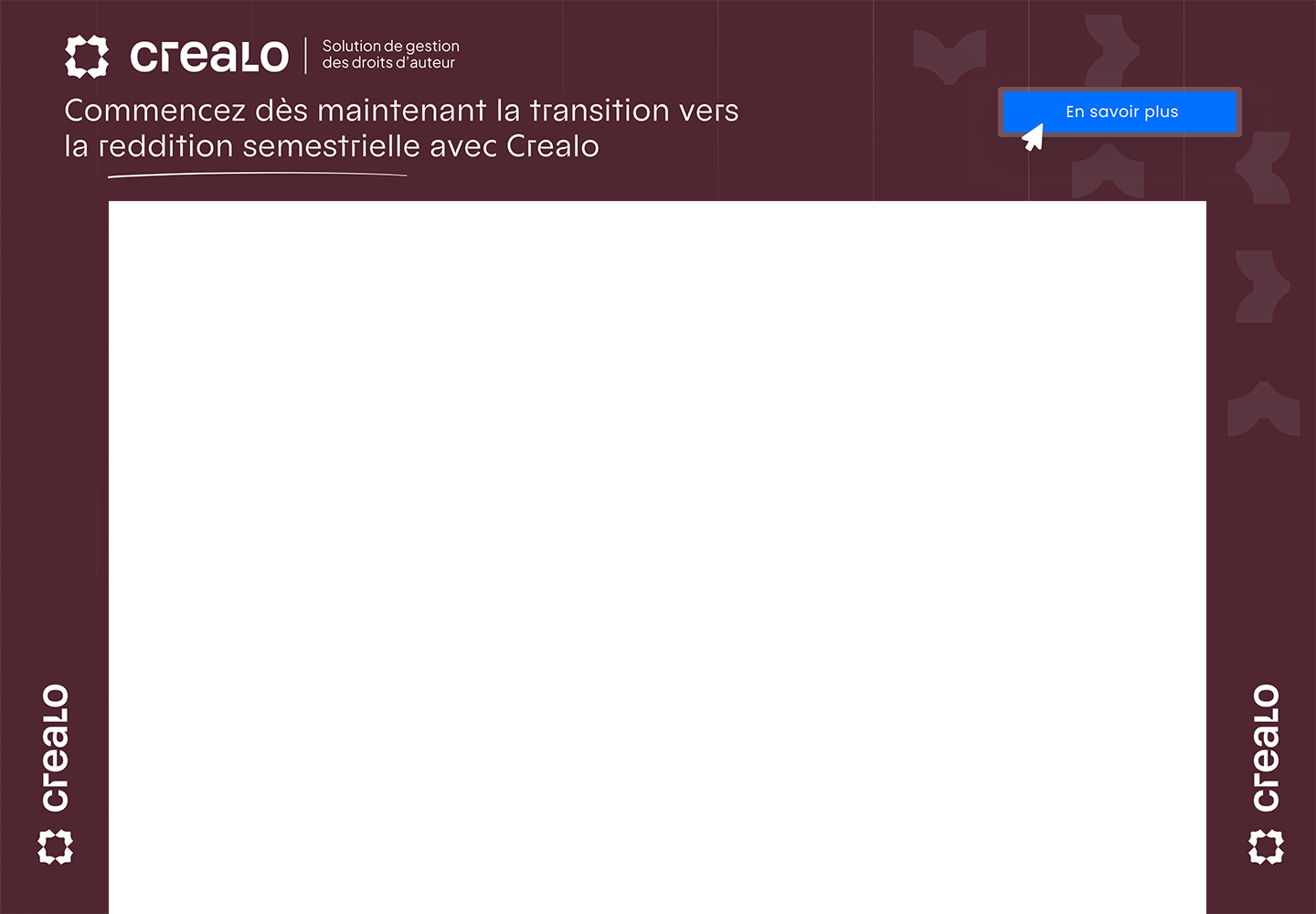Livres Hebdo : Vous revenez avec un nouveau livre dont le titre est une question : « Où trouver la force ? ». Plus encore que dans vos précédents ouvrages, vous proposez ici une philosophie accessible et pratique...
Charles Pépin : Chez les Anciens, Platon, Aristote, les stoïciens, la philosophie se vit de manière concrète. Cela étant dit, en tant que philosophe, j'ai abordé toutes les branches de la philosophie, aussi bien la phénoménologie que l'esthétique ou la métaphysique... Mais oui, j'entends apporter des réponses à des interrogations existentielles, à des problèmes de tous les jours. Dans mes livres, c'est le prof de philo qui parle : j'ai enseigné plus de vingt-cinq ans au lycée, j'avais devant moi des gamins de 17 ans, et ce qui m'a motivé toutes ces années, c'est, par la philosophie, de les aider à vivre, à aimer, à être curieux, à prendre des risques, à faire des choix... L'empreinte de cet enseignement-là se fait ressentir dans ce que j'écris.
Charles Pépin chez lui à Paris- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
En vulgarisant autant, ne craignez-vous pas d'apparaître, vous, l'agrégé de philosophie, comme un auteur de développement personnel ?
Cela ne me dérange pas. J'aime bien chasser sur d'autres terres que celles de la philosophie classique. Le développement personnel, la psychologie, la psychanalyse et, bien sûr, la littérature - mes premières amours - sont autant de terrains de jeu et de réflexion que j'investis. Ma méthode consiste à aller chercher chez les philosophes comme chez les psychologues celles et ceux qui permettent à la vulnérabilité humaine de produire de belles étincelles. Là où je me différencie quand même du développement personnel, c'est que je n'exhorte pas, comme souvent les gourous de la psychologie positive, à se concentrer uniquement sur soi. Plutôt que de se mettre sur un piédestal les yeux rivés sur son propre nombril, je conseille à l'inverse d'avoir les pieds sur terre, d'accepter sa faiblesse et aussi de se tourner vers les autres. Au lieu d'être autocentré et arc-bouté sur ce qui ne va pas, il s'agit d'assumer ses échecs, de ne pas être dans l'évitement et d'avancer.
Les vertus de l'échec (Allary Éditions, 2016) a été paradoxalement votre premier grand succès.
C'est que j'en ai connu pas mal, des échecs, même si ça n'apparaît pas forcément sur le papier. Vous savez, j'ai commencé à publier avec un roman qui n'a pas marché... Puis j'ai écrit des ouvrages pédagogiques, avec un ton de philosophie pop, comme Ceci n'est pas un manuel de philosophie, Une semaine de philosophie, Les philosophes sur le divan... Très vite, le public que je rencontrais dans les librairies ou les médiathèques venait vers moi à la fin de mes conférences et me confiait : « Votre philosophie me fait du bien, elle m'aide à vivre. » Je vous avoue qu'au début, cela me surprenait, je trouvais ça même bizarre. J'avais un sentiment d'imposture, me demandant pourquoi ils me disaient ça : je ne suis pas psy, ni thérapeute ni prêtre... Et je vous assure, cela revenait tout le temps : « Ça fait du bien de vous lire », « Ça fait du bien de vous écouter »... Pendant longtemps, j'ai refusé l'idée, je répondais : « Attention ! La philosophie n'est pas une thérapie, si vous êtes fragile il existe des psychothérapeutes - métier j'admire beaucoup par ailleurs -, moi mon métier, c'est d'être philosophe, romancier, passeur. Peut-être suis-je un frère d'humanité qui cherche des solutions mais je n'ai pas ce pouvoir de vous soigner ni de vous rendre plus heureux. » Avec le temps, j'ai cessé cette fausse modestie, et j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait dans mes livres qui faisait tant de bien aux gens.
Et quelle est donc cette recette magique qui crée un tel engouement pour vos livres ?
Je n'ai pas de jargon, je ne vis pas dans une tour d'ivoire, je ne prends pas les gens de haut, surtout je n'ai pas un très grand surmoi philosophique : je ne sacralise pas les grands philosophes, je prends ce qu'il y a à prendre. Par exemple, je vais lire Hegel, et je vais laisser de côté tel moment et m'intéresser à tel autre du point de vue existentiel et en faire mon miel. Ou chez Spinoza je négligerai des choses métaphysiques qui m'ont passionné en tant que philosophe mais qui ne serviront pas le propos de mon livre, et je trouverai en revanche des choses, notamment sur la joie, qui étaieront exactement ce que j'ai à dire sur ce sentiment. En fait, je vais assumer de faire une philosophie si accessible qu'elle en deviendrait presque thérapeutique.
Comme lors de vos conférences MK2 où vous vous adressez à un auditoire ou quand vous répondez directement à la « question philo » sur France Inter qu'un auditeur vous a envoyée ? Dans Où trouver la force ?, on a l'impression que vous nous parlez personnellement.
Tout à fait, je m'adresse au lecteur, à la lectrice, comme à une personne. Mais si j'aime bien qu'une personne puisse se développer grâce à mes livres, mes podcasts ou mes conférences, je me distingue encore ici du développement personnel, où on est frappé par l'absence totale de pensée politique ! Je suis au contraire bien conscient qu'on ne s'en sortira pas simplement par une bonne philosophie existentialiste individualiste, le problème est aussi social et politique. Et je l'aborde, notamment dans Les vertus de l'échec, où je dis que parfois les individus auront beau appliquer parfaitement ma philosophie de l'échec et du rebond, il y a une telle injustice sociale, un tel déterminisme, un tel déficit des services publics qu'ils seront incapables de rebondir. À la différence des maîtres de la pensée positive qui assènent : « Tout est possible ! », « Quand tu veux, tu peux ! ».
Autre singularité du philosophe que vous êtes : vous aimez vous confronter à la science.
Avant mon livre sur la mémoire, Vivre avec son passé (Allary Éditions, 2023), je faisais moins ce détour par la science. Relire les grands auteurs au tamis des dernières avancées scientifiques m'a beaucoup nourri. Je trouve qu'il est quand même plus sérieux d'inclure la science dans sa réflexion. Quand on parle de mémoire et de cerveau, cela semble difficile de ne faire référence qu'à Bergson ou à Proust, et de faire l'impasse sur ce que disent les neurosciences.
Avant que la mise en bulles de la non-fiction soit devenue une tendance, vous avez cosigné des BD avec Jul. Comment faisiez-vous pour faire passer des idées philosophiques par le dessin humoristique ?
Par l'humour justement ! Ce qui n'empêche pas d'avoir un véritable propos philosophique. Ma collaboration avec Jul a commencé par La planète des sages (Dargaud, 2011). C'était un vrai dialogue, Jul illustrait le concept, moi j'écrivais le commentaire en regard, et les deux pages se faisaient écho dans le rire.
En fin de compte, n'est-ce pas votre côté pop qui plaît tant ? Vous citez dans votre dernier ouvrage aussi bien Gainsbourg que Zlatan Ibrahimović...
Dans mes podcasts sur France Inter « Sous le soleil de Platon », j'invite une vedette de la chanson, une personnalité de la mode, un champion de MMA... et, en les considérant comme des philosophes, je les fais « accoucher » de leur philosophie de la vie. J'ai toujours été comme ça, bien avant qu'on parle de pop philosophie. En terminale déjà, j'allais voir mon prof de philo et je lui demandais si on pouvait dire que Mick Jagger était nietzschéen. À l'époque, j'adorais les westerns spaghetti et quand je regardais un film de Sergio Leone, je me posais la question de savoir si telle réplique de Clint Eastwood à Gian Maria Volonté était platonicienne. Chez moi, cette façon de saisir les choses de la vie quelles qu'elles soient, et de les considérer comme des objets philosophiques, ne date pas d'hier.