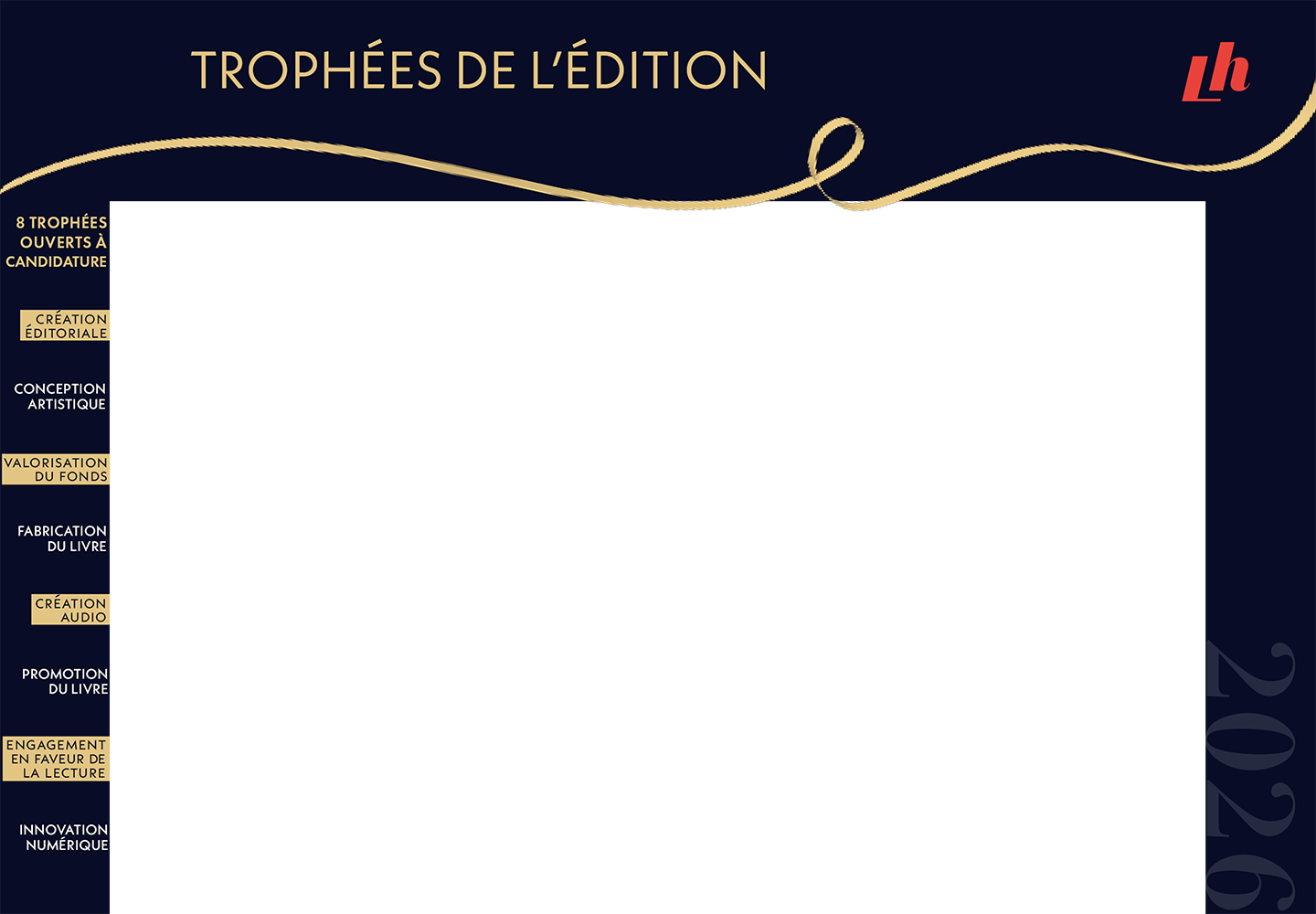Livres Hebdo : Le catalogue des éditions Zulma, publié fin 2024, présente plus de 30 ans d'édition et 45 pays, c'est une grande invitation au voyage. Laure Leroy, quel est votre rapport au voyage ?
Laure Leroy : J'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite, dans le cadre familial. Je pense que cette curiosité de l'autre vient de là. Aujourd'hui, il m'arrive encore, de temps en temps, de faire un grand voyage, mais ce n'est pas du tout par ce biais que je découvre les livres que je publie.
Comment faites-vous pour trouver de nouvelles voix ?
J'ai complètement refondé la maison en 2006, année où j'ai commencé à travailler avec le graphiste anglais David Pearson pour les couvertures. À cette époque, il y avait forcément une démarche très proactive, mais désormais nous sommes submergés de propositions. Par ailleurs, je me donne pour règle d'or - même si j'y déroge parfois - de ne publier que des livres que j'ai lus. Or je ne lis que l'anglais. Pour publier un écrivain de langue tamoule, comme Antonythasan Jesuthasan, dont nous venons de publier un troisième roman, Salamalecs, il a fallu qu'un contact à Pondichéry me signale cet écrivain comme étant la voix la plus originale de toute la littérature en langue tamoule. Il se trouve que certains de ses livres ont été traduits en anglais par des éditeurs indiens. À partir de ce moment-là, mon travail a pu commencer.
Laure Leroy, directrice des éditions Zulma- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Parmi les voix contemporaines que vous découvrez, certaines arrivent jusqu'à la librairie de Veules-les-Roses, Les Mondes de Zulma, ouverte en 2022. Dans le cadre d'une « Saison persane », vous accueillez ainsi des écrivains iraniens en résidence. Amener la littérature persane dans un petit village normand, quel sens cela a-t-il pour vous ?
C'est passionnant à double titre. Tout d'abord, sur le plan intellectuel et humain, pouvoir échanger avec de jeunes écrivains qui publient et vivent en Iran permet de démystifier les préjugés sur ce pays, qui fascine en même temps qu'il fait peur. L'autre aspect intéressant pour les auteurs que nous accueillons, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent écrire pour un autre public que leur lectorat habituel. C'est ce que m'ont rapporté les écrivains iraniens, mais aussi Antonythasan Jesuthasan et le soudanais Abdelaziz Baraka Sakin. Tous deux sont des écrivains de l'exil : avant d'être traduits, ils vivaient en France mais n'incorporaient pas cette idée de lecteurs français dans leur écriture.
« On nous présente souvent des écrivains d'origines diverses, coréennes, iraniennes, nigérianes... Alors que bien souvent, ils sont parfaitement américains par la manière de raconter une histoire »
Votre catalogue compte une trentaine de langues traduites. Cette diversité, c'est un engagement ?
Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qu'on ne connaît pas. Or la littérature étrangère est quasi monopolisée par la littérature anglo-saxonne, avec cette idée que la littérature-monde s'écrit en anglais. On nous présente souvent des écrivains d'origines diverses, coréennes, iraniennes, nigérianes... Alors que bien souvent, ils sont parfaitement américains par la manière de raconter une histoire, les images utilisées, le regard politique sur le monde. Quand on publie quelqu'un qui écrit en tamoul, en arabe soudanais, en persan, ou dans n'importe quelle autre langue du monde, on voit un phénomène totalement passionnant : tous ces gens ont en partage avec nous la culture occidentale mais, en plus, ils apportent tout leur fonds culturel dont nous, nous ignorons à peu près tout. De ces influences, naissent des mélanges incroyables. Les écrivains que nous publions sont ainsi capables d'inventer des modes de narration hyper novateurs, de nous bousculer avec leurs univers.
On parle beaucoup ces dernières années de la difficulté à faire émerger de nouveaux auteurs en littérature étrangère, de ventes en baisse... Partagez-vous ce point de vue ?
Pas nécessairement. Certes, il y a moins de gros best-sellers américains, ou moins de best européens qui viennent de manière ponctuelle diversifier le palmarès des meilleures ventes. Mais pour ce qui est de la littérature de langue tamoule, par exemple, on ne peut que progresser ! Il est vrai qu'il y a dix ou quinze ans, on dépassait plus facilement les 12 000 exemplaires. Aujourd'hui, quand on atteint les 7 000 ou 8 000 ventes, on est contents. Mais on y arrive et on progresse, parce que les libraires et les lecteurs font confiance à Zulma. Ce qu'on fait, bien souvent, c'est ouvrir la voie et montrer que c'est possible. En trois livres d'Abdelaziz Baraka Sakin, on a vendu environ 20 000 exemplaires. Et depuis qu'on l'a publié, au moins deux autres auteurs soudanais ont été traduits. De la même façon, quand on a publié l'islandaise Auður Ava Ólafsdóttir en 2008, il n'y avait qu'Arnaldur Indridason pour le polar et quelques sagas classiques. On a rencontré un énorme succès et aujourd'hui, de nombreuses maisons ont au moins un auteur islandais à leur catalogue.
« Nous avons finalement plus d'atomes crochus avec les littératures de l'imaginaire qu'avec cette littérature du réalisme quotidien »
Vous reste-t-il des littératures à découvrir ?
Il en restera toujours ! À l'automne, on a une nouvelle venue au catalogue, Leta Semadeni, une Suisse de langue allemande, et en octobre on aura le premier auteur traduit du finnois au catalogue, Leena Krohn, avec Datura, un roman très drôle et très profond, sur une fille qui essaye de se soigner au datura, dite « herbe du sorcier ». J'ai mis du temps avant de découvrir Leena Krohn, parce qu'elle est souvent catégorisée comme « reine de l'étrange ». Si je ne l'ai pas croisée tout de suite, c'est aussi parce qu'on est submergés par cette vague mondiale de littérature de l'intime, du soi, de la famille...
Ce qui n'est pas du tout votre ligne...
Pas du tout ! J'ai formulé assez récemment qu'on avait finalement plus d'atomes crochus avec les littératures de l'imaginaire qu'avec cette littérature du réalisme quotidien.
Vous avez aussi, depuis 2013, une collection de poche très active avec 15 nouveautés par an. Quelle place a-t-elle prise ?
Elle marche très bien. Ce qui fait la spécificité de notre collection de poche, c'est qu'on acquiert des droits. La moitié des titres qui paraissent sont des titres parus chez nous, l'autre moitié sont des acquisitions, comme Le cahier rouge du Québécois Michel Tremblay, auteur génial un peu oublié que nous publions en octobre.
Vous développez depuis 2019, de façon plus ponctuelle, une collection d'essais. En octobre paraîtra ainsi Le monde après Gaza, de Pankaj Mishra, traduit de l'anglais par David Fauquemberg. Pourquoi vous être aventurée sur ce terrain ?
En publiant toutes ces littératures du monde, nous sommes déjà dans une démarche militante et politique puisqu'on défend la générosité, l'ouverture à l'autre, la diversité des cultures, le fait que le monde est bien plus vaste que l'Occident. J'ai eu envie que la maison puisse porter une parole dans le débat de la cité, autrement que par la littérature.
Qu'est-ce qui nourrit aujourd'hui votre curiosité, votre envie de publier ?
De même que David Pearson se renouvelle de couverture en couverture, nos livres aussi se renouvellent. À titre personnel, la lecture est un geste essentiel et la littérature, une source vitale. Il y a donc un vrai bonheur joyeux à trouver ensemble des livres qui vous bouleversent, vous secouent, vous emportent. C'est la seule chose qui compte.
L'équipe de Zulma
L'équipe de Zulma, principalement installée dans les bureaux parisiens du XVIIIe arrondissement, s'est renouvelée ces derniers mois avec l'arrivée, en novembre 2024, de Calixta Grigoriou (anciennement Fayard) comme éditrice junior, et d'Agathe Le Faucheur, fin août 2025, aux relations presse, en remplacement d'Antonella Francini. Outre Laure Leroy à la direction générale, Evelyne Lagrange assure la direction adjointe (éditorial et fabrication), de même que Valentin Féron (commercial et promotion), secondés par Sébastien Goullart, assistant commercial, depuis la Normandie.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.