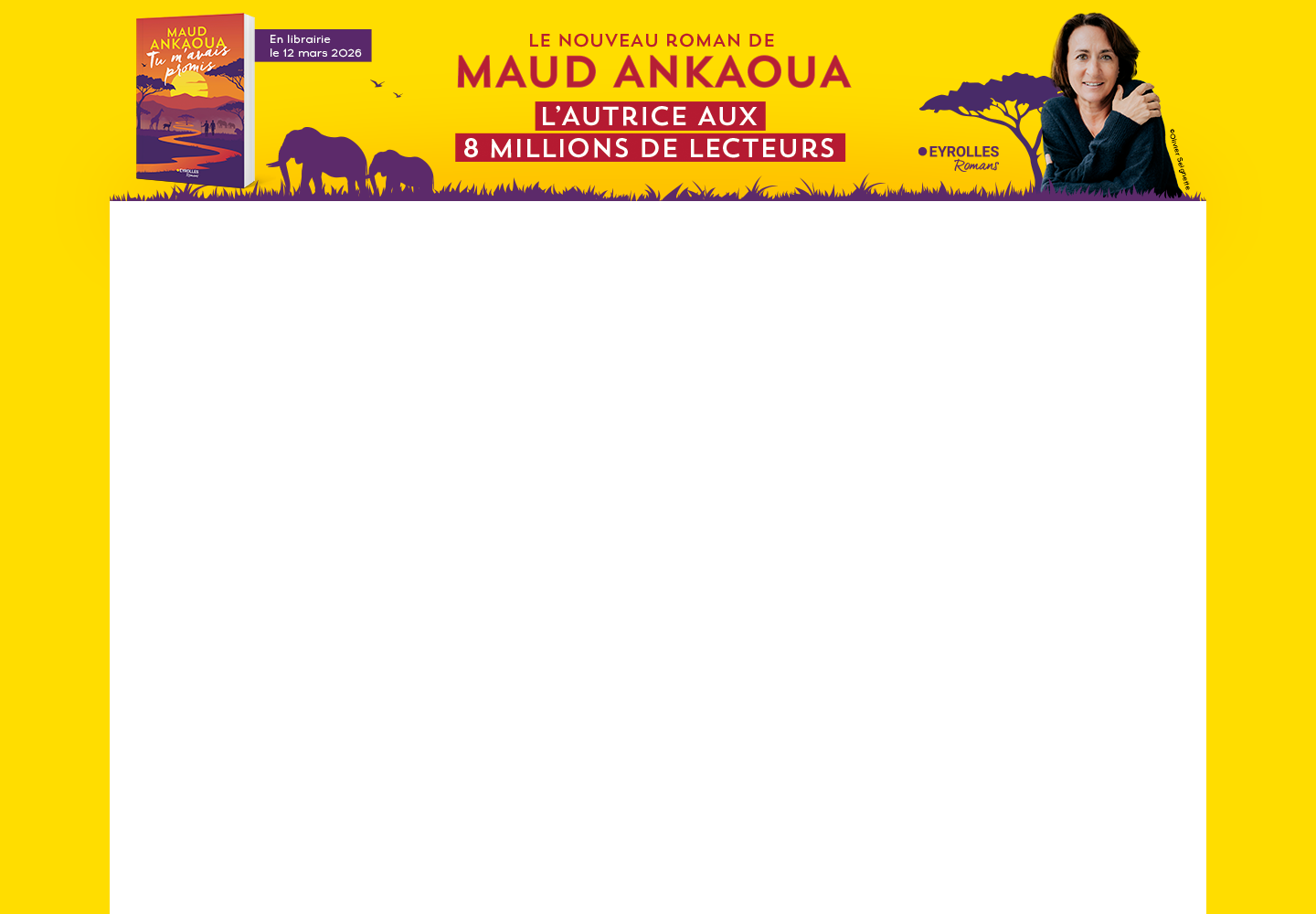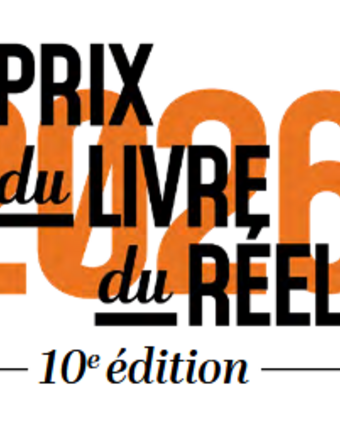Bazin démasqué. À partir de 1948, année de la publication de son premier roman, le fameux Vipère au poing, chez Grasset, Hervé Bazin a tout eu : le succès par le scandale, la fortune, les femmes, les décorations (il a fini commandeur de la Légion d'honneur), les honneurs de ses pairs. Élu à l'académie Goncourt en 1958, il en devint président en 1973 et demeura, jusqu'à sa mort en 1996, omnipotent dans le monde littéraire. Ça, c'est pour le parcours officiel, le narratif qu'il a élaboré et diffusé durant près de cinquante ans, intimidant méchamment ceux qui, comme son oncle paternel Michel, un prêtre, choqués par son livre et sa cruauté envers sa famille, menaçaient de révéler la vérité sur sa vie et de susciter un autre scandale. Même ses biographes n'ont rien su, ou rien dit. On pense à Jean-Claude Lamy, auteur d'un recueil d'entretiens, paru chez Stock en 1992. Disparu récemment, le journaliste avait confié à sa consœur Émilie Lanez qu'il regrettait de n'avoir pas été plus méfiant, plus pugnace. Mais Bazin pouvait se montrer cassant, agressif.
Émilie Lanez, journaliste à L'Express, a décidé, elle, près de trente ans après la mort du célèbre écrivain, de rouvrir son dossier, en commençant par l'élémentaire de toute investigation : les archives de la préfecture de Police. Et ce qu'elle y a découvert est tout bonnement stupéfiant. Partie pour tenter de mieux connaître la mère, l'illustre et détestable Folcoche du roman et, partant, de tenter une réhabilitation (par ailleurs peu convaincante), elle est tombée sur une cascade de faits accablants. Tout, chez Bazin, serait supercherie, mensonge, escroquerie...
À commencer par son nom : il s'appelait en fait Jean Hervé-Bazin, descendant d'une famille de la bourgeoisie angevine, autrefois riche mais ruinée par son père, Jacques, un être faible, maladif, instable, qui ne se passionnait que pour l'entomologie. Ensuite, il n'est pas né en 1917, comme le prétendit Bernard Grasset (lui-même souffrant de troubles psychiatriques et inquiété pour son comportement douteux durant l'Occupation) lors du lancement de Vipère au poing, mais en 1911. Et, surtout, durant toute sa jeunesse, il a commis les pires méfaits : mythomane, kleptomane, cambrioleur, menteur, fugueur... De 1931 à 1946, il a passé sa vie à fuir, voler, mentir, enchaînant les arrestations, les procès, les séjours en prison (la Santé, Clairvaux...) ou en hôpital psychiatrique (dont Sainte-Anne), selon que les juges le considéraient responsable de ses actes ou non. Concernant la guerre, alors qu'il était encore incarcéré (et que sa femme Odette, collabo, s'était portée volontaire pour partir à Berlin), il a prétendu avoir été communiste, résistant et arrêté par la Gestapo. C'est d'ailleurs en prison qu'il a commencé à écrire son autobiographie, À la gloire du bleu, dont Vipère au poing (le seul de ses manuscrits qu'on n'ait pas retrouvé dans ses archives) devait constituer le premier de six volumes. Il s'en est tenu à quatre, jusqu'à Cri de la chouette (Grasset, 1972), dernier acte de sa vengeance contre sa famille, qu'il accusait de tous ses maux.
Jacques était mort en 1944. Paule-Folcoche en 1960, au bord de la folie. Et si la mère et le fils se ressemblaient bien plus que Jean Hervé-Bazin ne voulait le dire ? C'est la leçon finale de l'enquête d'Émilie Lanez, impeccable, passionnante. Il doit y avoir des gens qui savaient et se sont tus...
Folcoche. Le secret de Vipère au poing, enquête sur un meurtre littéraire
Grasset
Tirage: 9 000 ex.
Prix: 19 € ; 192 p.
ISBN: 9782246840497