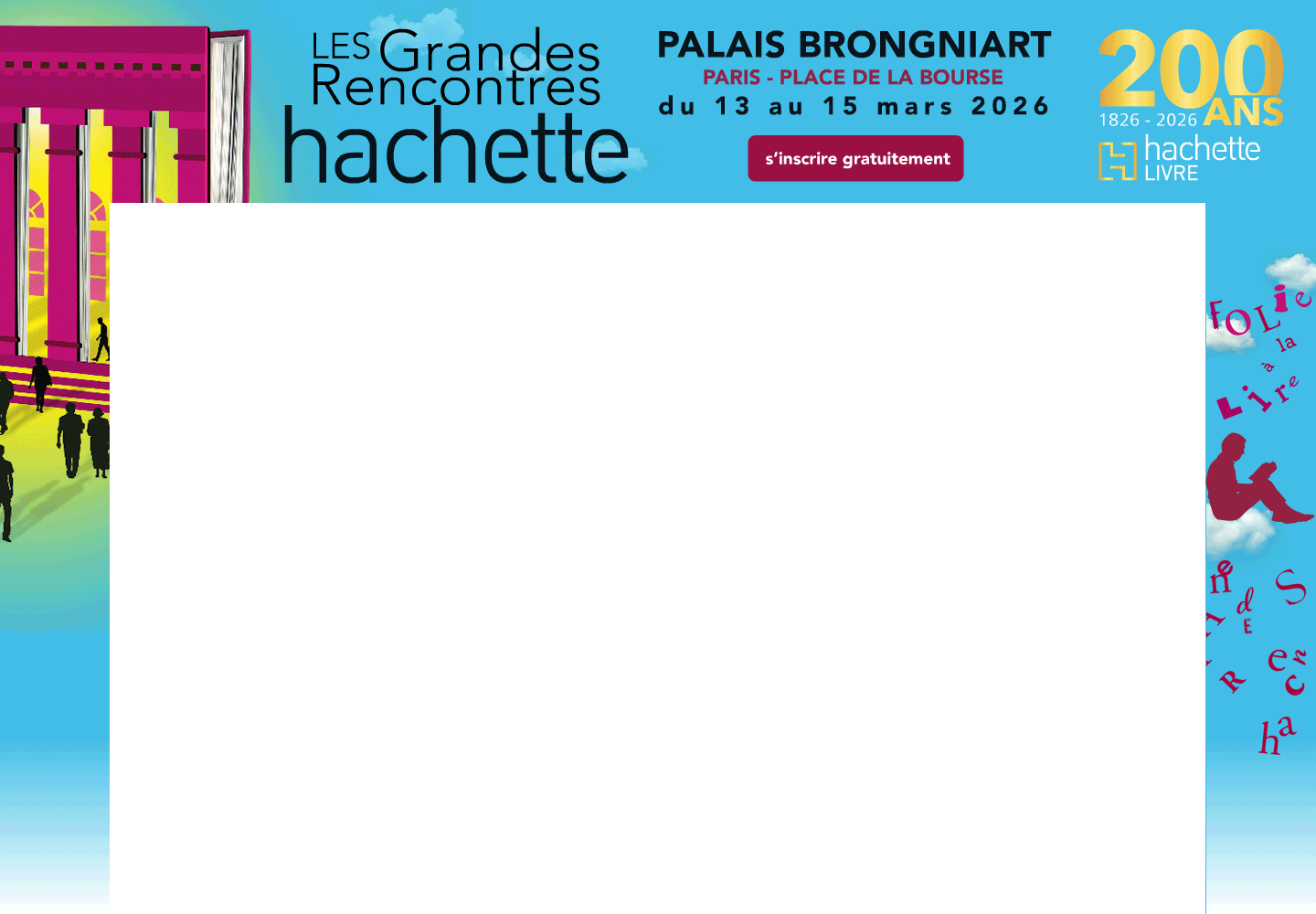Il y a entre Scott Fitzgerald et les beaux jours quelque chose comme un lien de cause à effet. L’an dernier déjà, son entrée au sein de la collection de la « Pléiade » portait le papier bible à « l’indignité » des lectures de plage. Cette année, c’est mieux encore puisque à l’heure où le Festival de Cannes résonnera des échos de l’adaptation nouveau riche par Baz Luhrmann de Gatsby, deux livres, un recueil d’inédits et une biographie, permettront de renouer avec la plus essentielle, noire et profonde des mélancolies du siècle passé.
Depuis sa mort, un soir de décembre 1940, l’action Fitzgerald n’a cessé de coter à la hausse. Et les divers inédits qui sont venus se rajouter au corpus initial, des deux volumes de correspondance (voire trois en comptant celle avec sa fille Scottie) aux Carnets (Fayard, 2002), ont permis de dessiner, loin des facilités vulgaires inscrites entre « dolce vita » et descente aux enfers d’un jeune homme trop doué, le portrait d’un écrivain voué à son œuvre, habité et finalement vaincu par elle.
C’est tout l’intérêt de Fitzgerald le désenchanté, la belle biographie que nous offre Liliane Kerjan, que de rappeler combien, dans la gloire comme dans l’échec, cette exigence portée à son travail fut la première cohérence de l’auteur de Tendre est la nuit. En toutes choses, redécouvrira-t-on, Fitzgerald était sérieux. Sérieusement, il écrivait, il travaillait, il remplissait ses devoirs de mari (ce qui ne fut pas une mince affaire tant, dès les premières années, Zelda s’égara sur les chemins de sa folie) et de père, et tout aussi sérieusement, il buvait, il prenait des vessies pour des lanternes, la Côte d’Azur pour Long Island, Hollywood pour une maison de retraite. Il vécut sa vie avec application et mourut sans faire d’histoires. Il dispersa ses talents comme seuls peuvent le faire les joueurs qui parient que la postérité leur reconnaîtrait du génie. Pour le reste, et Liliane Kerjan s’en fait la greffière scrupuleuse, il ne fut rien d’autre que ce vieil enfant qui se cogne à jamais le nez à un plafond de verre trop haut pour lui.
Il y a de cela, en filigrane, dans Des livres et une Rolls, le recueil de textes inédits, composé pour l’essentiel de portraits et d’entretiens de et avec Fitzgerald, que Charles Dantzig exhume justement (et qu’il préface avec un humour douloureux qui n’aurait pas été sans plaire à son sujet) d’une édition américaine composée par le grand spécialiste de l’œuvre, Matthew J. Bruccoli. Le jeune homme qui répond ici (pris la plupart du temps dans la lumière éclatante de son succès initial) est trop désinvolte pour ne pas avoir la prescience que la promesse du monde lui sera fallacieuse. Les sottises lui sont un paravent contre la médiocrité, sa jeune femme un outil de communication. Un dernier texte nous le montre à 40 ans. Il n’est plus entouré que d’une infirmière et d’une bouteille. Le rideau est déjà tombé. Dans un théâtre d’ombres, la jeunesse joue en pure perte les prolongations.
O. M.