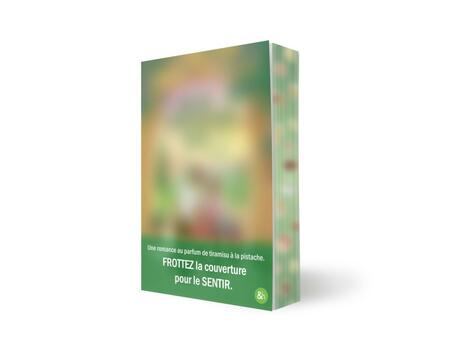Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Nous sommes en 1934. James Joyce, né à Dublin en 1882, a 52 ans. Il vit à Paris, dans une situation matérielle précaire. Aussi saisit-il l’occasion de partir quelque temps à Copenhague, pour se reposer, s’occuper de l’édition danoise de son Ulysse (achevée seulement en 1949, soit huit ans après la mort de l’écrivain) et, surtout, relire les épreuves de l’édition anglaise de ce même Ulysse, imminente, chez Bodley Head. On se souvient que la première, en français et en anglais, est parue chez Sylvia Beach, à Paris, en 1922, grâce à Valery Larbaud et à Gide. Joyce, descendant de Viking, disait-il, parlait danois, aimait bien le Danemark, il s’y trouvait confortable. Il s’inspirera d’ailleurs pas mal du pays et de ses habitants pour son Finnegans Wake, somme délirante laissée inachevée à sa disparition.
En attendant, Joyce, dont l’écrivain-éditeur Charles Dantzig, dans sa préface espiègle, rappelle qu’il a commencé sa carrière littéraire avec un recueil de poèmes, Chamber music, en 1907, suivi, vingt ans après, par Pomes Penyeach - entre-temps, il avait écrit Gens de Dublin et Ulysse, et commencé Finnegans Wake - s’amuse à composer de courts poèmes, et les envoie à son petit-fils, 4 ans à l’époque, qui vivait en France, près d’Annecy. Ce sont des espèces de cartes postales depuis un royaume farfelu sans rien de pourri, où il n’y a ni chats ni policiers, puisque « tous les policiers danois passent la journée au lit chez eux », « […] fument de gros cigares danois et boivent du lait fermenté toute la journée ». En revanche, il y a « des quantités de poisson et des bicyclettes », des petits garçons télégraphistes habillés en rouge, des petites filles dans la lune, et pas de ratons laveurs, semble-t-il.
Un vrai paradis pour les chats, mais, comme on le sait d’emblée, « il n’y a pas de chats à Copenhague ». Manifestement, Joyce se plaît à imaginer un microcosme subversif, où règne le nonsense, dans ce que l’éditeur appelle à raison « un petit manuel d’anarchie à l’usage des enfants », mais pas seulement. On pense à Lewis Carroll, bien sûr, et au jeune Malraux d’Ecrit pour une idole à trompe, grand amateur de chats, lui aussi.
Cette curiosité littéraire jubilatoire méritait bien une édition soignée, ce qui est le cas ici : les dessins de Casey Sorrow sont pleins de malice, l’interprétation graphique et typographique de Jean-François Paga, le directeur artistique de Grasset, inventive. Outre un immense écrivain, Joyce était un grand-papa gâteau, fou de son petit-fils, prénommé Stephen, bien sûr, comme Stephen le Héros, le premier texte autobiographique de l’écrivain en herbe, resté inachevé en 1904-1905. Plus d’un siècle après, l’aïeul poète est célèbre, et son petit-fils veille toujours sur son œuvre. Jean-Claude Perrier