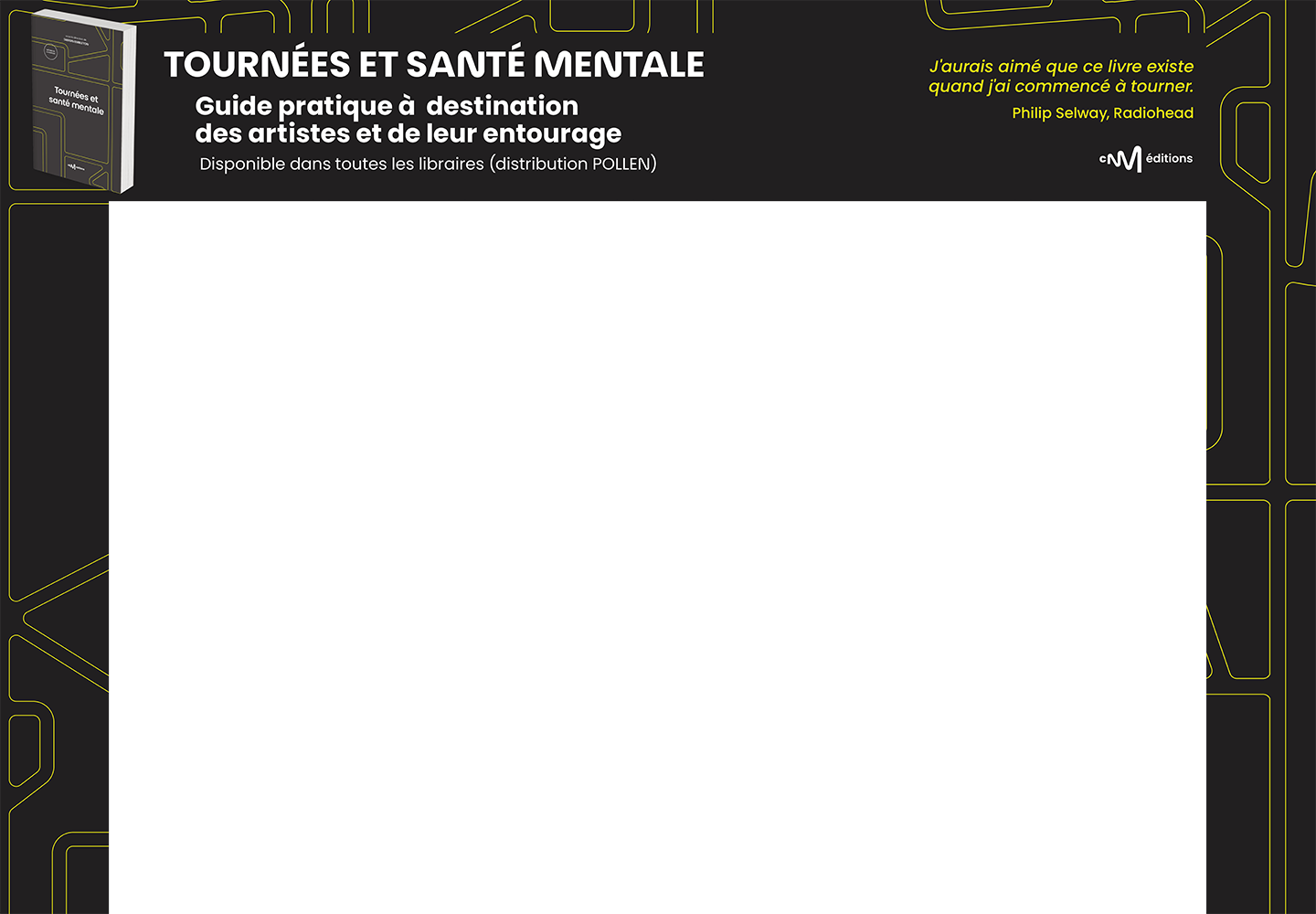Chaque rentrée littéraire, comme les saisons leurs fruits, apporte sa moisson d'autrices et d'auteurs plus ou moins abondante. Certains noms reviennent annuellement (Amélie Nothomb chez Albin Michel, Alain Mabanckou, cette année chez Robert Laffont) ou du moins régulièrement (Yann Queffélec chez Calmann-Lévy, Yves Ravey aux éditions de Minuit, Grégoire Bouillier chez Flammarion) ; d'autres qui ont fait attendre leurs aficionados sont enfin de retour. Ainsi de Jérôme Ferrari à travers son court et incisif roman Nord sentinelle (Actes Sud) : la Corse toujours... mais cette fois sur un mode tragicomique et en mettant en scène des losers dans une île de Beauté aux prises avec le tourisme.
Ou encore de Joël Egloff qui narre dans Ces féroces soldats (Buchet-Chastel) le destin des « malgré-nous », dont celui de son propre père enrôlé de force dans l'armée du IIIe Reich à la suite de l'annexion de sa Moselle native par l'Allemagne nazie... Parmi les retours très attendus, on guettera encore celui de Gaël Faye chez Grasset qui, à travers une saga sur quatre générations, raconte le Rwanda et le génocide des Tutsis au moyen de sa poésie douce et par le truchement de la quête d'un arbre fétiche du pays des mille collines témoin de l'indicible. Jacaranda est le nom de l'arbre et du nouvel ouvrage de l'auteur-compositeur-interprète lauréat du Goncourt des lycéens en 2016 pour Petit pays. Ou celui de Maud Ventura, autrice d'un autre premier roman phénomène, Mon mari, avec Célèbre à l'Iconoclaste.
Vivante métaphore
Kamel Daoud, qui publiait chez Actes Sud, sort son nouveau roman chez Gallimard. Houris fait entendre une femme sans voix - littéralement, puisque rendue muette par une blessure lors des années de plomb en Algérie. L'héroïne est une métaphore vivante des atrocités d'une guerre civile tue par un régime qui ne cesse de commémorer sa résistance contre le colonisateur français tout en interdisant de mentionner les exactions fratricides des années 1990. Enceinte d'une fille, elle porte aussi l'avenir d'un pays dont elle espère qu'il puisse recouvrer sa libre expression.
Julia Deck, Ann d'Angleterre, Seuil- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
De quoi parlons-nous, au juste ?
Mais comme pour les saisons de la mode, l'observateur de la vie littéraire, qu'il soit libraire, bibliothécaire ou critique, cherchera, mutatis mutandis, à dégager les tendances.
La littérature reflète le génie des temps présents, le zeitgeist, qui nous tend un miroir de nous-mêmes en tant qu'époque et société et, par l'art du roman, nous plonge dans les contradictions et les complexités de notre âge. De notre être, nos parts d'ombre, parfois héritées. Mais certaines choses restent des constantes dans les rentrées, les grands thèmes de l'amour, de l'amitié, de la trahison sont sempiternels et la plus grande fabrique de névroses demeure la famille. Raconter ses aïeux, ses parents, sa fratrie trouve chaque rentrée une incarnation livresque. Thibault de Montaigu passé chez Albin Michel s'interroge dans Cœur sur l'héritage d'une destinée héroïque. Angoisse du poids de la vie qu'on donne dans un monde en voie d'extinction, charge ambiguë qu'on porte en tant que mère et femme, Avril Ventura interroge la maternité et la transmission dans La meilleure part d'eux-mêmes (Alma). Féminité, maternité, sexualité... Ces thèmes traversent et relient tel un fil rouge les pages du nouvel Emma Becker chez Albin Michel, Le mal joli.
Maylis de Kerangal dédicace Jour de ressac (Verticales) rue Gaston-Gallimard.- Photo YVES PAGÈSPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Dans son roman Vivre à ta lumière (Seuil, 2022), Abdellah Taïa avait fait le portrait de la femme puissante qu'était sa mère ; dans Le bastion des larmes qui paraîtra chez Julliard, il rend grâce à l'ouateuse présence de ses six sœurs dans le Maroc de son enfance. Par le biais d'une construction à double ellipse, alternant les points de vue d'un aîné et d'un cadet et avec un va-et-vient sans doute plus fictionnel entre passé et présent, Écosse et Suisse, Nicolas Garma-Berman signe un deuxième roman, L'épaisseur de l'aube (Belfond), qui tient les promesses stylistiques de son premier, La fille aux plumes de poussière, paru en 2022 chez le même éditeur.
Clémentine Mélois est la malicieuse héritière de la créativité paternelle, et déploie un bel hommage à son père artiste dans un récit plein de bonne humeur excentrique (Gallimard, « L'Arbalète »). Alors c'est bien relate « l'enterrement de pharaon » qu'elle prépare à son paternel sculpteur qui vient de mourir.
D'autres écrivains se saisissent de personnages littéraires et historiques célèbres ou oubliés. Pavese et son suicide à Turin inspirent à Pierre Adrian un roman empreint de l'atmosphère des films d'Antonioni qui avait porté à l'écran Femmes entre elles de l'écrivain italien. Christophe Bigot écrit la toute dernière passion de Marguerite Yourcenar, pour un photographe new-yorkais gay, de 46 ans le cadet de l'autrice des Mémoires d'Hadrien, dans Un autre m'attend ailleurs (La Martinière). Clémence Boulouque, dans Le sentiment des crépuscules (Robert Laffont), mêle les vies de figures historiques (Stefan Zweig, Salvador Dalí, Sigmund Freud...) tout en faisant la chronique de la fin d'un monde rédimée par les facéties de l'artiste surréaliste. Isabelle Pandazopoulos, romancière de fiction pour adolescents, signe un texte sur l'incroyable itinéraire de la benjamine des enfants de Freud, Anna, vilain petit canard et précurseure de la psychanalyse de l'enfance.
Olivier Guez, avec Mesopotamia (Grasset), nous entraîne dans les tribulations de l'archéologue et espionne britannique Gertrude Bell, et dans l'Orient du lendemain de la Première Guerre mondiale. Passant du roman policier à la blanche, Olivier Norek fait revivre la résistance du peuple finlandais face à l'armée soviétique dans Les guerriers de l'hiver (Michel Lafon). Dans La première histoire (Albin Michel), Frédéric Gros, quant à lui, revisite l'aube de notre ère grâce à Théoklïa, jeune patricienne de la colonie romaine d'Iconium, « première prodige de l'histoire chrétienne » qui rompt ses fiançailles pour suivre saint Paul...
Arts de l'histoire
Mais d'histoire il n'en est nulle qui intéresse plus les écrivains que celle qui se déroule sous nos yeux, ou plutôt nous entraîne dans son mouvement. Un goût du romanesque, oserait-on dire à l'ancienne, jamais disparu dans la fiction traduite de l'anglais ni dans la littérature dite de genre vient vivifier la rentrée. Le prouve un premier roman étonnant tant par sa facture que son histoire, Le Juif rouge de Stéphane Giusti chez Seghers, une réinterprétation luxuriante d'un mythe ashkénaze qui fait voyager le lecteur des tranchées de la Roumanie de 1917 aux camps de la mort en Pologne, en passant par les pogroms en Ukraine...
Cette patte romanesque, le lauréat du prix Orange du livre 2020 Guillaume Sire la réaffirme sans ambages avec son sixième roman Les grandes patries étranges (Calmann-Lévy), histoire d'amour impossible entre un jeune garçon hypersensible doué de clairvoyance et une Juive aux oreilles de lutin et au verbe piquant sur fond de Seconde Guerre mondiale...
La société est encore le meilleur matériau littéraire pour maints épigones de Balzac, ambitionnant de peindre une fresque totalisante plutôt que de triturer les replis de leur ego. En écho avec la faillite des partis sociaux-démocrates de par le monde ou leur incapacité à endiguer la vague populiste qui gagne nombre de démocraties libérales, Aurélien -Bellanger, anatomiste de l'état de la France, signe en cette rentrée un livre au titre provocateur (ou est-ce pour déjouer le sort ?), Les derniers jours du Parti socialiste (Seuil). L'auteur de Téléréalité s'empare ici de son sujet de prédilection : la politique. Romancier réaliste ne signifie pas moins romancier ; Bellanger nous gratifie de son talent d'invention fictionnelle et nous fait la politesse de servir une intrigue captivante sur fond d'obsession sécuritaire...
Comptant également parmi la relève réaliste, Abel Quentin, dont Cabane (L'Observatoire) est le troisième roman, signe une fiction climatique autour d'un certain « Rapport 21 » rédigé par quatre chercheurs californiens et commandé dans les années 1970 par un think tank social--démocrate afin d'« analyser les causes et les conséquences à long terme de la croissance sur la démographie et sur l'économie mondiale ». À la manière des Illusions perdues, on voit comment d'aucuns, renonçant à leurs idéaux, abdiquent leur combat pour la planète...
Les stratégies du choc
Nous sommes immortelles, le deuxième roman de Pierre Darkanian chez Anne Carrière, se départit du naturalisme et le dévoie en y instillant un chouïa de fantastique et d'anticipation.
Hors le besoin de témoigner du réel par une veine réaliste, fût-elle parfois magique, voire non dénuée d'humour, il est intéressant de constater en cette rentrée non seulement un retour mais une rupture chez certains écrivains, en l'occurrence écrivaines, d'avec ce à quoi elles nous avaient habitués. Maylis de Kerangal s'était déjà aventurée dans la narration à la première personne dans une des nouvelles du recueil Canoës. Ici dans Jour de ressac (Verticales), et quoique par le biais d'une enquête, elle assume à nouveau cette écriture de l'intime, en évoquant la ville qui la fit - Le Havre.
De même pour Julia Deck, dont les romans chez Minuit étaient des petits bijoux d'intrigue ; dans Ann d'Angleterre à paraître au Seuil, l'autrice de Monument national parle avec à la fois sincérité et pudeur de sa mère anglaise victime d'un accident cérébral. Le choc émotionnel deviendra le point de départ d'une enquête sur cette femme dont la narratrice est si proche, et qui fut durant toute l'enfance de cette dernière si secrète. Cette évolution dans l'écriture correspond-elle à une forme de maturité assumée, une seconde manière dans l'œuvre ? À suivre... En tout cas, à lire sans conteste ! S. R.
Thèses ? Antithèses ? Synthèses ?
« Littérature engagée »... cette expression aux accents sartriens s'est incarnée littérairement bien avant l'essai du philosophe existentialiste Qu'est- ce que la littérature ? De l'affaire Calas qui fit prendre sa plume à Voltaire pour rédiger son Traité sur la tolérance à la lettre ouverte de Zola « J'accuse... ! » contre l'inique condamnation du capitaine Dreyfus en passant par Voyage au Congo de Gide dépeignant la brutalité du système colonial... Les mots des écrivains servent une cause qui dépasse les mots mêmes. Anticolonialisme, résistance aux totalitarismes, dénonciation des injustices sociales, égalité des sexes... Si les auteurs s'engagent le plus souvent à travers les essais, le roman n'a pas moins été le truchement des causes qu'ils défendent. Tels les romans de Sylvie Germain, où se devinent les convictions de l'autrice d'À la table des hommes - sacralité du vivant, intime solidarité entre l'humain et l'animal. En cette rentrée, Carole Martinez, dans Dors ton sommeil de brute (Gallimard), imagine une femme ayant fui le foyer qui entend chaque nuit un effroyable cri s'exprimant collectivement à travers les cauchemars de tous les enfants dans la ville. Comment ne pas y lire une fable sur l'urgence climatique et l'angoisse étreignant celles qui donnent la vie dans un monde en péril... La fiction contemporaine s'empare depuis quelques années de sujets qui ont émergé dans le contexte de #MeToo ou sur fond de crise climatique. La mondialisation, une société plus métissée, plus fluide, la fin des grands récits mais aussi la résurgence, par réaction, des spectres du nationalisme, inspirent écrivaines et écrivains qui, à travers des histoires vécues ou des récits fictifs, témoignent de la réalité. Mais on atteste aujourd'hui, semble-t-il, une seconde phase qui dépasse la pure littérature de dénonciation. Le non-binaire ne concerne plus uniquement le genre mais aussi le domaine des lettres, où du reste les genres littéraires eux-mêmes tendent à se mêler. Face aux mutations nouvelles, aux statues du commandeur déboulonnées, le romancier subtil, l'autrice clairvoyante n'entendent pas toujours faire œuvre d'illustration d'un nouveau catéchisme. Il ne s'agit plus d'être un « Persan », c'est-à-dire d'être l'étranger ou l'exclu, l'Autre, qui regarde et pointe des systèmes mal déconstruits pour déployer un vrai regard critique. Un certain retour sur soi-même confronté à ses propres biais, vigilant vis-à-vis d'anathèmes épidermiques... L'incarne superbement le roman d'Abdellah Taïa, Le bastion des larmes (Julliard), qui évoque à la fois le gynécée des sœurs au sein duquel il a grandi et son homosexualité dans un Maroc de la débrouille, aux prises avec les inégalités sociales, les dogmes de la religion, le patriarcat ancestral... C'est violent (les viols, les forfaitures sont monnaie courante) et tendre à la fois (moments de joie partagés devant les films égyptiens, caresses prohibées salvatrices), mais jamais l'écrivain franco-marocain ne condamne. Néanmoins, la douleur ici n'est pas aigre et son regard enveloppe d'une étonnante mansuétude des années de grande dureté.
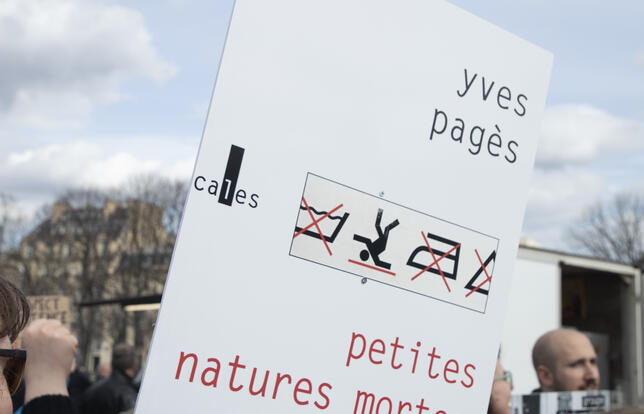
Pareillement, dans L'extase, premier roman de Monia Aljalis (Seuil), l'héroïne Leyla erre une journée entière dans la ville en quête de plaisir sensuel, tiraillée entre sa liberté de femme et la tradition arabo-musulmane, pudique pour ne pas dire culpabilisante pour le « deuxième sexe », dans laquelle elle a été élevée. Poétique incantation d'un voyage au bout de la nuit du désir, suspendu, sans jugement tranché, tel un flottement entre les eaux du fantasme et de la réalité... Toujours au Seuil, dans son premier roman Le bleu n'abîme pas, Anouk Schavelzon interroge le regard masculin et tente de déjouer les fantasmes des hommes sur son corps métisse. Alors que chez Stock, Daphné Tamage dans Le retour de Saturne passe carrément un mois à les éviter.

Des larmes aux rires
À la rentrée d'août-septembre, on note le retour d'Aurélien Bellanger qui publie au Seuil Les derniers jours du Parti socialiste. Si le titre peut fleurer le roman à thèse, l'analyse de la déconfiture de la social-démocratie n'a pas ni le ton du réquisitoire ni celui du manifeste. L'auteur de La théorie de l'information (Gallimard, 2012), comme un digne héritier de Michel Houellebecq (première période, à savoir les particules identitaires en moins), se fait ici topographe d'un territoire politique en déshérence. L'intrigue se déroule dans le climat sécuritaire qu'entretiennent certains politiques à la suite d'attentats islamistes en réaction à la publication de caricatures... Bellanger nous fait tourner les pages au moyen d'un trio machiavélique (deux philosophes mégalos et sans scrupules, et un membre du PS de seconde division se sentant investi de la mission de sauver la République) qui ourdissent un plan pour renverser la table.
Last but not least, Nous sommes immortelles (Anne Carrière), deuxième roman de Pierre Darkanian, réussit avec brio une critique de la post-critique, c'est-à-dire en s'amusant des limites de la déconstruction. Son tour de force et son originalité consistent à injecter de la satire et du fantastique dans une fiction sur l'écoféminisme. Les personnages principaux sont une mère et sa fille, toutes deux de véritables sorcières, et habitantes du quartier de la Goutte-d'Or à Paris, visage d'une France créolisée et contemporaine. L'auteur du Rapport chinois, qui tournait en dérision l'entropie dans les grandes entreprises écrasées par d'ineptes organigrammes et des armées de consultants, retrace la généalogie du combat des femmes, de Vincennes à la Californie, de la militance lesbienne des années 1970 aux sectes les plus radicales outre--Atlantique dévoyant la French Theory... Avec la drôlerie caustique d'un Swift, et sans aigreur anti-woke, Darkanian dépeint les dérives possibles du -dogmatisme quel qu'il soit et prouve que le rire est le propre de l'homme et de la femme. S. R.
Leur parole était au commencement
Un peu moins de bourgeons éclosent à l'heure de la rentrée littéraire. La moisson est quand même de 68 premiers romans parmi les 311 romans français publiés d'août à octobre. Une fournée légèrement plus restreinte que celle de l'an dernier (74). L'immense majorité des maisons d'édition choisissent de ne planter dans le monde du roman qu'une seule graine - alors qu'Arléa et Fayard osent trois pousses chacun. Ce sont en tout 58 éditeurs qui lancent de nouveaux talents. Les femmes prédominent toujours dans cette catégorie, au nombre de 38 contre 30 hommes soit 56 % (55 % l'an passé).
De la scène à la plume
Les nouveaux romanciers nous arrivent de divers milieux professionnels. Le monde du journalisme en regroupe de nombreux, comme Sophie Gallé-Soas (L'homme au corbeau, Arléa), Simon Fichet (Tornade, Marchialy) ou encore Pascale Tournier (Une double faute, Cherche midi). D'autres foulent les planches des théâtres, comme Marie Khazrai (Poupées roumaines, Les Avrils) et Damien Lecamp (Un père sur le banc, Léo Scheer). Plusieurs professeurs répondent également à l'appel : Camille Santerre (Les lumières de Kilchurn, Hurlevent), Sonia Hanihina (Le tube de Coolidge, JC Lattès). S'y ajoutent les poètes avec, entre autres, Gabriel Gauthier (Space, Corti), Célestin De Meeûs (Mythologie du .12, éditions du sous-sol), Alix Lerasle (Du verre entre les doigts, Castor astral).
Écoféminismes
Du vers au vert, il n'y a qu'une lettre et beaucoup d'inspiration. L'écologie est l'un des thèmes qui se dégagent en cette rentrée. Dans le roman Les jardins de Mandela, de François-Xavier Cottin (Fayard), un professeur en ZEP lutte avec ses élèves contre le délitement de l'établissement et la menace de destruction du jardin de leur club nature. Dans la même branche, avec Le Buzuk (Viviane Hamy), Marie Kelbert raconte l'histoire d'une femme de 70 ans qui milite contre la création d'un golf sur son île de Bretagne et devient, avec son chien, la mascotte des zadistes locaux.
Ailleurs, le féminisme se teinte d'anticipation. Dans Mélusine reloaded, de Laure Gauthier (Corti), la fée est de retour dans un monde post-démocratique aseptisé et pollué. Une fable féministe sur fond de dystopie écologique. Avec Fragile/s (Au diable Vauvert), Nicolas Martin signe un roman où l'extrême droite a pris le pouvoir tandis que la fertilité masculine s'est effondrée. Huit enfants sur dix sont de sexe féminin, et trois garçons sur cinq sont atteints du syndrome de l'X fragile. Plus contemporain, L'extase de Monia Aljalis au Seuil suit la vie parisienne de Leyla à travers les bars, les boîtes, les amis, les amants. Et la confronte à une famille traditionnelle arabo-musulmane peu encline à approuver la rage de liberté de leur fille. Le sujet de la famille dysfonctionnelle (ou non) apparaissant comme un fil rouge parmi tous les premiers romans de cette rentrée littéraire.
Des combats historiques
Marquée par le retour de la guerre à nos frontières, cette rentrée s'intéresse aux sujets historiques et politiques. Le Juif rouge de Stéphane Giusti (Seghers) raconte le périple du Roumain Aaron Tamerlan Munteanu, qui endure le destin des siens face à l'antisémitisme et les guerres, de 1917 à la Shoah. Toujours durant la Seconde Guerre mondiale, Les francs-tireuses d'Emmanuelle Hutin (Anne Carrière) rend hommage aux figures artistiques parisiennes Claude Cahun et Suzanne Malherbe, qui mènent une contre-propagande poétique en diffusant des tracts signés « le soldat sans nom » afin d'inciter les conscrits allemands à baisser les armes. A. M.
La montée des marges
En fiction étrangère, la rentrée voit large, ouvrant ses horizons aux marges - communautaires, linguistiques - et aux formes littéraires les plus variées. Si les maisons mettent à l'honneur de nombreux primo-romanciers, elles misent aussi sur des valeurs sûres, à l'instar des Américains Richard Ford (L'Olivier) et James Ellroy (Rivages), de l'Égyptien Alaa El-Aswany (Actes Sud), ou encore de l'Irlandais Colm Tóibín, qui offre dans Long Island (traduit par Anna Gibson, Grasset) des retrouvailles avec Eilis Lacey, l'héroïne de Brooklyn.
Les éditions du Seuil misent sur Un jour d'avril (traduit par David Fauquemberg), de Michael Cunningham (Prix Pulitzer 1999 avec Les heures), tandis que Gallimard renouvelle sa confiance à Nathan Hill pour Bien-être, et accueille Nino Haratischwili pour La lumière vacillante (traduit par Barbara Fontaine). Quatorze ans après La porte des larmes, Flammarion défend Le pacte de l'eau d'Abraham Verghese (traduit par Paul Matthieu), ainsi que Le dernier rêve, de Pedro Almodóvar (traduit par Anne Plantagenet).
Plusieurs romancières phares éclairent aussi cette rentrée, notamment chez Gallmeister où Ayana Mathis opère son grand retour avec Les égarés. Prix Femina 2022, Rachel Cusk signe Parade (traduit par Blandine Longre, Gallimard), qui aborde lui aussi la maternité.
Du Nord aux Sud
Si les traductions de l'anglais restent majoritaires, les fictions européennes ont la cote. Plusieurs maisons soutiennent des plumes finlandaises, comme Iida Turpeinen avec À la recherche du vivant (traduit par Sébastien Cagnoli, Autrement), ou Pirkko Saisio, qui se raconte dans À contre-jour (traduit par Sébastien Cagnoli, Robert Laffont), à la manière d'une Deborah Levy finlandaise.
La littérature italienne se révèle aussi très attractive, comme en témoignent Les merveilles de Viola Ardone (traduit par Laura Brignon), star d'Albin Michel en cette rentrée, ou encore La vie qui reste, premier roman de Roberta Recchia, à paraître chez Istya & Cie dans une version d'Elsa Damien, traductrice d'Elena Ferrante. D'autres voix italiennes se font entendre, dont celles de Maria Grazia Calandrone, finaliste du prix Strega en 2023 pour Ma mère est un fait divers (traduit par Nathalie Bauer, Globe), de Marco Lodoli avec Si peu (traduit par Louise Boudonnat, P.O.L), et de Cristina Comencini pour Hors-champ (traduit par Béatrice Robert--Boissier, Stock). J'voulais naître gamin, de Francesca Maria (Liana Levi), est traduit du napolitain par Audrey Richaud.
Car cette rentrée fait la part belle aux langues romanes, comme le catalan. Ainsi, Verdier publie Mammouth d'Eva Baltasar (traduit par Annie Bats), quand le Seuil publie Je t'ai donné des yeux et tu as regardé les ténèbres d'Irene Solà (traduit par Edmond Raillard), qui nous conduisent dans les Pyrénées. Autre exemple aux Argonautes, où paraît Junil de Joan-Lluís Lluís (traduit par Juliette Lemerle), une épopée dans l'Empire romain d'Auguste. Composé en galicien par Teresa Moure, avant qu'elle ne le réécrive en castillan, La morelle noire (traduit par Marielle Leroy, La Contre-Allée) met en scène des femmes qui s'affranchissent du modèle patriarcal.
Western et dystopies féministes
De personnages féminins forts, cette rentrée en regorge. Ainsi Mariana Enríquez est de retour aux Éditions du sous-sol avec La petite sœur. Un portrait de Silvina Ocampo, figure majeure de la littérature argentine. Dans Blackouts de Justin Torres (L'Olivier), le narrateur fait des recherches sur Jan Gay, une anthropologue lesbienne dont le travail a été bafoué. Femme oubliée de George Orwell, Eileen O'Shaughnessy est quant à elle au cœur de L'invisible madame Orwell d'Anna Funder (traduit par Carine Chichereau, Héloïse d'Ormesson). Dans le même temps, Sandra Newman propose avec Julia (traduit par Hélène Cohen, Robert Laffont) une relecture de 1984, imaginant la vie des femmes dans cet univers mythique.
Le patriarcat en prend ainsi pour son grade dans nombre de romans, comme Saison toxique pour les fœtus de Vera Bogdanova (traduit par Laurence Foulon, Actes Sud), ou Je ne veux pas d'Eva Aagaard (traduit par Marina Heide, Denoël).
Aux frontières du réel, Hexes d'Agnieszka Szpila (traduit par Cécile Bocianowski, Noir sur blanc) suit une femme filmée faisant l'amour à un arbre puis « téléportée » au XVIIe siècle avec un groupe de femmes qui vénère la terre. Un programme non moins électrique attend les lecteurs de 11 % de Maren Uthaug (traduit par Marina Heide, Gallmeister), qui imagine un monde où il ne reste que 11 % de la population masculine. Réinterprétation féministe du western, L'affranchie de Claudia Cravens (Les Escales, traduit par Carine Chichereau) pousse les portes d'un bordel tenu par des femmes.
Nouveaux mondes
Dans une mise en abyme des marges, la communauté queer est au cœur de plusieurs fictions, ouvrant des fenêtres sur des réalités méconnues. Finaliste du Man Booker Prize, Sang Young Park aborde dans S'aimer dans la grande ville (La Croisée, traduit par Kyungran Choi et Pierre Bisiou) des sujets rares dans la littérature coréenne, comme l'homosexualité et le sida. Les larmes rouges sur la façade de Navid Sinaki (traduit par Sarah Gurcel, Le Bruit du monde) livre l'histoire d'amour de deux hommes dans le Téhéran contemporain. Chez Denoël, American boys de Khashayar J. Khabushani (traduit par Charles Bonnot) brosse le portrait d'un jeune gay dans une famille d'immigrés iraniens en Californie.
À travers le regard de protagonistes issus des minorités, de nouvelles géographies se dessinent. Une mythologie originale de New York émerge dans Les fantômes de Brooklyn (Calmann-Lévy), premier roman de l'auteur afro--américain Tyriek White, quand Safiya Sinclair, issue d'une famille rastafari, fait le récit de son destin et de son pays, la Jamaïque, avec Dire Babylone (traduit par Johan-Frédérik Hel Guedj, Buchet-Chastel). Autre monde peu traité, celui du peuple des Aïnous, qui est au cœur de Source de chaleur de Sōichi Kawagoe (traduit par Patrick Honnoré, Belfond).
L'étrange surgit également, par exemple chez Julliard, qui publie L'envol des lucioles d'Abubakar Adam Ibrahim (traduit par Marc Amfreville), un portrait du Nigeria empreint de réalisme magique. Du côté de Zulma, La bedondaine des tanukis d'Hisashi Inoue (traduit par Jacques Lalloz) met en scène des ratons laveurs qui se métamorphosent en divers objets, voire en humains... S. L.