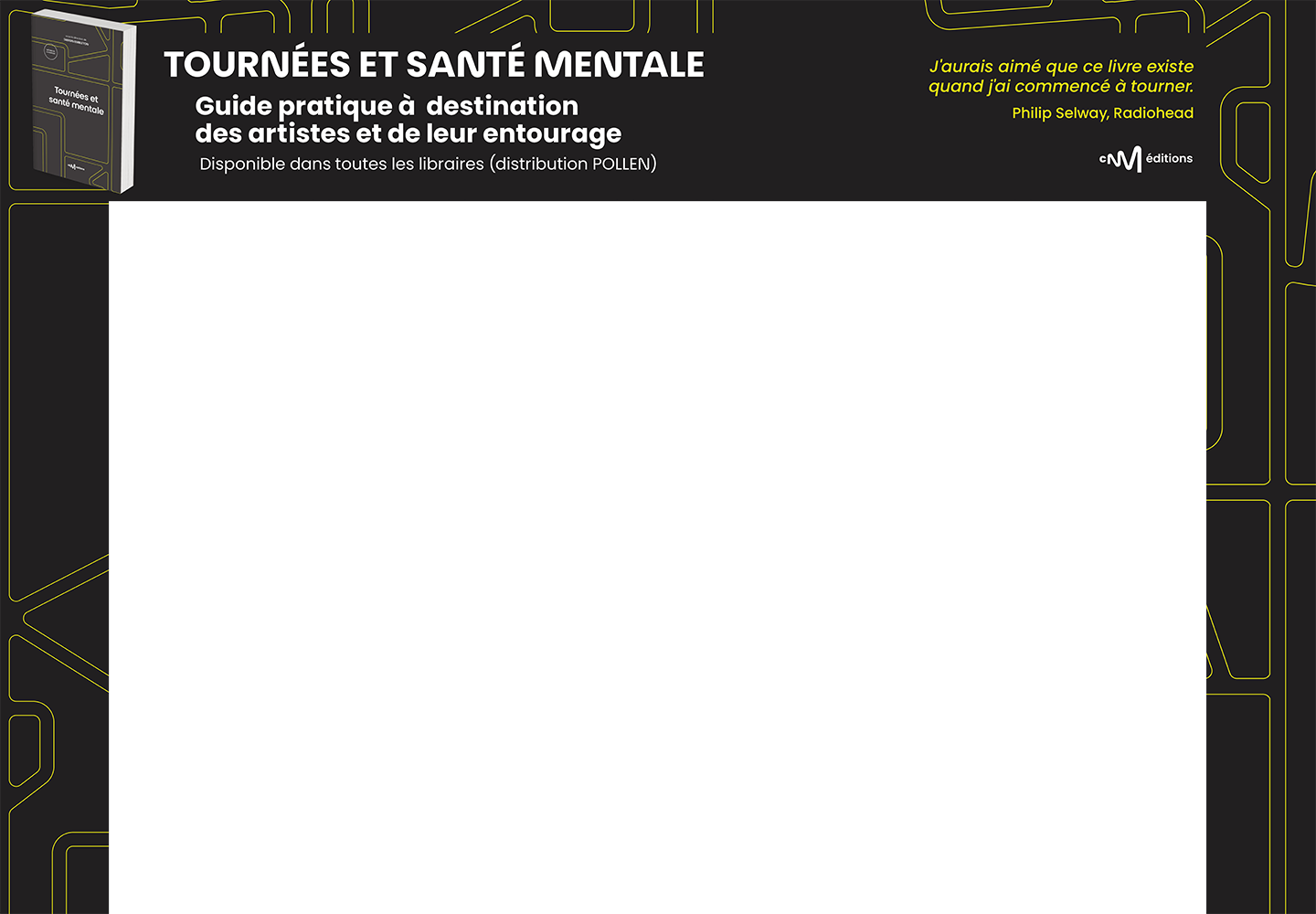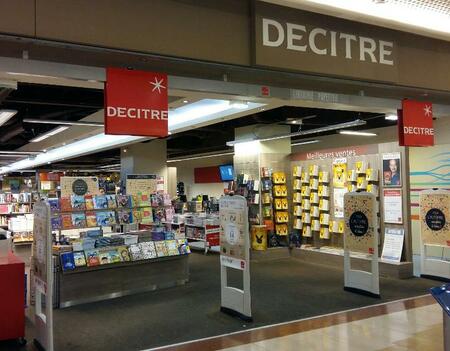Le shōjo vintage revient en force au FIBD. Treize ans après la venue de Riyoko Ikeda, autrice culte de La rose de Versailles (Kana, 2011), une autre icône du manga pour jeunes filles était l’invitée d’honneur du festival : Moto Hagio, à qui l’on doit Le cœur de Thomas (Crunchyroll) et Le clan des Poe (Akata). Après une exposition dédiée et une masterclass, la mangaka a été récompensée d’un Fauve d’honneur sur la scène du théâtre d’Angoulême.
Sur les stands des éditions Akata, les visiteurs de Manga City ont pu se procurer les deux premiers tomes du Clan des Poe et Barbara, l’entre-deux-mondes. L’idée de rééditer ces œuvres ne vient pas d’hier pour la maison d’édition, qui a créé une collection « Héritages ». Un moyen de féminiser le patrimoine du manga, qui s’invite de plus en plus en France via des reparutions d’Osamu Tezuka et Junji Itō. Et d’en finir avec une vision tronquée du shōjo, souvent réduit au récit à l’eau de rose.
Moto Hagio revient sur son parcours en masterclass au FIBD 2024- Photo LÉON CATTANPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Les mangas de Moto Hagio sont loin de souscrire à cet archétype : elle s’est emparé du mythe vampirique dans Le clan des Poe, a imaginé dans Nous sommes onze ! (Glénat) un huis clos dans l’espace, et décrit d’une manière glaçante l’abus d’un beau-père sur son fils dans Sous la domination d’un dieu impitoyable (inédit en France). Expérimentations narratives et stylistiques, sujets d’une grande noirceur… Et pourtant, Moto Hagio est bien une autrice de shōjos. « Avec le temps, des hommes se sont mis à lire mes mangas, raconte-t-elle en conférence de presse. Certains m’ont dit : “Ces histoires ne ressemblent pas à des shōjos.” Pourquoi ? Parce qu’ils les trouvaient intéressantes. » Elle ajoute : « Il m’arrive de recevoir des lettres de lecteurs masculins qui me disent élaborer des stratagèmes pour acheter mes mangas en librairie, car ils n’assument pas d’acheter des shōjos. »
Publier du shōjo : mode d’emploi
Les éditions Glénat ont réédité deux anthologies d’histoires courtes de Moto Hagio en janvier 2024. Quelque temps plus tôt, la directrice éditoriale du département manga, Satoko Inaba, avait confié à Livres Hebdo : « La grande difficulté, c’est que les lectrices de shōjo lisent du shōnen, mais que l’inverse n’est pas vrai en France. »
Une exposition dédiée aux travaux de Moto Hagio- Photo LÉON CATTANPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Pour susciter l’engouement, plusieurs stratégies sont développées par les éditeurs. Y compris catégoriser les shōjos en seinen, autre sous-genre de mangas ciblant les hommes adultes. « Certains cachent l’origine des œuvres pour les rendre plus attractives auprès du grand public. Sinon, elles ne fonctionneraient pas d’un point de vue éditorial », observe Julie Proust-Tanguy, autrice du diptyque Shōjo! et Shōnen! (Moutons Électriques, 2023). Elle cite Le requiem du roi des roses d’Aya Kanno, publié au Japon dans le magazine de shōjos Monthly Princess et édité en France par Ki-oon dans leur collection Seinen.
D’autres vont privilégier des publications plus adultes, qui s’attaquent à des sujets de société et mélangent les genres. L’incursion dans le fantastique avec le one-shot Dandara, paru chez Akata en 2022, la série steampunk Mikado Boy de Riko Miyagi (2014) ou des romances plus matures à l’instar de Switch Love d’Akane Ogura (Delcourt Tonkam, 2019). Et pour soutenir ces choix audacieux, les lectrices de shōjos sont au rendez-vous. En atteste le lancement d’un hashtag qui perdure depuis un an, #LibérezLesShojos, créant un espace de contestation et de déconstruction des idées reçues sur cette catégorie souvent surnommée qualifiée de « parente pauvre » du shōnen. Comme pour faire écho à ces questionnements, les éditions Pika ont annoncé l'édition de shōjos collector en 2024.
Les recommandations lecture de Moto Hagio
- Le Pavillon des hommes de Fumi Yoshinaga (trad. Samson Sylvain, Kana, 2009-2022). « C’est une œuvre de science-fiction passionnante à l’époque d’Edo qui imagine ce que donnerait un Japon où les femmes sont majoritaires et détiennent le pouvoir. »
- Tamaki to Amane de Fumi Yoshinaga (2023). « Autre manga de l’autrice du Pavillon des hommes, Tamaki to Amane est un one-shot qui joue avec la fluidité de l’identité. Les personnages ont tous les deux des prénoms neutres, et se métamorphosent constamment. »
- Gintarou-san Otanomi Mousu d’Akiko Higashimura (2022). « Cette fois-ci, on parle de personnages féminins qui ont des prénoms masculins. Une d’entre elle développe une fascination sur l’autre parce qu’elle est vêtue d’un kimono. C’est un vêtement très peu populaire aujourd’hui, alors qu’à l’époque de ma mère, c’était normal. On apprend beaucoup de choses sur l’art du kimono dans ce manga, c’est très intéressant. »
- Don’t call it mystery de Yumi Tamura (trad. Yukari Maeda et Patrick Honnoré, Noeve Grafx, 2021). « Un étudiant est accusé à tort du meurtre d’un de ses camarades, et il doit mener l’enquête pour prouver son innocence. Rapidement, un binôme s’instaure avec un autre personnage. J’ai beaucoup aimé leur complémentarité, et l’un d’entre eux était souvent du même avis que moi, ce que j’ai trouvé très satisfaisant. La série permet aussi de voir le quotidien d’une policière dans un univers très masculin. »
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.