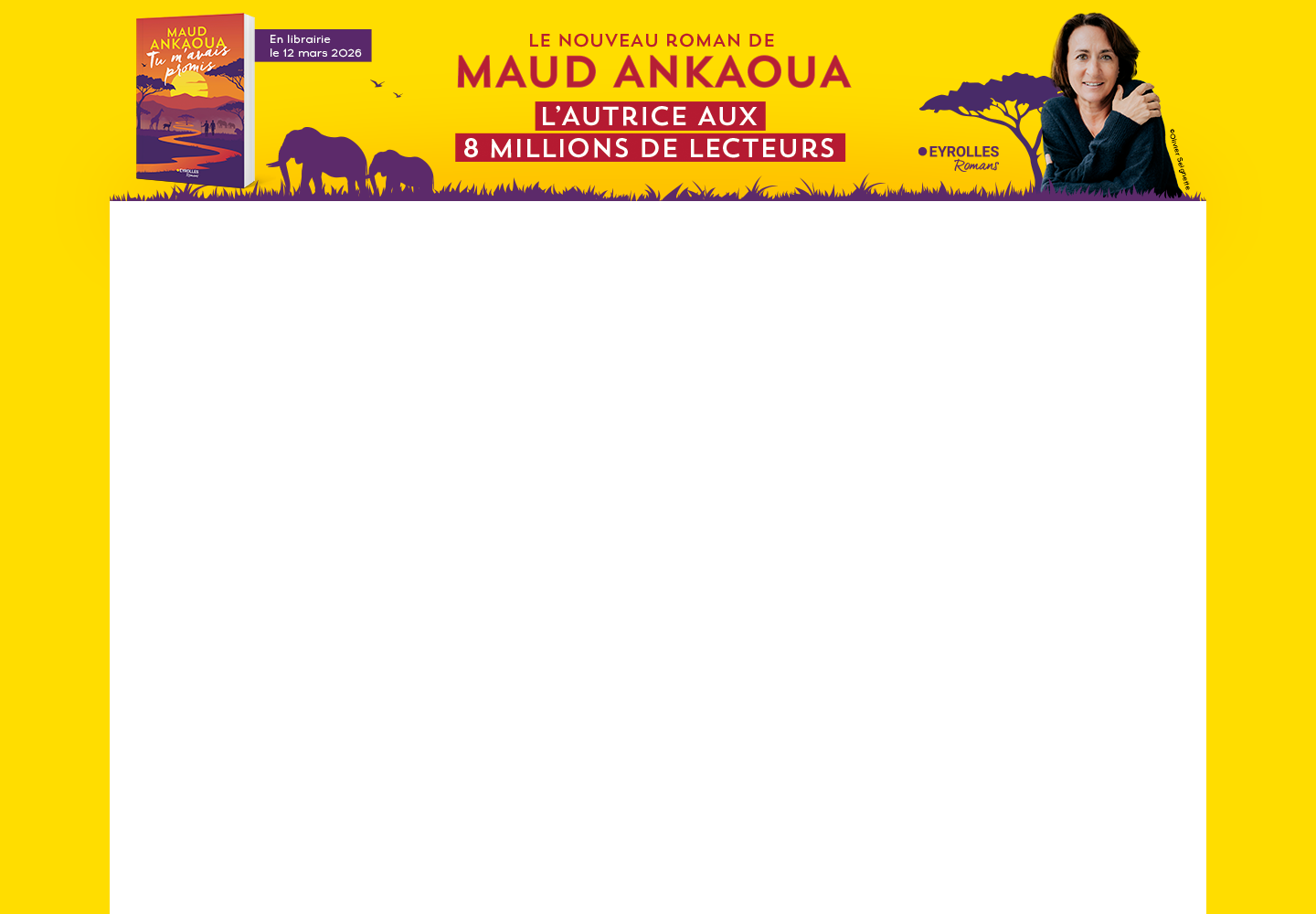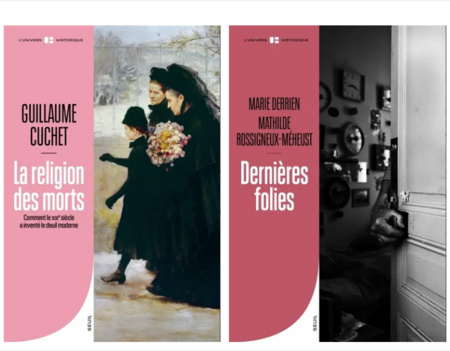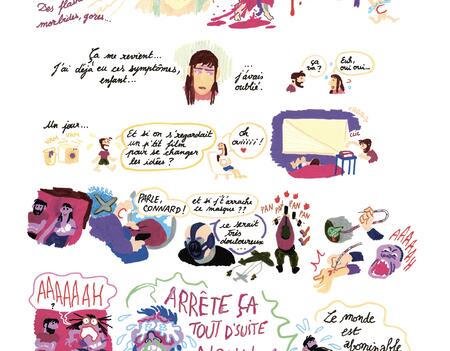Justice pour l'âne. On le dit têtu, indocile, hargneux, stupide, sale, lascif voire lubrique, au mépris des services qu'il rend à l'homme depuis des millénaires. Parent pauvre du cheval, l'âne fait figure de contre-exemple, de repoussoir : les cancres sont affublés d'un bonnet aux longues oreilles et, pour échapper au désir incestueux de son père, la fille d'un roi revêt la peau d'un âne, se condamnant par ce geste à une vie misérable. Sous l'Ancien Régime, le mari trompé et l'épouse adultère sont soumis au rituel infamant de l'assouade, consistant à les balader à dos d'âne sous les quolibets de la foule. À la fin du Moyen Âge, dans les enluminures illustrant les sept péchés capitaux, l'âne est une incarnation de la paresse. Dans la Rome antique, le mot « asinus » est une injure des plus courantes. Et au xviie siècle, un cochon bien gras se vend plus cher qu'un âne pelé. Moqué, déprécié, pourquoi l'âne n'en occupe-t-il pas moins une place de choix dans nos fables, proverbes, emblèmes et symboles (« Si de beaucoup travailler on devenait riche, les ânes auraient le bât doré ») ? La plus grande injustice à lui avoir été faite n'est-elle pas celle du silence ? « Comme si l'âne était devenu un acteur tellement banal dans la vie des campagnes, les activités paysannes et le monde des transports que textes, images, archives comptables ou notariées l'avaient laissé de côté. Même l'archéozoologie, pourtant si riche d'informations sur l'élevage des bovins, des caprins et des ovins, n'a pas grand-chose à nous apprendre à son sujet. Il semble appartenir au "cours ordinaire des choses". »
Grand historien des couleurs mais aussi des animaux, Michel Pastoureau a remonté le cours de l'histoire de la zoologie pour rendre justice à cet animal qui, à l'instar du loup, du taureau, du corbeau et de la baleine (auxquels il a consacré, pour chacun, un ouvrage) occupe une place de choix dans son bestiaire personnel. Savamment illustrée, cette « histoire culturelle » est une plongée dans le temps, des bas-reliefs de l'Égypte pharaonique à la comédie musicale Peau d'âne de Jacques Demy. On y apprend que, de positive, l'image de l'âne se détériore dès lors qu'il entre en compétition avec le cheval, apanage des riches quand l'âne est synonyme de pauvreté. Seule l'histoire sainte semble lui rendre hommage : témoin de la Nativité, n'est-ce pas lui qui porte le Christ sur son dos lors de son entrée dans Jérusalem ? « L'âne est [...] un âne, [...] point un cheval dégénéré », affirmait Buffon en 1753, parmi les premiers défenseurs d'un animal qui, dans un poème de Victor Hugo, incarnera bientôt la sagesse en s'élevant contre les excès du scientisme et du positivisme alors en vogue. Familière ou symbolique, la figure de l'âne témoigne de l'évolution du regard porté sur les animaux. De simple auxiliaire de travail, corvéable à merci, il acquiert le statut d'animal domestique et des droits, révélateurs de l'évolution de notre sensibilité. Érudit, empathique et animé du joyeux désir de partager, cet ouvrage souligne le capital sympathie d'un animal dont les yeux sont le vivant reflet de notre (in)humanité.
L'âne. Une histoire culturelle
Seuil
Tirage: 20 000 ex.
Prix: 22,90 € ; 160 p.
ISBN: 9782021586695