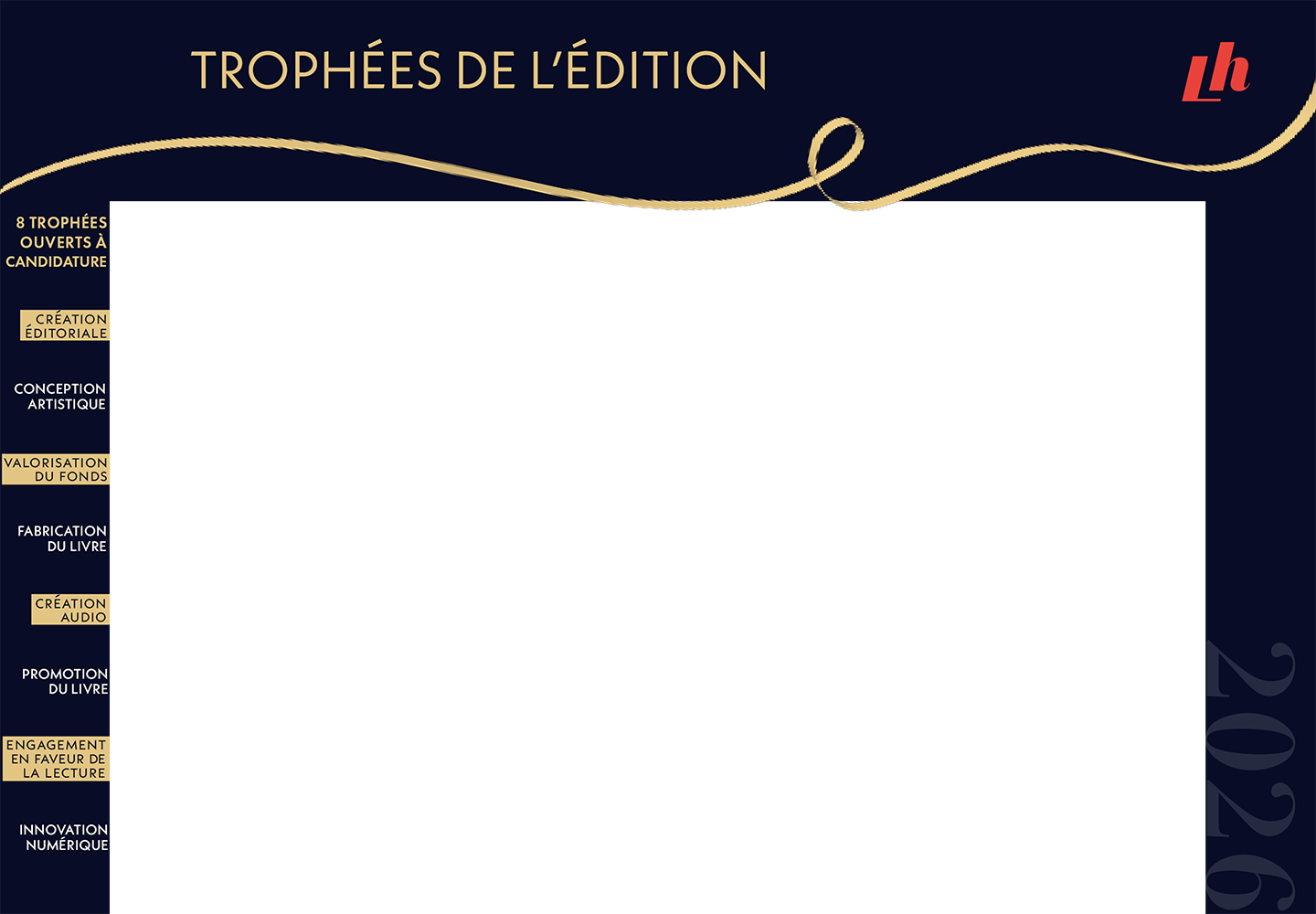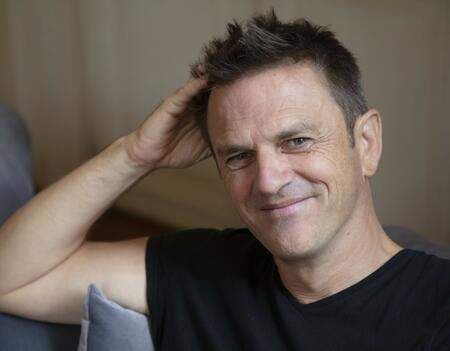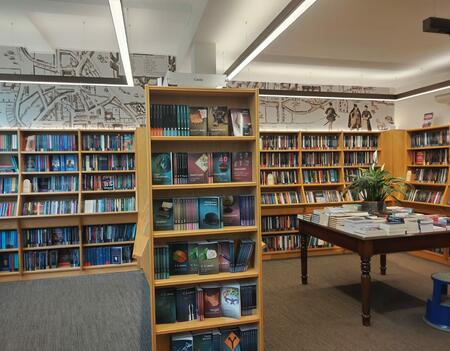L'étendard et le balai. Selon Aristote, les trois régimes que sont la monarchie, l'aristocratie et la démocratie se valent s'ils sont régis en vue du bien commun mais peuvent chacun dégénérer en arbitraire autocratique (tyrannie), en accaparement du pouvoir au service d'un groupe de privilégiés (oligarchie) ou en dictature de la volonté majoritaire (démagogie). De l'Amérique de Donald Trump à l'Inde de Narendra Modi, de l'Argentine de Javier Milei à la Hongrie de Viktor Orbán, de par le monde souffle un vent illibéral. Si nombre de ces leaders sont à droite, voire à l'extrême droite de l'échiquier politique, le populisme fait également florès à l'autre bord du camp d'en face. Mais le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple ? C'est la démocratie ! clament les populistes. Le RN et la France insoumise en France, le mouvement MAGA aux États-Unis, les ex-brexiters devenus Reform UK au Royaume-Uni, Vox en Espagne, l'AfD en Allemagne, tous se disent simplement pour la souveraineté populaire. Mais qu'entend-on par « peuple » ? Une population liée par une histoire et un destin communs, et comprise dans toute sa diversité sociale et sa pluralité d'opinions ? Les « vraies gens », la majorité silencieuse, les prolétaires, les sans-grade, ceux d'en bas méprisés par ceux d'en haut qui nous gouvernent ?
Dans Pour l'amour du peuple, Marc Lazar se penche sur le cas hexagonal en retraçant la généalogie du populisme. Du général Boulanger se repaissant de l'esprit de revanche contre l'Empire allemand à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur fond de mondialisation malheureuse et de crises climatique et migratoire, en passant par le poujadisme des années 1950 ou le mouvement des « gilets jaunes », l'historien analyse les ressorts qui constituent le schème du populisme en France. Il rappelle la distinction entre populisme et fascisme, même s'il y a des points de contact. Les partis populistes croient encore aux urnes, dussent-ils prôner des mesures antirépublicaines telle la préférence nationale ou insuffler un esprit insurrectionnel propre à fragiliser les institutions démocratiques. À deux ou trois exceptions près, tels les maos dans les années 1970 ou Bernard Tapie dans les années 1980, le populisme brandit à la fois l'étendard de la nation qu'aucun « sang impur » (comprendre aussi : idées contraires) ne saurait entacher et le balai du dégagisme qui chasse les élites déconnectées. Point commun à droite comme à gauche : la négation du pluralisme et l'adhésion fervente à un(e) chef(fe) charismatique. Car en niant la dissension, c'est la notion même de sujet qui est niée : « Tout populisme exprime à la fois une protestation radicale de nature politique, sociale ou encore culturelle, et une revendication identitaire pour affirmer l'existence d'une communauté partageant des valeurs et des intérêts communs, et [...] de manière presque basique, un simple "nous" collectif face aux processus d'individualisation. » S'il s'évertue à rendre compte du phénomène populiste, Marc Lazar nous offre en vérité une opportune clé de compréhension de la démocratie représentative, ou plutôt de ses dysfonctionnements, qui fertilisent le terreau du populisme.
Pour l'amour du peuple. Histoire du populisme en France, XIXe-XXIe siècle
Gallimard
Tirage: NC
Prix: 22,50 € ; 320 p.
ISBN: 9782070141975