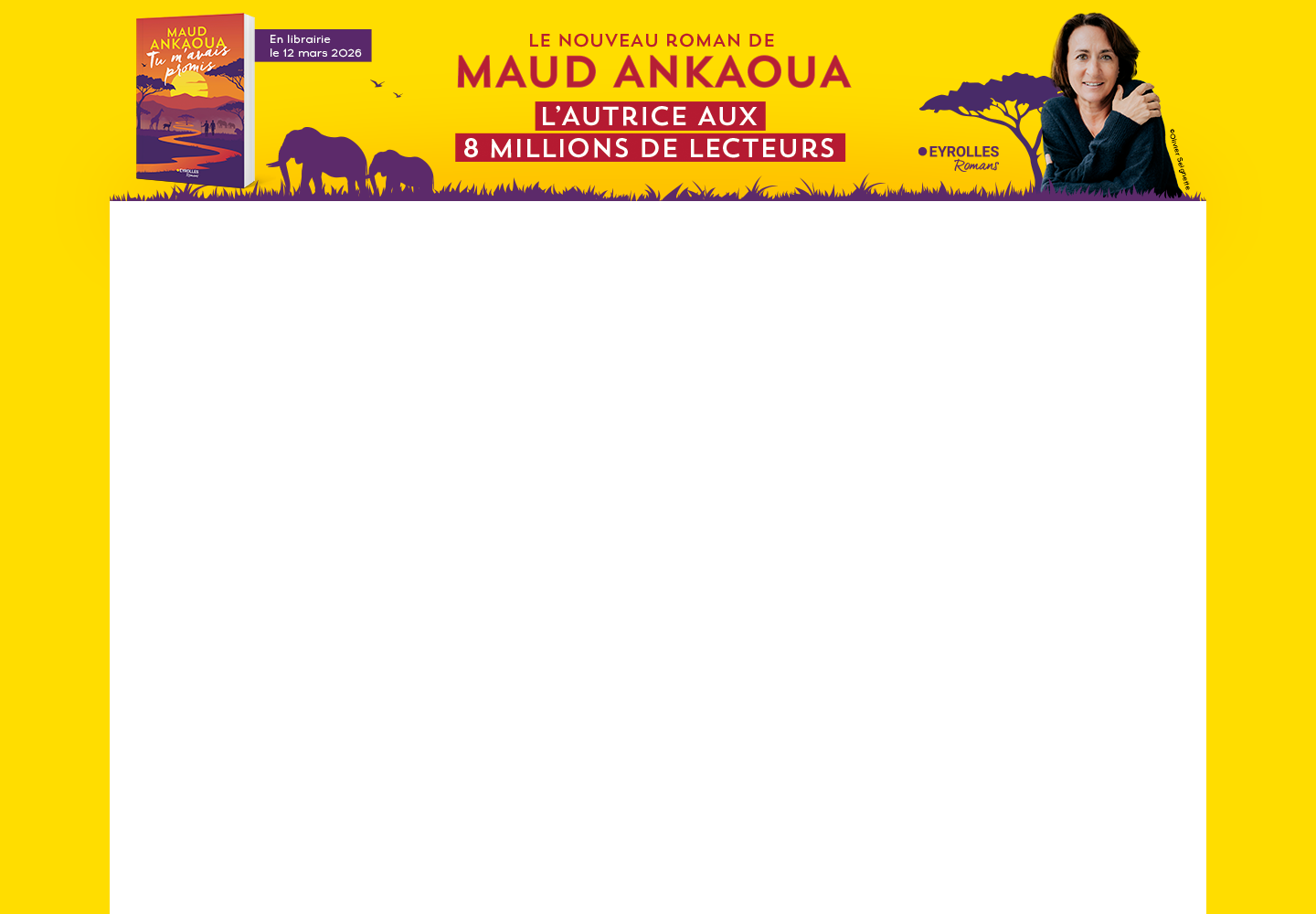À la Foire du livre de Francfort, mercredi 15 octobre, une table ronde consacrée aux libraires en temps de guerre a réuni trois acteurs pour qui la vente de livres a pris ces dernières années une nouvelle dimension. Leur point commun : travailler dans des contextes de conflits ou de pressions politiques, et avoir fait de leur librairie des espaces de résistance, d’ancrage communautaire, et, plus que jamais, des lieux politiques.
Kiev : « Faire exister la communauté par la librairie »
Olexii Erinchak, libraire à Kiev, n’a pas cherché à faire de son établissement un simple commerce. « J’ai voulu créer une communauté, dans mon quartier, au moment où les gens pensaient tout trouver sur Internet », explique-t-il. Deux mois avant l’invasion russe de l'Ukraine, il ouvre Sens Bookshop pour y donner la priorité au livre ukrainien : « Avant la guerre, 75 % des livres vendus étaient en russe. Nous avons voulu exposer la littérature ukrainienne, hors concurrence ».
La guerre a fait basculer la librairie dans une autre dimension. « Dès les premiers bombardements, notre espace est devenu un centre de bénévolat, un hub où aider l’armée, les voisins, ceux qui n’avaient pas pu partir ». Malgré l’ampleur des difficultés rencontrées et une certaine érosion constatée de l’intérêt pour la culture après quatre ans de conflit, il revendique : « On a compris que tenir la librairie ouverte, c’était maintenir une forme de normalité. Mais aussi de résistance ». Pour lui, tout à changé pour ses clients : la façon de lire, de s'informer, de débattre, le choix de la langue aussi.
« Malheureusement, après quatre ans, on sent moins d’intérêt pour les idées, la littérature, la nation, alors que la survie économique, payer les factures, la fatigue, prennent le dessus. Mais il est vital de continuer à promouvoir l’identité ukrainienne et initier le dialogue », argue-t-il.
Mahmoud Muna- Photo FRANKFURT BUCHMESSE
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Jérusalem : « Quand vendre des livres devient un acte politique »
À Jérusalem Est, Mahmoud Muna dirige l’Educational Bookshop, librairie confrontée à la surveillance et à la répression. « La librairie, longtemps perçue comme un havre, est ces derniers mois devenue un espace politisé, où la police vient perquisitionner, où vous êtes accusés et jugés sur votre fonds », témoigne-t-il. « Nous sommes dans le métier de provoquer des idées, de faire sortir les gens de leur zone de confort. La pression des autorités nous fait sentir tous les jours que nous avons une responsabilité politique que je n'imaginais pas », ajoute-t-il.
Arrêté en 2025, Mahmoud Muna n’a jamais pensé à céder sur ses choix éditoriaux : « Cela donne surtout une motivation supplémentaire : on comprend, quand on revient après deux jours de garde à vue et qu’on retrouve dix bénévoles venus tenir la boutique, qu’on n’est pas seuls et que l’on a un rôle à jouer ».
Pour lui, « un libraire aujourd’hui, c’est un curateur d’idées, un passeur, capable d’ouvrir la boutique sur le monde extérieur, écoles, universités, acteurs associatifs. C’est probablement le métier le plus honorable, au cœur d’une société qui veut rester saine ».
« Oui, vendre des livres est un acte politique »
En guise de conclusion, une question venue du public fuse : « Être libraire en temps de guerre, est-ce un acte politique ? ». Olexii Erinchak tranche : « Aider les gens à comprendre le monde, leur permettre de réfléchir, c’est forcément politique. Si on ne laisse plus de choix dans les idées, si on laisse les discours tout fait sur TikTok prendre le dessus, alors ce n’est plus une démocratie ». À Mahmoud Muna d'enfoncer le clou : « Si nos librairies sont attaquées, accusées de violence quand elles font naître des idées, alors oui : c’est éminemment politique ».