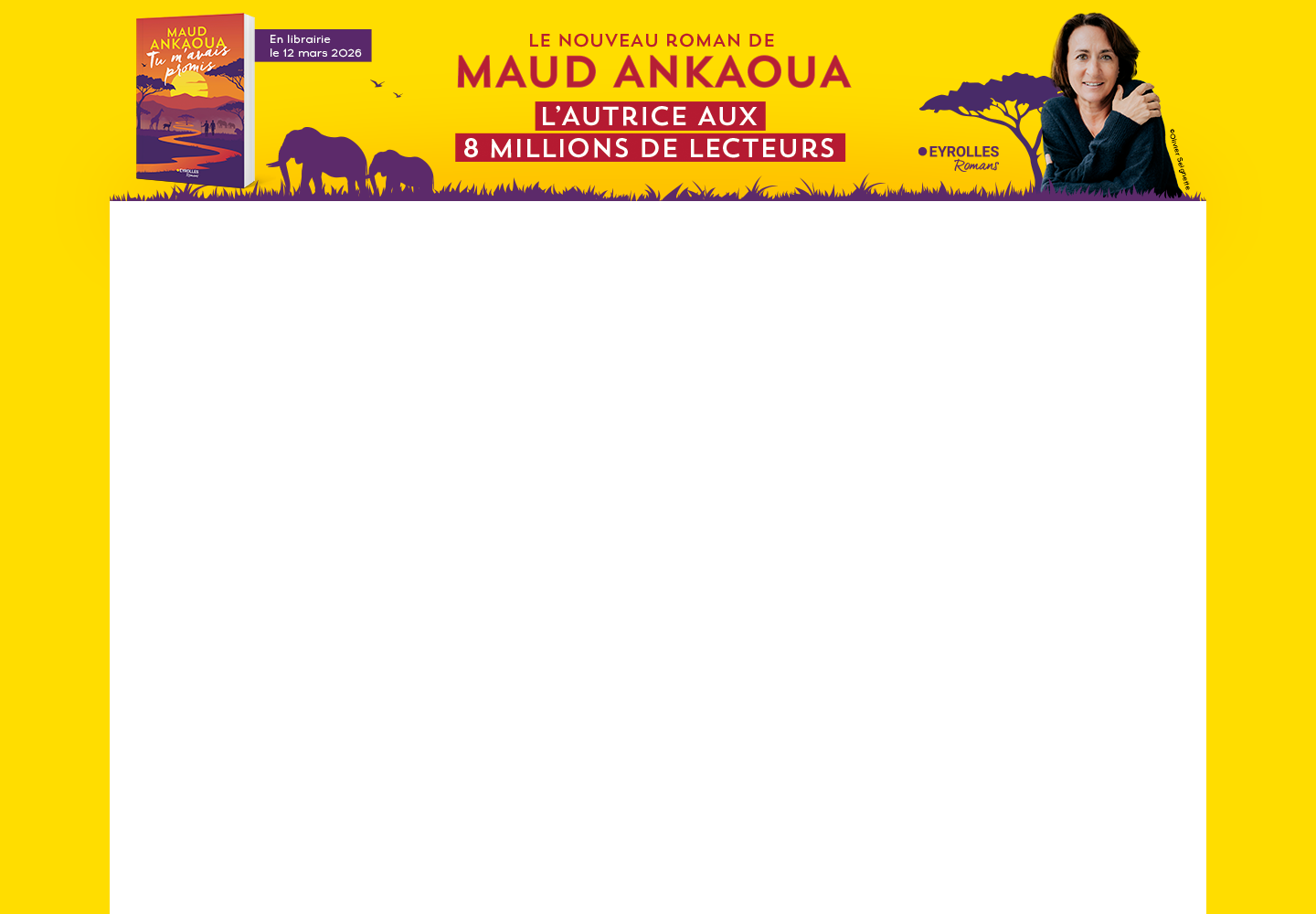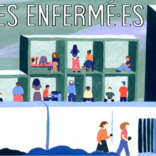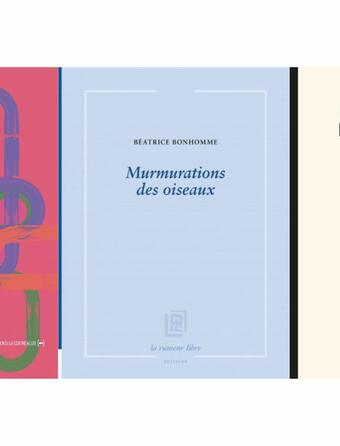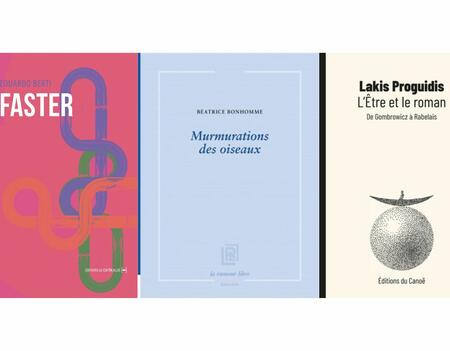Comment l’autorité politique a-t-il dû composer avec la loi, la produire, s’y soumettre ou parfois s’en émanciper ? Yves Sassier répond à ces questions avec une fresque magistrale sur l’histoire du rapport entre pouvoir et légalité en Europe, depuis la Grèce archaïque jusqu’au Moyen Âge. Professeur émérite de Sorbonne Université, Yves Sassier s’est imposé comme l’un des meilleurs spécialistes français de l’histoire du droit et des institutions au Moyen Âge central, mais aussi, à la croisée des disciplines, de l’histoire de la pensée politique médiévale et de la France capétienne. Dans Le prince et la loi en Occident (PUF) il propose une vaste synthèse qui embrasse plus de deux millénaires.
« Ubi societas, ibi ius »
« Là où il y a une société, il y a du droit ». En introduction, Yves Sassier rappelle qu’avant l’invention de la loi par l’homme grec, l’existence de règles étaient consubstantielle d’une communauté humaine sans en être le fondement : « Tout groupe de solidarité de type familial ou clanique et toute société connaissent des règles qui peuvent être religieuses et se rattacher à des oracles divins ou, dans l’univers mental des groupes sociaux qui les appliquent, à un ordre du cosmos que l’on pense immuable. » Mais « de telles règles, considérées comme issues de cet ordre du monde sur lequel veillent les divinités, tirent leur existence de l’acceptation tacite de ceux qui les observent. »
C’est, en réalité, avec la civilisation gréco-romaine que la loi va acquérir un statut central dans l’organisation de nos sociétés occidentales : « Il y a 2 500 ans, elle n'a pas été conçue uniquement comme un outil - déjà mise en œuvre bien en amont dans certaines civilisations - permettant au gouvernement de transmettre au plus grand nombre ses ordres ou ses interdits, de réguler au moyen de mesures impératives assorties de sanctions les actes quotidiens de ceux qui lui sont soumis. La loi fut aussi conçue comme un référent servant à légitimer, mais aussi à contenir, limiter, encadrer les entreprises du détenteur du pouvoir à l'égard de la communauté politique, ce qu'elle devint dans le cadre de la cité gréco-romaine. »
Tensions et complémentarités
En effet, Yves Sassier réussit le pari de condenser une masse considérable de sources et de débats historiographiques en un récit clair et structuré. Tout au long de l’ouvrage, chaque étape essentielle (Grèce, Rome, royautés médiévales, redécouverte du droit romain, influence d’Aristote) est traitée avec rigueur. La structuration thématique du livre facilite la compréhension de l’évolution du concept de légalité : la loi apparaît tantôt comme un frein, tantôt comme un instrument du pouvoir princier. Cette perspective met en lumière les tensions mais aussi les complémentarités historiques entre gouvernants et gouvernés, entre tradition et innovation juridique.
Ainsi, avec beaucoup de pertinence et de finalement de sagesse, Yves Sassier montre que « l'homme grec, autour du VIIe-VIe siècle, acquiert progressivement cette conviction qu'il peut s'organiser pour faire front, dans la mesure du possible, aux aléas du monde naturel, et surtout qu'il doit faire face, avec ses ressources propres et les facultés découlant de sa raison, à des phénomènes qui lui sont immanents, dont ils portent seule la responsabilité. Les siècles qui suivent forgeront donc cette conscience que c'est à l'homme, responsable de l'ordre et du désordre qui caractérise son espèce, qu'il revient de comprendre les causes des désordres ; et surtout d'y trouver des remèdes par la création d'un ordre juste de la cité voire, dans certaines cités comme Athènes, par une réglementation qui soit commune à tous les membres de la communauté et assure l'égalité des droits et devoirs (isonomia) entre citoyens. Telle est la grande découverte de la Grèce qui la distingue de tant d'autres peuples des bords de cette Méditerranée orientale. »
Puis enchaînant avec la période féodale, dont Marc Bloch avait fourni en son temps une lumineuse analyse, il explique un délitement de la loi comme organisation commune : « En réalité, au Xe comme au XIe siècle, le roi de Francie occidentale est incapable de légiférer, ni même de faire appliquer les anciennes lois dans son Royaume […]. À partir du dernier quart du IXe siècle, les royautés, en France comme dans le reste de l'Europe, connaissent […] un essor sans précédent du pluralisme politique caractérisé par la dispersion de la prérogative royale au profit de hauts lignages d'anciens titulaires de charges publiques et par un morcellement croissant des attributs du pouvoir jusqu'à un niveau extrêmement bas : celui de la seigneurie châtelaine. »
Enjeux institutionnels, mais aussi philosophiques, économiques et sociaux
Car un des nombreux mérites du livre d’Yves Sassier est de replacer le débat du « Prince face à la loi » dans ses enjeux institutionnels, mais aussi philosophiques, économiques et sociaux. Découvrant ainsi la diversité des sources du droit (coutume, lois écrites, autorité divine), la pluralité des agents capables de créer la règle (prince, peuple, élites), et l’interpénétration constante entre réalité politique, contexte socio-économique et réflexion théorique.
Ainsi, Yves Sassier montre comment les bouleversements socio-économiques des XIIe et XIIIe siècle conduisent à un besoin de sécurité des acteurs de la société qui vont contribuer à une renaissance de la loi en Occident. À ce contexte, s’ajoute alors (comme toujours) un besoin de sécurité : « L'essor économique à l'échelle du continent européen accélère et multiplie la circulation des personnes, des marchandises, des techniques de production, et créer de nouveaux besoins : celui d'une protection publique des circuits du commerce européen et des personnes qui les empruntent ; celui d'une sécurité juridique des engagements contractuels et d'un statut de liberté personnelle des acteurs de cet essor dans le respect d'une éthique codifiée de chaque type d'activité. »
Alors que par ailleurs la redécouverte de l'œuvre juridique de l'empereur d'Orient Justinien et à l'essor d'une philosophie morale et politique liée à la redécouverte, de l’œuvre d’Aristote, notamment par Saint Thomas d’Aquin, permettant un renouveau de la réflexion des intellectuels sur les finalités de la loi comme sur les modalités de sa création. Yves Sassier souligne l’importance de la finalité du bien commun comme fil conducteur de la dynamique de la loi en Occident, insistant sur le fait que ce principe n’est jamais totalement acquis, mais sans cesse redéfini au gré des changements de contexte.
« Définition précoce et continue d'un idéal du bon législateur »
Car, derrière cette magnifique fresque, Yves Sassier, avec beaucoup de finesse et d’intelligence, nous donne des leçons pour aujourd’hui : « Le principal gain de ces vingt siècles d'histoire européenne et française de la légalité résident bien, en somme, dans la définition précoce et continue d'un idéal du bon législateur qui conduit à certains éléments essentiels de notre vision actuelle de la loi : dans le législateur débiteur du bien commun, sa loi se devant d'être l'expression concrète et vivante des réalités sociales de leur diversité comme de leurs variations dans le temps et l'espace. »
Et d’exprimer son scepticisme face aux législateurs contemporains : « On peut aussi contester les vertus de la règle générale adoptée par des élus dont la légitimité en vient à être fragilisée par l'impression commune que cette "élite" politique n'exprime, avec parfois toute la violence des mots, que les rivalités fortement teintées d'égocentrisme opposant ses chefs, et en venir à oublier cette réalité vieille de vingt-siècles siècles d'histoire la loi est très profondément ancrée dans notre civilisation occidentale. »
Tel Proust, Yves Sassier reste à la Recherche du Bien commun.
Extraits du Prince et la loi en Occident
« Dans notre civilisation européenne, l'invention de la règle écrite s'est presque aussitôt traduite par la prise de conscience d'une approche de la loi dont le principal bénéficiaire serait, non pas le détenteur de la puissance de commandement, mais la multitude des gouvernés. L'invention de la loi, en Grèce d'abord, à Rome peu après, débouche presque aussitôt sur une contrainte pesant sur celui-peuple, élite gouvernante ou monarque - qui exerce la fonction législative : celle de vraie pour le bien du plus grand nombre. Dès ses origines, le concept occidental de l'égalité s'est donc enrichi d'une dimension téléologique forte. Toute bonne loi se devra d'être orientée vers une conception du bien commun qui, certes, variera dans le temps en fonction des évolutions sociales, religieuse et mentale qui affecteront la réflexion des élites sur bien des notions clés-celle d'égalité et de liberté par exemple-comme sur les fins assignées à l'existence humaine, mais que l'on retrouve exprimé au long de ces vingt siècles : assurer, non pas à une minorité, mais à la multitude des gouvernés paix, concorde, justice et protection contre toute agression interne ou externe. »
« Les XIIe et XIIIe siècle nous montrent toutes les grandes monarchies de l'Occident […] entreprenant de rendre plus efficace la fonction d'encadrement des populations dont le monopole leur avait souvent échappé. Elles le font dans un contexte socio-économique qui leur est favorable : ces deux siècles sont en effet des époques marquées par un essor économique sans précédent, par une croissance assez remarquable de la production agricole, et surtout par une forte croissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les secteurs secondaires et tertiaires : artisanat et industrie, grand commerce et ouverture ou renforcement de circuits commerciaux qui assurent peuplement, dynamisme et prospérité aux grandes cités, et qui profite bien sûr aussi au roi et au prince, détenteur de vieux centres urbains parmi les plus prospères. »
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Alexandre Duval-Stalla

Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.