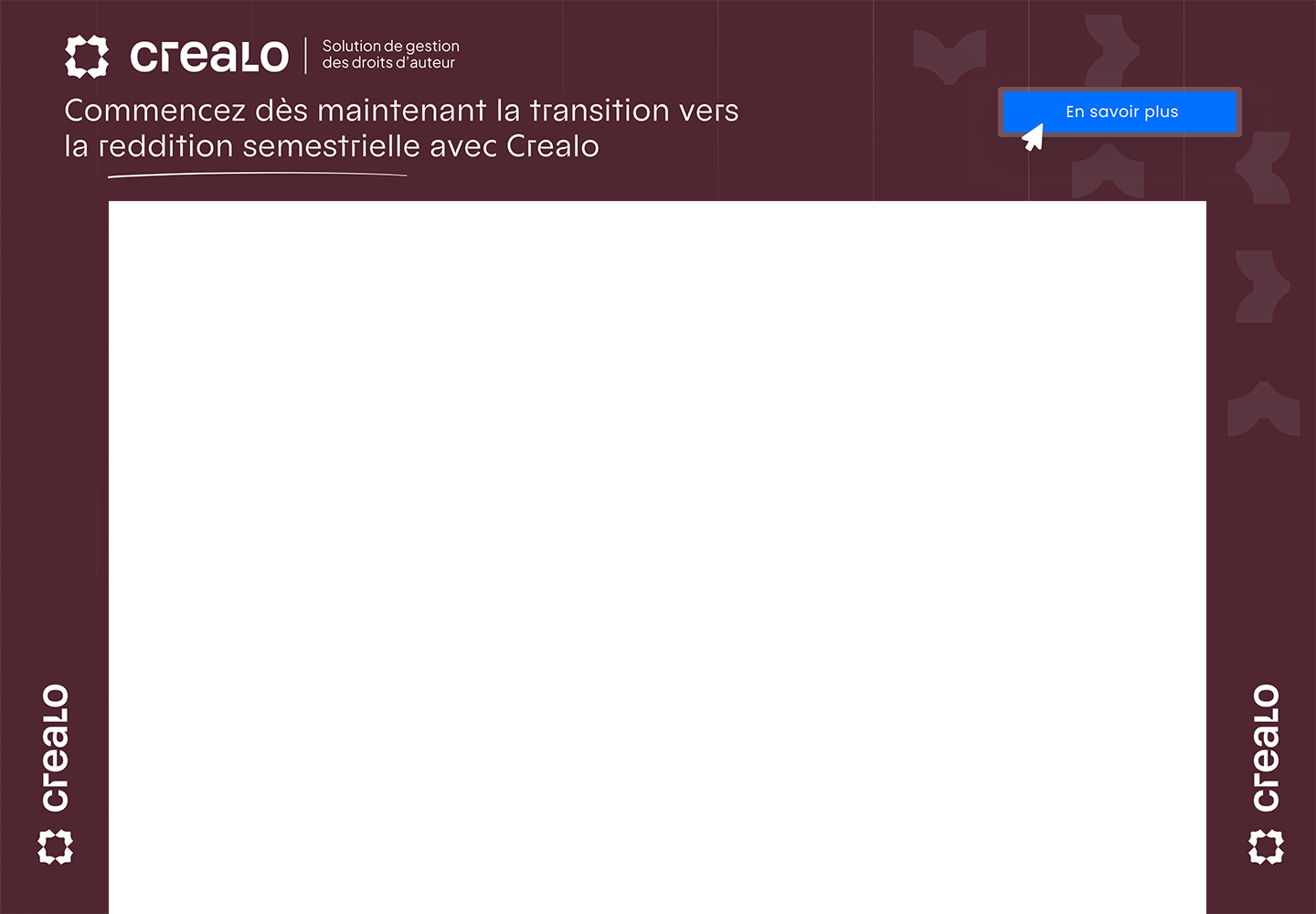Peut-on tout dessiner ? Peut-on caricaturer ? Peut-on librement s’exprimer ? Peut-on enseigner librement cette liberté ?
La question a été hélas posée, dès le 8 février 2006, lorsque Charlie Hebdo a reproduit en pages intérieures douze caricatures de Mahomet, parues au mois de septembre précédent dans un journal danois, le Jyllands-Posten. En une, un dessin de Cabu montre le Commandeur des croyants particulièrement affligé par certaines de ses brebis.
Depuis que la bombe à fragmentations larguée par le journal danois a explosé, des déflagrations ne cessent de se faire sentir à travers la planète, avec toutefois un très net surcroît de vigueur au Pakistan, où des effigies du Premier ministre danois sont brûlées au cours de manifestations violentes ; en Afghanistan, en Indonésie, en Lybie, en Irak où des soldats danois sont la cible de tirs dans le sud du pays, etc. Les têtes des caricaturistes sont mises à prix, cent mille dollars de la part d’Al-Qaïda, un million de dollars et une voiture de la part d’un généreux dignitaire musulman pakistanais, plusieurs attentats terroristes visant les satiristes sont déjoués, de même que des tentatives d’assassinats, les ambassades du Danemark et de Norvège sont incendiées en Syrie, celle du Danemark à Islamabad, capitale du Pakistan, est temporairement fermée, tandis que l’ambassadeur du Pakistan à Copenhague est rappelé…
Bref, la tension est à son comble quand Charlie Hebdo décide, à la suite de France Soir et de journaux allemand, italien, espagnol, belge ou même égyptien, de publier les dessins controversés. Alors que l’hebdomadaire imprime habituellement à cent quarante mille exemplaires, un tirage exceptionnel de cent soixante mille est mis en vente. En milieu de matinée, la plupart des points de vente sont en rupture de stock ; un nouveau tirage est lancé en urgence, et ce sont près de quatre cent mille numéros qui s’écoulent finalement dans la seule journée du 8 février.
La veille, des organisations musulmanes françaises tentent de faire interdire la livraison. La justice les déboute, bien que le gouvernement français ait apparemment tenté d’influencer les juges en leur conseillant d’abonder dans le sens de la requête déposée par les associations musulmanes.
Un an plus tard, le « procès des caricatures de Mahomet » s’ouvre, au fond, devant le tribunal correctionnel de Paris. Sur le banc des plaignants, l’Union des organisations islamiques de France, la grande mosquée de Paris et la Ligue islamique mondiale, qui s’était déjà constituée partie civile lors de l’affaire des propos tenus par Michel Houellebecq, selon lequel l’islam serait « la religion la plus con » ; sur celui des prévenus, Philippe Val, directeur de la publication, poursuivi pour « injure envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». L’ambiance n’est pas très bonne. Maître Salah Djemaï, conseil de la Ligue islamique mondiale, organisation basée en Arabie Saoudite, déclare : « La Ligue islamique mondiale veut sensibiliser l’opinion à la montée du racisme dans ce pays. On envisage de demander l'euro symbolique. La Ligue islamique mondiale ne fait pas ça pour le fric. Le fric de M. Val est puant. »
Le 22 mars, Philippe Val est relaxé. Il s’en réjouit devant les caméras des télévisions qui patientent en nombre dans les couloirs du Palais : « On est content pour nous et pour vous, on va pouvoir faire notre métier. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui croient à la liberté d’expression, pour les musulmans laïques et républicains. »
Je suis Charlie
Malgré cette victoire sur le terrain du droit, mais aussi parce que la victoire de l’Etat de droit ne plait guère aux extrêmistes, Charlie Hebdo a vu ses locaux détruits par un incendie criminel, en 2011.
Et, comme cela ne suffit pas, il y aura ensuite les attentats de janvier 2015.
Il y a eu des millions de Français aimant Charlie.
Il y a eu Dieudonné sur Facebook, deux jours à peine après l’attentat contre l’épicerie cacher, puis soudain en garde à vue et au tribunal.
Il y a eu le nouveau numéro de Charlie Hebdo, vendu à 7 200 000 d’exemplaires.
Il y a eu les chaînes de TV américaines et la BBC, qui ont toutes flouté la couverture de ce nouveau Charlie.
Il y a eu des émeutes au Niger et au Pakistan, ainsi que des Français, jeunes ou pas, voilés ou pas, qui protestent ou s’émeuvent de cette couverture.
Il y a eu les gamines qui ont injurié un chauffeur de bus au son de « je te tue à la kalach » et ont été condamnées par dizaines en quelques jours pour de « simples » propos.
Il y a eu les Français écrivant en tout sens sur Facebook et Twitter, parlant de tout dire, de beaucoup interdire ou d’inégalité entre les caricaturistes et un pseudo-humoriste.
Il y a eu Copenhague, à peine cinq semaines plus tard.
Il y a eu, depuis une large autocensure, depuis plus de cinq ans.
En juillet 2015, le ministère de la Culture a présenté un projet de loi « relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine » qui a été voté le 7 juillet 2016. Il contient de multiples dispositions précises que, en particulier, les milieux du patrimoine attendaient.
Las, pour ce qui est de la « liberté de création », le résultat ne pouvait qu’être déceptif.
Et ce malgré le dossier de presse incantatoire qui accompagnait le projet. Un éditorial signé par la ministre y assénait qu'« il ne s’agit donc pas seulement de réaffirmer la liberté de création : il s’agit de la rendre possible. De renforcer sa protection et les moyens de sa transmission.
Rendre la liberté de création possible, c’est d’abord apporter des réponses et être au fond fidèle à une méthode : j’ai donc voulu une loi qui change les choses de manière concrète, et qui permettra la mise en œuvre de mon projet politique. »
C’est ainsi que l’article premier de la loi affirme que « la création artistique est libre ». Ce qui ne mange pas de pain.
Le deuxième article a modifié le texte de l’article L. 431-1 du Code pénal. Celui-ci disposait déjà que « le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées aux alinéas précédents est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».
La loi du 7 juillet 2016 y ajoute un alinéa, indiquant que « Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
Las, les menaces ont continué.
Et il y a ce procès, enfin, commencé en septembre dernier, pour juger ceux qui ont oeuvré en janvier 2015 contre la liberté et rappeler que celle-ci est un principe.
Et, durant ce procès un premier attentat, devant les locaux qu’avait occupé le journal satirique.
Et ce vendredi 16 octobre 2020, aboutissement d’une longue montée de haine contre la liberté de caricaturer, celle de blasphémer et celle, enfin et surtout, d’enseigner cette histoire et les multiples visages que la République accorde à la liberté d’expression.
Le droit au blasphème
Les attentats sont l’occasion, atroce, de rappeler que le droit canonique et le droit musulman sanctionnent toujours le blasphème, c’est à dire l’expression jugée outrageante ou irrespectueuse à l’égard de la religion ou de ce que certains considèrent comme sacré.
Il n’en est officiellement pas de même devant les juridictions laïques françaises. N’en déplaise à Nicole Belloubet, minsitre de le Justice en dessous de tout, qui avait cru bon, l’an passé, de ne pas soutenir la jeune Mila, les juges ont rappelé le droit au blasphème, dès 2001 ; lors de « l‘affaire Houellebecq », puis lors des poursuites contre l’essayiste Oriana Fallaci ; avant même, donc, le procès intenté à Charlie Hebdo.
Quelques réactions, à la suite de la parution du premier numéro de Charlie Hebdo postérieur aux attentats, ont montré dans le monde occidental une gène des autorités religieuses vis à vis de ces évènements : condamner les attentats bien entendu, mais faut-il pour autant légitimer la liberté dont jouit l’hebdomadaire ? Et cela même si cette liberté est juridiquement un droit fondamental. Les autorités religieuses peuvent-elles « être Charlie » ?
Pour le pape François, la réponse semble assez claire. Au cours d’un vol Colombo – Manille, il a cru bon de dénigrer la une du numéro de Charlie Hebdo du 14 janvier 2015 en déclarant qu’ « on ne peut provoquer, on ne peut insulter la foi des autres, on ne peut la tourner en dérision ». Et, tout en condamnant le recours à la violence juste avant, le pape ira même jusqu’à affirmer que si quelqu’un insultait sa mère, il n’hésiterait pas à lui mettre son poing dans la figure…
Il existe, hélas, des décisions de justice isolées qui ont affaissé la jurisprudence républicaine.
Pendant longtemps, les magistrats retenaient habituellement pour critère la conformité ou non des images litigieuses à l’iconographie religieuse traditionnelle : la représentation de la crucifixion – de l’affiche du film Larry Flynt à l’ouvrage I.N.R.I. - est ainsi devenue un premier enjeu judiciaire, digne de l’époque où l’écrivain Fernando Arrabal était condamné par le régime franquiste pour avoir outragé le Christ. Le détournement de la Cène, depuis une publicité pour Volkswagen jusqu’à celle de Marité et François Girbaud, est devenue un nouveau sujet de colère divine.
« L’affaire Larry Flynt » avait été l’occasion, en février 1997, d’une étonnante mise en abîme : les demandes d’interdiction visaient l’affiche d’un film de Milos Forman, qui relatait lui-même les démêlés d’un éditeur de revues pornographiques avec la censure… L’affiche litigieuse représentait le héros nu, le sexe caché par un drapeau américain, en position de crucifié sur un immense corps féminin. « Compte tenu de l’état actuel de l’évolution sociale », le tribunal n’avait cependant pas vu dans cette affiche un « outrage flagrant aux sentiments religieux des requérants ».
En pratique, les juridictions accueillent plus facilement les actions contre les éléments visibles par le plus grand nombre : les affiches de films, les publicités sont particulièrement visées, tout comme… les couvertures de livres.
En 1995, des intégristes avaient même sévi judiciairement contre une couverture (de magazine) qui titrait : « Pourquoi Dieu n’aime pas les femmes »… La discrétion serait donc de rigueur : l’« affaire Rushdie » a permis au Tribunal de grande instance de Paris, en 1989, de débouter les plaignants, notamment au motif que « personne ne se trouve contraint de lire un livre »… Il en a été jugé presque de même en septembre 2002 en faveur de Michel Houellebecq, puis, en 2007, dans l’affaire dite des caricatures de Mahomet, publiées par Charlie Hebdo.
Exhibition/Exposition
La constitution d’entités juridiques aux seules fins d’agir sur le terrain du droit remonte aux années 1980. Mais, dès 1977, l’association pour la conscience de Krishna a agi en France, en vain, contre un film pornographique mettant en scène un de ses adeptes. La photographe Bettina Rheims a également connu les foudres des défenseur d’une certaine censure.
En 1998 sort l’ouvrage I.N.R.I. de la fameuse photographe et de Serge Bramly, proposant une relecture de l’imagerie évangélique, et comportant ainsi de nombreuse photographies du Christ en correspondance avec notre époque. Certains crient alors au scandale. Parmi eux, l’abbé Philippe Laguérie, prêtre intégriste, qui porte plainte contre trois librairies bordelaises. Blasphème, censure. Le juge des référés du Tribunal de Bordeaux décide que le livre de photographies dont la couverture présente une femme torse nu crucifiée, ne pourra pas être exposé à la vue du public. Autrement dit : rangez s’il vous plait ce livre qui outrage la croyance chrétienne dans un coin où personne ne le verra. Heureusement, la cour d’appel de Bordeaux reviendra sur cette décision et le livre retrouvera sa place dans les librairies.
Toutefois, les ennuis judiciaires d’I.N.R.I. ne s’arrêtent pas pour autant. Et pour cause, en parallèle de l’abbé bordelais, l’association chrétienne AGRIF – la même qui avait attaqué l’affiche du film Larry Flynt – attaque devant les juridictions parisiennes les auteurs du livre ainsi qu’Albin Michel en sa qualité d’éditeur. Est toujours visé la couverture du livre, visible par un plus grand nombre que les photographies présentées dans l’ouvrage. L’AGRIF perd mais s’accroche, et le 14 novembre 2000, la Cour de cassation est obligée de revenir sur la décision des juges d’appel en raison d’une violation d’une règle procédurale. L’affaire est de nouveau examinée par la cour d’appel de Paris. L’association est encore déboutée, et cette fois-ci, la cour met fin à toute ambigüité en affirmant notamment que « la liberté d’expression qui demeure le principe n’apparaît pas dévoyée », que « le seul fait de s’exposer à voir l’ouvrage et sa couverture sur les rayonnages ou sur les tables à l’intérieur d’une librairie puisse constituer le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite allégués » par l’AGRIF.
En 2005, c’est l’épiscopat lui-même, via une association ad hoc, qui retrouve ses mauvaises habitudes, fustigeant la représentation de la Cène incarnée par des femmes et la présence d’un corps masculin assez chastement dénudé...
Les attaques contre les films Ave Maria de Jean-Luc Godard (en 1984, entraînant le retrait de l’affiche du film), La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese (en 1988, aboutissant au rajout d’un avertissement en début de film) avaient déjà attesté de cette vigueur retrouvée qui, a, heureusement, trouvé une certaine limite en justice. Les activistes religieux déboutés dans les affaires Houellebecq ou encore Charlie Hebdo n’en ont pas moins attisé la haine et l’imbécilité qui ont conduit à ce mercredi noir du 7 janvier 2015, et donc au jeudi et au vendredi qui ont suivi, puis au 14 février à Copenhague.
Les arts plastiques nous fournissent de « beaux » exemples de cette ambiance où le délit de blasphème semble de retour. Intéressons-nous au cas d’Andres Serrano et de œuvre Piss Christ, créée en 1987.
Il s’agit d’une photographie d’un crucifix plongé dans un liquide orangeâtre, nimbé de mignonnes petite bulles poétiques évoquant l’immensité galactique – et rappelant l’un des plus beaux passages d’Histoire de l’œil : « la Voie lactée, étrange trouée de sperme astral et d’urine céleste à travers la voûte crânienne des constellations » –, ou des bulles de soda dans un verre, derrière l’écran duquel un inconnu dans une église regarderait le Christ en croix… Le Fils de l’Homme, auréolé d’une gloire incandescente, semble en suspension dans l’espace ».
À première vue, donc, l’œuvre d’Andres Serrano relève de l’expérience mystique. Que le spectateur prenne cependant la peine de s’approcher et de lire le titre dont l’artiste a affublé sa photographie, il redescendra vite des hauteurs où l’avait transporté sa contemplation ! L’œuvre représente aussi (ou surtout) un crucifix plongé dans de l’urine. Au fond, le cliché de Serrano est une bouffonnerie en trompe-l’œil qui s’amuse de la naïveté des dévots. Certains ne trouvent pas ça drôle.
En 1989, l’artiste américain reçoit un prix de quinze mille dollars remis par un organisme, le National Endowment for the Art, qui dépend du gouvernement américain. L’affaire prend de l’ampleur lorsque des élus s’enquièrent d’en débattre au Sénat en mai 1989, sur fond de controverse autour de l’utilisation de l’argent du contribuable américain. Au cours de son intervention, le sénateur républicain Alfonse D’Amato déchire une reproduction du cliché – l’on n’ose imaginer la réaction des zélateurs du Tea Party si Piss Christ avait vu le jour ces dernières années… Lors d’une rétrospective du travail d’Andres Serrano organisée à la National Gallery of Victoria de Melbourne (Australie), deux adolescents font irruption dans la salle où est accrochée l’œuvre et la détruisent à coup de marteau. Le directeur du musée décide d’interrompre l’exposition.
Nouvel accès de violence iconoclaste dans une galerie en Suède en 2007 où des militants d’extrême droite se livrent à un saccage en règle des œuvres d’Andres Serrano exposées, puis à Avignon en 2010 où des jeunes gens investissent les salles d’une exposition organisée par le galeriste Yvon Lambert et intitulée « Je crois aux miracles », agressent l’un des gardiens et détruisent deux œuvres de l’artiste – dont le désormais fameux Piss Christ – à coup de tournevis, marteau et pic à glace. Au cours des semaines précédentes, diverses associations avaient demandé le retraits des travaux de l’artiste américain – « une profanation ignoble du Christ » – et, devant les échecs de leurs démarches judiciaires, avaient saturé la boîte électronique du galeriste d’une trentaine de milliers de mails. La censure à l’heure d’Internet. Noyer un crucifix dans un verre d’urine, n’est-ce pas le geste ultime de la révolte nietzschéenne contre deux millénaires de pensée chrétienne ?
Le droit à l’humour (et à la caricature)
Il n’existe pas de droit à l’humour, pas plus que de droit au roman ou de droit au pamphlet. Il n’existe donc aucune aucune définition juridique de l’humour : les textes en vigueur en matière de droit de l'information, c’est-à-dire restreignant la liberté d’expression, n'y font aucunement référence. En pur droit, il ne s'agit donc en aucun cas d'une « excuse » véritable aux poursuites exercées sur le fondement des délits de diffamation et d'injure, ou encore d’incitation à la haine raciale tels que prévus notamment par la loi du 29 juillet 1881.
Il existe cependant une tolérance traditionnelle de la jurisprudence au profit du rire, comme il subsiste, ça et là, une sorte de « droit de critique », en particulier dans le cadre de la vie politique. Une grande partie des mécanismes juridiques de censure s'est construite sous l'Ancien Régime pour lutter contre le genre pamphlétaire. Les juridictions françaises ont eu l’occasion de se pencher sur le pamphlet et sa compatibilité avec la liberté d’expression.
Charlie hebdo aurait franchi la ligne jaune. C’est du moins ce qu’affirmaient, au-delà des adeptes de Mahomet et aux dires de sondeurs, plus de 40 % des Français dix jours après les attentats. La caricature, au sens où l’entendent les lecteurs comme les détracteurs de Charlie Hebdo ou du Canard enchaîné n’est pas plus évoquée en droit français que le droit à l’humour. Elle ne bénéficie en fait que d’une tolérance de la part des juridictions françaises.
Un dessinateur peut ainsi forcer le trait et altérer les caractéristiques physiques ou la personnalité d’une individu, heurter des sensibilités, ou encore choquer sans pour autant qu’il s’agisse d’injure ou de diffamation au sens de la loi. Ce seront les juges qui détermineront si, oui ou non, les limites de la liberté d’expression ont été franchies à travers la caricature.
Dans le cas des caricatures, la frontière juridique entre l’humour et ces interdictions est parfois difficile à cerner. Le journal Charlie Hebdo, et son prédécesseur Hara-Kiri, qui ont connu de nombreux procès figurent parmi les meilleurs exemples pour observer ce qu’il est ou non permis de dessiner.
Le 9 novembre 1970, meurt Charles de Gaulle dans sa propriété de Colombey-les-Deux-Églises. Quelques jours plus tard, l’hebdomadaire Hara-Kiri titre : « Bal tragique à Colombey – 1 mort », en référence à l’incendie d’une boite de nuit au bilan humain important. Verdict, le journal « bête et méchant » est immédiatement interdit par Raymond Marcellin, ministre de l’Intérieur, au motif que c’est une publication « dangereuse pour la jeunesse ». C’est le motif officiel.
L’hebdomadaire avait publié, quelques temps auparavant, des dessins de sexe masculin et c’était alors attiré certaines critiques. C’est pourquoi l’interdiction concernait la vente et l’exposition de l’hebdomadaire aux mineurs ainsi que sa publicité par voie d’affichage. Ce sort, réservé d’ordinaire aux revues pornographiques, emportait nécessairement un funeste destin pour Hara-Kiri, tant la diffusion était désormais restreinte.
Pourtant, un scandale n’est pas une procédure, et en l’espèce il n’existe pas la moindre trace de poursuite judiciaire visant le journal consécutive à l’épisode des zizis. Il faut donc que l’autorité se soit permis quelques libertés avec la loi. Dans le but d’accélérer la procédure d’interdiction, il semble que l’Intérieur ait falsifié les dates, s’emparant opportunément du prétexte de zizis dessinés dans le journal dans un second temps afin de dissimuler la vraie raison de ses foudres : l’offense au Général.
Même si c’est au prix de l’un des mythes les mieux ancrés de la geste hara-kirienne, le déroulement chronologique des faits ayant abouti à l’interdiction de l’hebdomadaire satirique oblige à accorder quelque crédit à la version fournie par l’Intérieur. Bien sûr, on marche sur des œufs, mais, en rapportant ce que l’on sait des pesanteurs administratives à la vitesse d’exécution de la sentence ministérielle, il est permis de se demander si les zizis dessinés peu avant par Cabu et Willem ne sont pas les vrais responsables de la mort d’Hara-Kiri.
Charlie rarement condamné
Comme à Charlie Hebdo, son successeur, l’illustration qui devait figurer chaque semaine en couverture du journal était la grande affaire de la rédaction, alors réunie pour une bouillonnante séance de remue-méninges potache. Cette fois-là pourtant, il n’y eut pas de dessin. Delfeil de Ton, qui animait la rubrique « Les lundis de Delfeil de Ton », relate l’épisode : « La couverture, c’était tout le temps un grand dessin. C’était un travail collectif, et on y passait des heures : les dessinateurs gratouillaient et nous les écrivants, on critiquait, etc. Et à la mort de De Gaulle, ils ont merdé et à minuit on n’avait pas encore la couverture. Rien à faire. Parce que profondément on s’en foutait, De Gaulle c’était zéro, c’était rien. Et alors le professeur Choron lâche ce titre “Bal tragique à Colombey : un mort”, parce qu’il y avait eu, dix jours avant, le bal tragique à Saint-Laurent-du-Pont (…). Et on a éclaté de rire, mais il n’y avait pas de dessin à faire : ça se suffisait. C’était se moquer de De Gaulle mais aussi de la presse, du sensationnalisme. C’est la seule couverture de l’hebdo qui n’a pas été dessinée, et c’est la plus célèbre. » Et la plus fatale au journal. Sauf qu’il en fallait davantage pour ébranler le Professeur Choron, Cabu, Cavanna, Reiser, Siné et le reste de la joyeuse bande.
Une semaine ne s’est pas écoulée depuis l’interdiction, que le premier numéro de Charlie Hebdo voit le jour, le 23 novembre 1970. La légende dorée du nouvel hebdomadaire attribue au « grand Charles » l’origine de son nom… C’aurait été un bel ultime hommage, mais ce n’est qu’une légende. La réalité, c’est que les éditions du Square possédaient depuis longtemps deux journaux, Hara-Kiri et Charlie, mensuel de BD qui devait son titre au personnage de Charlie Brown, des Peanuts. Le premier étant frappé d’interdiction, l’autre périodique de la maison est passé d’une fréquence mensuelle à une fréquence hebdomadaire et a pris le titre de Charlie-Hebdo. La réalité est toujours plus prosaïque.
Le nouveau journal a connu à son tour de nombreux procès et en a gagné la grande majorité (notamment contre des associations religieuses ou des particuliers). La Cour de cassation peut également voler au secours des dessinateurs de l'hebdomadaire et de la liberté d'expression. Ainsi, dans un procès intenté par un fils de harki et une association d'anciens combattants harkis, concernant une caricature où ces derniers s'estimaient qualifiés de « traîtres à la patrie », la cour d'appel qui avait retenu l'injure raciale a vu son arrêt cassé par la Haute juridiction.
Charlie Hebdo a en revanche parfois perdu, comme en 2005, lorsque un dessin de Charb représentant le ministre de la Fonction publique de l’époque, Renaud Dutreil, en uniforme nazi est publié. L’année suivante, le Tribunal de grande instance de Paris condamnera Philippe Val, alors directeur de la publication, à 2000 euros d'amende et le dessinateur à 1000 euros.
Mais, dans la grande majorité des cas, l’hebdomadaire n’a pas été condamné car les juridictions ont considéré que les limites de la liberté d’expression n’avaient pas été franchies. Et l’affaire la plus symbolique reste celle de la publication des caricatures représentant Mahomet en 2006 qui se prolonge encore et toujours tragiquement avec l’assassinat de Samuel Paty.
Cette tragédie que l’on espère candidement ultime permettra-t-elle enfin à la République de rappeler ses valeurs et de les faire respecter ?