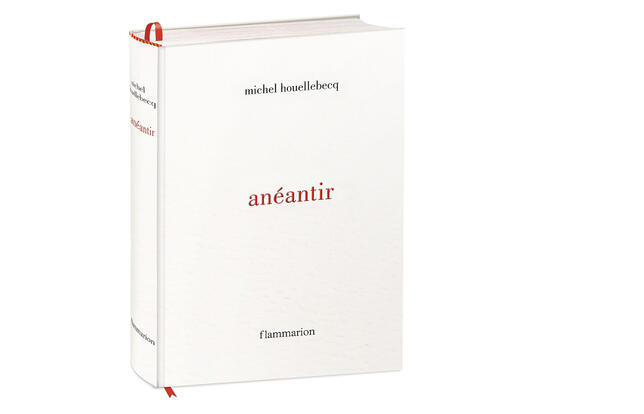Michel Houellebecq eût certainement été, depuis Claude Simon, l’écrivain français méritant le plus le Prix Nobel, si seulement cette institution n’en était pas venue à rechercher d’abord les messages positifs. Malheureusement, la littérature – en tout cas celle qui se pense comme un absolu depuis environ deux siècles – s’accommode mal du progressisme. Elle s’inscrit souvent à rebours de son époque dans une espèce de temps immobile où la nostalgie d’un paradis perdu a plus de poids que les projets d’avenir.
Je le regrette personnellement et n’adhère pas aux positions réactionnaires de Houellebecq sur les femmes, la fin de vie, la PMA, l’ethnicité. Par ailleurs, bien que nourri du plaisir solitaire du lecteur occidental rompu à l’exploration de son espace intérieur, je sais que le livre ne peut plus se donner l’illusion, comme ce fut le cas pour Ulysse, de rassembler l’univers dans une coquille de noix. Mais, mon profond ébranlement à la sortie des 700 pages d’Anéantir m’a tout de même suggéré que « l’art du roman » pouvait peut-être encore approcher de cette expérience de pensée totale dont nous parle Kundera. Aussi, je me demande avec stupeur comment des critiques patentés ont pu s’ennuyer à la lecture de ce véritable chef-d’œuvre. A moins qu’ils n’aient de toute façon dormi à la lecture de La Mort de Virgile, cet autre chef-d’œuvre selon Kundera, ou, plus sûrement, qu’ils n’aient eu peur de leur ombre en donnant crédit à un admirateur de Joseph de Maistre.
Davantage que dans ses autres livres, le style sans effet de style de Houellebecq atteint ici une sorte de superfluidité sans aucune aspérité qui transforme les personnages, les paysages, les situations, en une évidence, proche, unique, émouvante. Ils sont comme plongés dans un espace des phases – l’espace des possibles cher à Houellebecq – que borne seulement l’abstraction d’une reliure immaculée. L’idéal du livre en somme, non pas comme représentation du réel, mais comme transposition de celui-ci dans une autre dimension où il joue de lui-même sa propre partition.
Le drame balzacien auquel nous convie Anéantir entre les frondaisons provinciales du Beaujolais et les allées du pouvoir ne charrie plus les mordorures de la Comédie Humaine. Il n’emprunte pas davantage les tournures cliniques d’un Flaubert se regardant écrire ou la phrase labyrinthique d’un Proust à la recherche de son passé. Comme si les efforts de style de ses prédécesseurs tombaient encore dans l’illusion positive d’un monde à construire ou à reconstruire. Houellebecq plus que tout autre écrivain d’aujourd’hui en est revenu. Son œuvre qui semble seulement couler au fil de l’eau sonne comme un point final ou, du moins, un point de suspension.
Le livre et la littérature ne sont pas finis pour autant, bien sûr. Mais, ils sont voués à rejoindre, en tant que médias, le vaste écosystème de la communication et de ses interactions. A s’y recharger en images nouvelles, en sensations exotiques, en idées venues d’ailleurs. Et, surtout, à s’y impliquer avec tout le pragmatisme nécessaire. Pendant ce temps-là, Houellebecq, bien que totalement immergé dans la vie quotidienne de son 13ème arrondissement de Paris et parfaitement au fait aussi bien des dernières avancées des biotechnologies que de la culture populaire, referme, sans cérémonie, le tombeau de l’occident littéraire et du livre absolu.