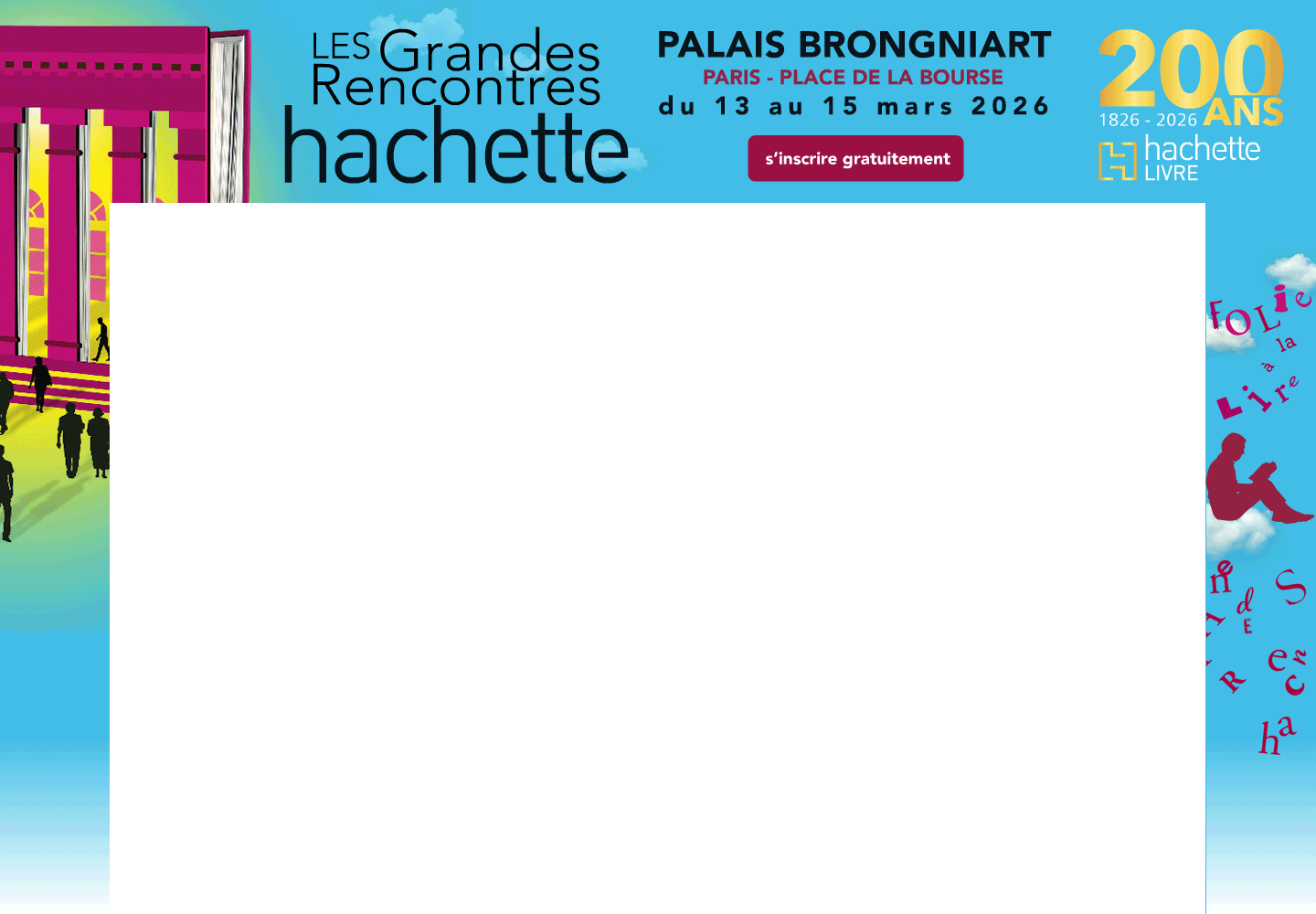Certains grands écrivains sont des juges. D’autres, des flics. D’autres encore, des bandits en cavale. Joan Didion est un médecin légiste. Voilà cinquante ans qu’elle ausculte le cadavre du rêve américain, en se perdant en conjectures lumineuses sur les causes du décès. Depuis 1963 et la parution de son premier roman, Run river. C’est celui-ci qui est enfin traduit en français (par Philippe Garnier, et de fort belle manière) sous le titre Une saison de nuits (qui correspond au titre de travail de Didion avant que son éditeur américain ne l’en fasse changer).
De quoi s’agit-il ? Comme souvent chez elle, de la chute des empires, du fracas et de la douceur de ce désastre. Rien n’aurait dû amener le couple formé par Everett et Lily McClellan, fils et fille de bonne famille patricienne californienne, à se briser le jour où le premier colla une balle dans la tête à l’amant de la seconde. Mais rien non plus n’aurait dû amener l’Amérique à perdre son innocence, si ce n’est, en cette même année 1963, une autre balle qui stoppa net au Texas la trajectoire du plus jeune de ses présidents… Comme à JFK, tout avait été promis à Everett et Lily, et tout leur fut retiré. Peut-être seulement leur manquait-il de pouvoir être considérés comme des individus et non seulement comme des bâtisseurs, des témoins impavides d’une grandeur introuvable. Alors qu’elle n’avait pas 30 ans, Didion fréquente déjà les hauteurs qu’elle ne quittera plus. Cette Saison de nuits est comme une suite enténébrée de Tendre est la nuit de Fitzgerald, écrite par une lectrice de Nabokov et de Mailer. Depuis, Didion a volontiers renié ce coup d’essai, lui trouvant une tonalité empreinte de la nostalgie d’un temps de pionniers qu’elle considère comme fallacieux. Pourtant, les lecteurs de son récent ouvrage, Le bleu de la nuit (Grasset, 2013), ne s’en laisseront pas compter : d’un désastre l’autre, c’est bien la même femme qui parle. O. M.