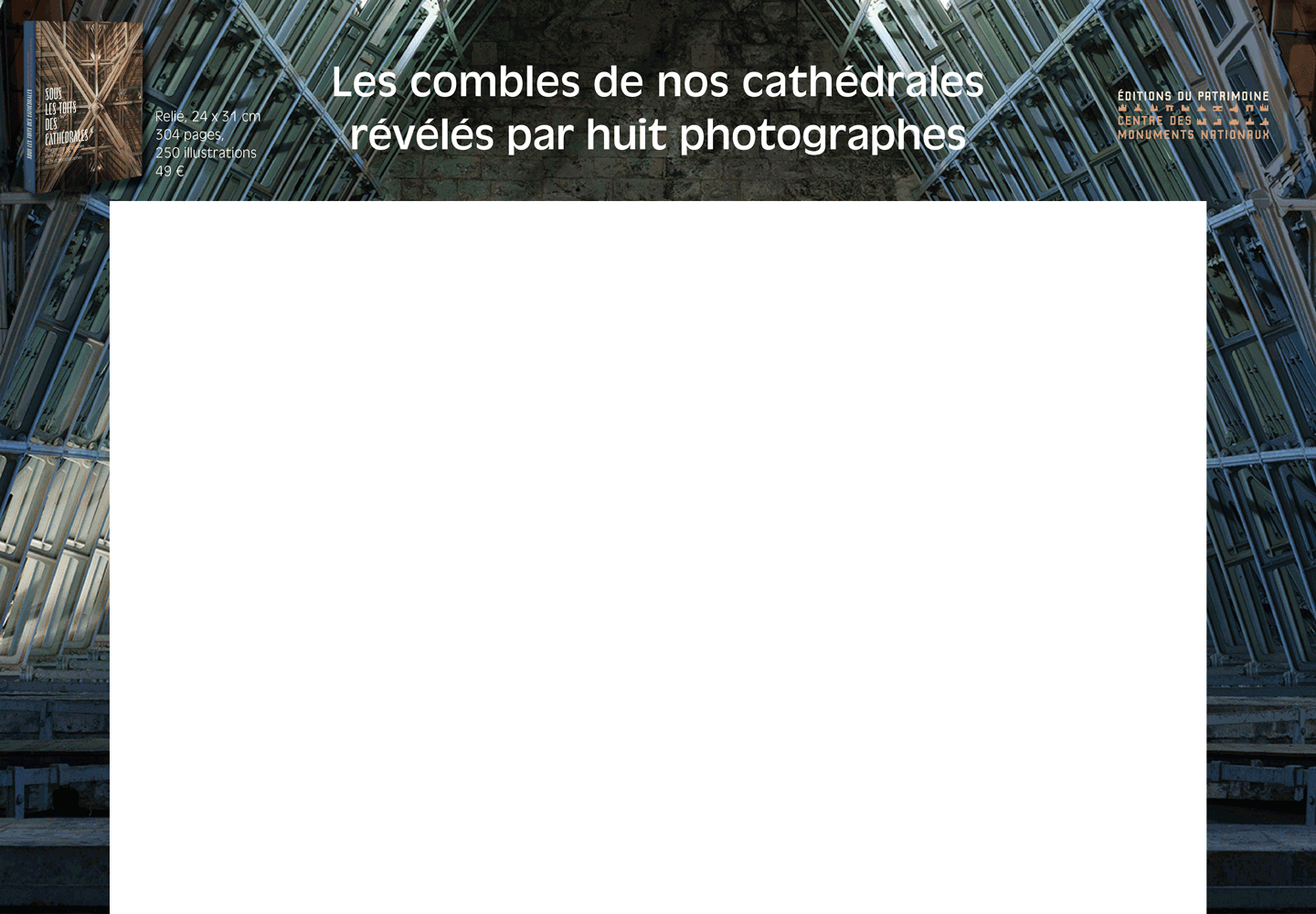Que les titres de ses romans n’induisent pas en erreur le lecteur encore innocent : Alan Pauls n’est pas un écrivain romantique. Il déteste la nostalgie (il préfère l’anachronisme), n’idolâtre pas la mémoire, a la phobie du témoignage dont il méprise le chantage à la légitimité. Il a foi au contraire dans le faux, l’indirect, l’oblique qu’introduit la littérature. Les livres de l’écrivain argentin - dont le dernier, Histoire de l’argent, est le septième traduit en français chez Bourgois - tiennent ainsi sujet, personnages, épanchements sentimentaux à distance pour camper sur les bords, dans les entre-deux. Explorant les sous-couches et les replis du temps entre fiction et essai, à teneur autobiographique variable et diluée. A 54 ans, adoubé par les plus vénérés de ses pairs, Roberto Bolaño en tête, qui lui avait décerné il y a dix ans déjà le titre d’« un des meilleurs écrivains latino-américains vivants », l’homme du Rio de la Plata se voue avec une constance ferme et têtue, en bon prof de théorie littéraire qu’il fut, amateur des classiques européens du XIXe et du XXe siècle et lecteur de Barthes, à élaboration d’une œuvre où les contraintes libèrent, où des phrases allongées d’incises et amplifiées de parenthèses imposent moins des images qu’une musique. Citons son énorme roman Le passé, prix Herralde 2003, pleine et tragique chronique d’un amour, des essais qui enfilent leurs maillots de bain pour théoriser sur la plage (La vie pieds nus, 2007) ou qui transforment l’exercice d’admiration en itinéraire de découverte (Le facteur Borges, 2006, prix Roger-Caillois 2007)…
Alors qu’après Histoire des larmes (2009) et Histoire des cheveux (2011) paraît le troisième et dernier volet de sa trilogie romanesque consacrée aux années 1970 en Argentine - temps et lieu secoués de sa jeunesse -, Alan Pauls revient dans un français d’une fluidité épatante sur ce projet cadré à l’intérieur duquel s’associent pourtant sans entrave résonances et digressions. Il évoque ses filiations littéraires, sa vieille liaison avec le cinéma, sa fidélité à une certaine idée de la littérature qui questionne sa forme et ses moyens. Propos d’un écrivain toujours en train de se demander ce qu’il raconte.
Votre trilogie à présent terminée, dans quel état d’esprit êtes-vous ? Soulagé ? Déprimé ?
C’est un soulagement, en effet. Non dans le sens d’un tourment qui s’achève. Mais c’est un projet qui m’a pris presque sept ans et, après tout ce temps, je suis très curieux de voir comment va le monde… Bien sûr, je me sens un peu orphelin mais j’aime beaucoup ça, ça me rafraîchit.
Avez-vous le sentiment d’être allé au bout de ce que vous aviez en tête ? Le projet a-t-il évolué en cours d’écriture ?
Au départ, je pensais à des textes plus courts et j’ai aussi eu l’idée de publier les trois volets en même temps… Mais sinon, une fois que j’ai eu trouvé les trois éléments - les larmes, les cheveux et l’argent, ce que j’appelle les trois fossiles autour desquels je voulais évoquer les années 1970 -, j’ai suivi très respectueusement l’ordre chronologique dans lequel j’avais prévu d’écrire chacun des titres. De même, le temps d’écriture de chaque volume s’est bien distribué, même si le premier a été écrit un peu plus vite dans l’élan du démarrage. C’était un projet très discipliné auquel je me suis fidèlement tenu. Je suis très fidèle, cela m’aide beaucoup à aller au bout des choses. Renoncer pose beaucoup plus de problèmes. Et le cadre que je me suis donné m’a aidé à soutenir le projet tout en me laissant une très grande liberté d’écriture. Ainsi je n’ai jamais eu l’impression de sombrer dans la routine, d’être dans l’exécution d’un programme.
Pouvez-vous rappeler quel était le cahier des charges ?
Il était surtout formel : écrire au présent et à la troisième personne, mais dans une structure temporelle de va-et-vient entre différentes époques. Un contre-pied aux livres de témoignages, nostalgiques, que je déteste et qui parlent au passé et à la première personne. Je voulais aussi conserver le même personnage principal, à plusieurs moments de l’enfance et de l’adolescence. Enfin, plutôt m’intéresser à la première partie de cette décennie où j’ai fait mon éducation sentimentale, politique, esthétique…, me concentrer sur la période de 1970 à 1976, des années d’espoirs et de luttes révolutionnaires, sur laquelle il n’y a pas autant de consensus culturel que sur la dictature militaire après 1976 et jusqu’en 1983. Mais ce cadre de départ posé, à l’intérieur tout était très libre. Je ne m’étais fixé aucun plan, aucune autre contrainte.
A première vue, l’argent semble avoir un statut un peu différent et apparaît comme un élément moins organique que les deux autres fossiles que vous avez choisis.
Non, je vois une cohésion : larmes, cheveux et argent ont en commun d’être trois choses assez menacées, que l’on perd, que l’on peut perdre, que l’on a peur de perdre, que l’on ne veut pas perdre… Que l’on produit et gaspille quotidiennement. L’argent ne fait pas exception, surtout sous la forme dont je parle, le cash, dont les Argentins ont toujours eu le culte et particulièrement dans ces années-là. Ce sont également trois choses avec lesquelles on est dans un régime de promiscuité, dans une intimité corporelle, que l’on exhibe. Ça peut être éventuellement sale et l’on peut le falsifier aussi, bien sûr : il y a des larmes de crocodiles, des perruques, de la fausse monnaie…
On relève toujours le côté proustien de votre style, plus rarement la dimension humoristique de vos livres. Est-ce un aspect que vous travaillez ?
Plutôt que l’humour, qui précisément se travaille, je dirais que le rire m’intéresse : c’est plus sauvage, plus involontaire, plus intempestif. Il surgit quand tout est un peu en ruine et c’est cela, que l’on trouve chez Kafka et Beckett, ou même chez Céline que j’ai relu récemment, qui me plaît et que je recherche. Rien n’est intrinsèquement comique. Il s’agit de pousser les choses jusqu’à un certain seuil. C’est une question de concentration, aussi. Mais même si elle est un peu difficile à voir, je suis fier de la zone hilarante que l’on peut trouver dans mes livres. Et je m’amuse beaucoup en écrivant, parfois…
Comme Rimini, le héros du Passé, vous êtes également traducteur, et vos livres sont traduits dans une douzaine de langues. Posent-ils des problèmes particuliers aux traducteurs ?
S’il y a un problème de traduction, pour moi c’est génial. Traduire est une opération très complexe de croisement de cultures, de préjugés, de signes d’identité que l’on croit reconnaître, que l’on ne reconnaît pas. Alors si ça coule, ça ne va pas… Quant à être traduit, c’est exposer ce que l’on écrit à une sorte d’inconnu total. En Argentine, je peux connaître ma position dans le champ de la littérature hispanophone ou même latine, identifier le cercle de mes lecteurs, mais quand je suis traduit en Russie ou en Grèce, cela fait l’effet d’entrer dans une dark room : je n’ai aucune idée de ce que l’on peut penser de mes livres. Tous les malentendus sont possibles. Le cas du français est un peu à part, car j’ai un rapport très fort avec la culture et la langue françaises.
Du coup, l’étiquette « écrivain argentin » a-t-elle un sens pour vous ? Vous sentez-vous appartenir à une communauté littéraire ?
Oui, je peux dire que je me sens un écrivain argentin. Mais le pays est très grand et je me revendique surtout d’une certaine tradition littéraire de Buenos Aires ou plus largement du Rio de la Plata. Non que je défende là une identité solide, substantielle, mais je partage des marques spécifiques. Je me reconnais par exemple dans le manque de « naturalité » de mon rapport à la littérature, dans cette mise en jeu permanente d’une « naturalité » du récit. Quand j’écris, je ne me laisse pas entraîner dans la narration comme peuvent le faire d’autres écrivains, ailleurs, en Amérique latine. J’écris toujours dans un état de perplexité, sans cesser de me demander ce que ça veut dire de raconter une histoire, et c’est une caractéristique que l’on trouve chez Borges, mais aussi chez Cortázar ou Manuel Puig… Mes narrateurs eux-mêmes, d’ailleurs, ne comprennent pas exactement ce qu’ils racontent. Mais la littérature argentine est en train de beaucoup changer et je représente peut-être la dernière génération d’écrivains qui croit en la littérature de cette façon, qui a ce type de foi littéraire.
Comment la nouvelle génération aborde-t-elle cette question ?
A Buenos Aires aujourd’hui, tous les écrivains ont 35 ans ! Pour ceux-là, dont certains sont très bons, cette croyance dans la dimension problématique de la littérature qui, pour moi, est très désirable, est un obstacle : le programme de cette génération va vers le fluide, le relaxé. Mais il y a encore des écrivains - comme César Aira, qui est très important pour ces jeunes auteurs - qui combinent parfaitement cette tendance liquide, très narrative, et la tendance problématique qui a le goût du paradoxe, de ce qui cloche.
Mais cette évolution n’est-elle pas une conséquence du fait que la figure de lecteur forcené que vous avez incarné adolescent n’existe plus ? Que la lecture, cette « passion asociale » qui pour vous a été « légalisée » dans l’écriture, comme vous avez pu le dire, n’est plus l’élément central de la formation de ces jeunes écrivains ? Que ce rapport aux livres a disparu ?
Je n’aime pas l’apocalypse. On a annoncé et on annonce tous les jours la mort de tout, des livres, du roman, du cinéma… Je crois qu’il n’y pas de morts ou alors qu’il faut s’attendre à leur résurrection immédiate. Il y a plutôt une simultanéité de tendances, de pratiques. Certaines entrent dans des périodes de latence, d’hibernation. Je crois plus à la logique bactérienne, virale, qu’à la biologique avec ses cycles naissance-apogée-déclin-disparition : les choses changent de place, « s’invisibilisent », mais cela ne signifie pas qu’elles sont moins actives.
Ces dernières années, mis à part vos activités journalistiques, vous vous êtes exclusivement consacré à l’écriture de la trilogie. Avez-vous commencé un nouveau livre ?
Je suis sur le point de terminer un essai biographique de commande sur le cinéaste franco-chilien Raoul Ruiz. J’avais à l’esprit depuis longtemps l’idée d’écrire une biographie, alors que c’est un genre que j’ai longtemps détesté et que je n’ai lu que très tard. Je n’ai en effet aucun fétichisme vis-à-vis des artistes. Lorsque j’étais petit, je pensais par exemple que tous les écrivains étaient morts et je ne voulais rien savoir sur leur vie. Puis, il y a quelques années, j’ai lu RolandBarthes par Roland Barthes et je me suis dit : voilà quelqu’un qui a trouvé une façon d’aborder la question de la vie et de l’œuvre. Depuis, j’ai écrit quelques chroniques dans la presse qui flirtaient avec la biographie, après quoi on m’a proposé de travailler sur Ruiz que j’ai toujours admiré. Il incarne un profil d’artiste original dans le cinéma de l’Amérique latine et même dans le cinéma mondial, à la fois cinéaste culte, fabriquant des films expérimentaux, mineurs, et cinéaste commercial tournant des gros films avec des acteurs prestigieux comme Le temps retrouvé ou Mystères de Lisbonne. Dans sa filmographie cohabitent le caractère artisanal et l’aspect mainstream. C’est quelqu’un qui a géré avec beaucoup de conscience sa position de cinéaste et qui poursuivait la même idée du cinéma quels que soient les films et le budget dont il disposait pour les tourner. Du coup, à l’occasion de la rédaction de cet essai, bien que ne pratiquant plus cette activité de façon professionnelle, j’ai traduit les deux tomes de sa Poétique du cinéma pour une édition chilienne.
Vous êtes toujours critique de cinéma ?
Je ne me considère pas comme un critique parce que je ne suis pas dans cette position d’un soldat sur un champ de bataille qui est, selon moi, celle d’un véritable critique, mais j’écris sur le cinéma et je continue de présenter des films pour une émission sur une chaîne du câble.
Un autre roman en vue ?
Je recueille et j’accumule en ce moment des éléments disparates magnétisés par un centre d’attraction encore presque invisible pour moi. Je crois que ça a à voir avec l’amour à distance, l’amour et la technologie, mais ce n’est pas clair. <