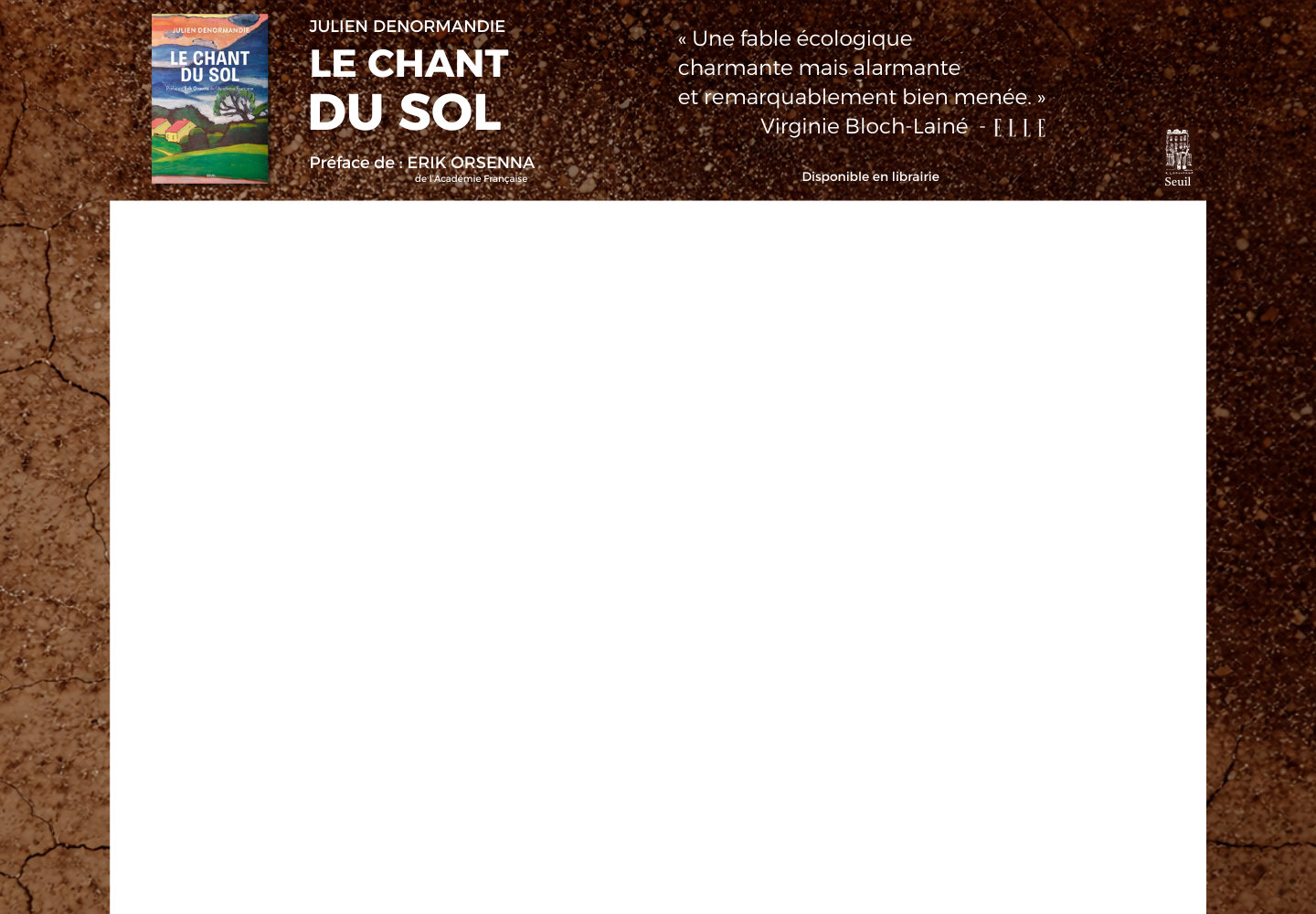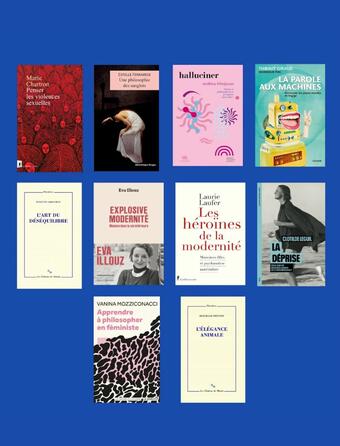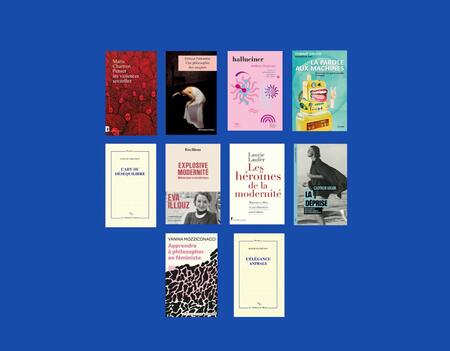Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1941, un homme et deux femmes sont assassinés au château d'Escoire, en Dordogne : Georges Girard, propriétaire du château, sa sœur Amélie et leur domestique, Louise Marie Soudeix. Un temps suspecté, Henri Girard, le fils de George, est finalement acquitté. Il deviendra écrivain, sous le pseudonyme de Georges Arnaud, auteur notamment du Salaire de la peur (1949) – un roman qu'il avait dédié à son père. Quand elle apprend qu'on la surnomme « la fille de l'assassin », Catherine Girard, fille d'Henri Girard, interroge son père qui reconnaît sa culpabilité. Mais cet aveu n'était que le point de départ d'une enquête au long cours visant à briser les chaînes d'un secret trop longtemps gardé. Roman d'une famille où l'amour est indissociable de la violence, In violentia veritas remonte à la source d'un mal systémique ayant conduit à l'irréparable. Avec ce livre, Catherine Girard entend rendre à son père sa vérité et sa dignité.
Livres Hebdo : L'écriture de ce livre s'est-elle imposée comme une nécessité et, si tel est le cas, pour qui l'avez-vous écrit ?
Catherine Girard : La genèse de ce livre s’inscrit dans une veine ancestrale. Nous sommes écrivains de père en fils, à raison d’un par génération. Cette fois, c’est une fille, et qui a pris son temps. Mais la raison qui a déclenché ce que j’aurais de toute façon écrit un jour, passe par l’amour filial. J’ai raconté ce drame à mes deux aînés, à l’âge où je l’avais appris moi-même.
« J’ai écrit ce livre pour mon père »
Il y a quatre ans de cela, mon fils aîné revient vers moi complètement effaré. Il a découvert que ce n’est pas Cécile – la grand-mère que ma mémoire avait inconsciemment substituée à Louise, la vieille servante –, mais Louise, que mon père avait tuée. Heureusement pour moi, mes gosses me savent sincère jusque dans mes mensonges. Il n’en restait pas moins que, tout en voulant livrer une vérité instillée par le fer dans notre sang, je leur avais menti. Cette fois, c’était à mes enfants que je devais rendre des comptes sur un grand-père qu’ils n’avaient connu qu’à travers ses romans et par l’image que, malgré moi, je leur en avais donnée, qui n’était autre que celle d’une sorte de demi-dieu tout droit sorti de l’enfer. Il était temps de découdre mes paupières d’enfant et de comprendre ce qui s’était passé. Je leur devais cette vérité. J’ai écrit ce livre pour mon père. J’ai voulu rendre au gosse qu’il avait été le regard qui lui a manqué, en réponse à l’enfance volée, à la violence inouïe qui l’ont conduit à cette tuerie. Lui rendre sa dignité avec sa vérité.
« La meilleure façon d’écrire cette histoire était d’en faire ce roman de ma famille »
Dans La Serpe (Prix Femina 2017), l'écrivain Philippe Jaenada revient sur le triple meurtre d'Escoire. Avez-vous écrit In violentia veritas en réponse à ce livre ?
Non. Je n’ai pas lu les livres qui ont été écrits sur le crime d’Escoire. L’homme qui m’intéressait n’est ni l’écrivain, ni l’assassin. C’est mon père. Je savais que personne ne savait, et nul ne pouvait avoir la grille de lecture qu’il fallait pour comprendre.
« Je découvris le deuil la première fois avec la mort de mon protagoniste de père » indiquez-vous au début du troisième chapitre d'In violentia veritas. Votre père est-il devenu un « protagoniste » le jour où il a accepté de livrer sa vérité, où il vous a dit « Je ne peux pas ne pas te répondre » ?
Mon père avait l’envergure d’un personnage de roman. La meilleure façon d’écrire cette histoire était donc d’en faire ce roman de ma famille. Faire revivre chacun m’a permis, en soulevant la chape de l’épouvantable vérité, d’en découvrir cent autres, moins flagrantes mais tout aussi pernicieuses, et qui ont irrigué l’artère de ce drame. L’autre avantage est qu’écrire, c’est être à la fois démiurge et esclave. Dès que le personnage prend vie, il tient lui aussi le fil de l’histoire, celui qui trace son destin et s’enchevêtre à ceux des autres. Son cœur se met à battre, ses rêves vous hantent et c’est par vos yeux que coulent ses larmes.
Avez-vous craint que l'amour porté à votre père contrevienne à l'impartialité de votre enquête ?
L’amour a été mon premier et mon plus grand obstacle. J’ai appris que mon père avait tué à l’âge où tout éclot. J’avais quatorze ans. J’ai enrobé cette vérité d’une gangue d’amour indestructible avant de l’enfouir tout au fond de mon cœur d’enfant. Il m’a fallu un demi-siècle pour que la confidence prenne enfin tout son sens sans atteindre l’amour pour un père d’exception, et pour que la violence puisse, toutes affres bues, dire son mot elle aussi. Je suis passée par des phases de colères insurmontables, à cause de l’amour.
« J’ai dû me faire la mère de tous et de chacun, aimer inconditionnellement mes personnages »
J’ai consulté les archives, comme font les enquêteurs, pour essayer d’avoir un point de vue plus factuel, moins empêtré dans les lianes de l’amour. Là encore, il a fallu des mois avant que mon regard n’accède à ce que je lisais plutôt qu’à l’épuisement, à la désolation, au marasme de l’âme que dessinait sa signature au fil des interrogatoires. Je l’ai fait pour comprendre. Comprendre n’enlève pas la souffrance, mais l’accompagne d’une corde intelligible. Je n’ai pas craint, j’ai redouté et cru que cet amour rendrait la chose impossible. J’ai renoncé pendant trois ans, m’interdisant l’indécence de ce qui n’aurait pu être qu’un galimatias, une jérémiade sentimentale, si je n’avais su séparer le regard de l’écrivain de celui de la fille.
Dans votre livre, vous évoquez à plusieurs reprises le « système » familial dans lequel votre père s'est trouvé enfermé, et qui pourrait expliquer son geste. En quoi ce système était-il délétère?
Le système familial que j’évoque est celui de la toute-puissance. Aristocratique, financière, sociale. Celui-là même que tous les penseurs, politiques ou pas, Platon en tête, n’ont eu de cesse de remettre en cause. Ce système, contre lequel Georges, mon grand-père paternel, s’était érigé par ses choix, par son mariage, par ses idéaux, l’avait rattrapé et enfermé dans une forteresse dans laquelle il dépérissait. Ce système encore, qui avait vidé l’âme d’Amélie de son essence de femme pour en faire l’exécutrice testamentaire d’une tyrannie séculaire. Ce système enfin qui avait fait que Louise, née pour servir, était morte en servante. C’est en cela qu’avec ses doubles portes d’or et de lumière, il était délétère. Georges dans sa jeunesse avait lui-même tenté en vain de le changer ; son fils – mon père –, reprenant le flambeau des mêmes idéaux, l’a mis à feu et à sang.
Votre père n'a pas été condamné, mais votre livre s'apparente malgré tout à une tentative de réhabilitation. Est-ce le cas ?
Dans les couloirs de ma maison d’édition, une éditrice est venue à moi pour me dire qu’elle avait beaucoup aimé mon livre, avant d’ajouter, avec un évident effort de délicatesse, qu’elle avait haï mon père. Cela m’a certes légèrement piquée, mais à la fois flattée. J’avais donc réussi ce qui m’avait semblé un défi impossible, tant je doutais de pouvoir me défaire de la gangue amoureuse dont j’avais entouré ce drame : le lecteur restait maître de ses sentiments.
« Je prête mes yeux au lecteur, des yeux aguerris contre leur propre cécité »
Pour y parvenir, j’ai dû me faire la mère de tous et de chacun, aimer inconditionnellement mes personnages – que j’aime réellement maintenant que je les ai rendus éternels, du moins sur le papier – aimer au point de m’autoriser la colère. Ne jamais les haïr, m’en tenir à mes ires. C’est d’ailleurs cette colère, qui m’a servi de phare pour comprendre noir sur blanc ce qui s’était passé. C’est dans cet ébranlement tragique que mon texte puise peut-être sa puissance. Je ne cherche ni à prouver, ni à expliquer, ni à justifier. Je prête mes yeux au lecteur, des yeux aguerris contre leur propre cécité, le regard que j’ai enfin pu avoir, une fois sortie de cette meurtrissure dans laquelle j’ai grandi. Mon cœur avait appris à battre dans la plaie éternelle que mon père s’était entaillée lui-même. Il y avait grossi, grossi comme un tas de cellules qu’il était, un tas de cellules affolées, grossi comme un cancer autour de ce mal fou dont mon vieux père ne s’est jamais défait. Mon livre est pétri de cette souffrance, de mes colères au vitriol, de cet amour aussi, car l’amour est indéfectible.