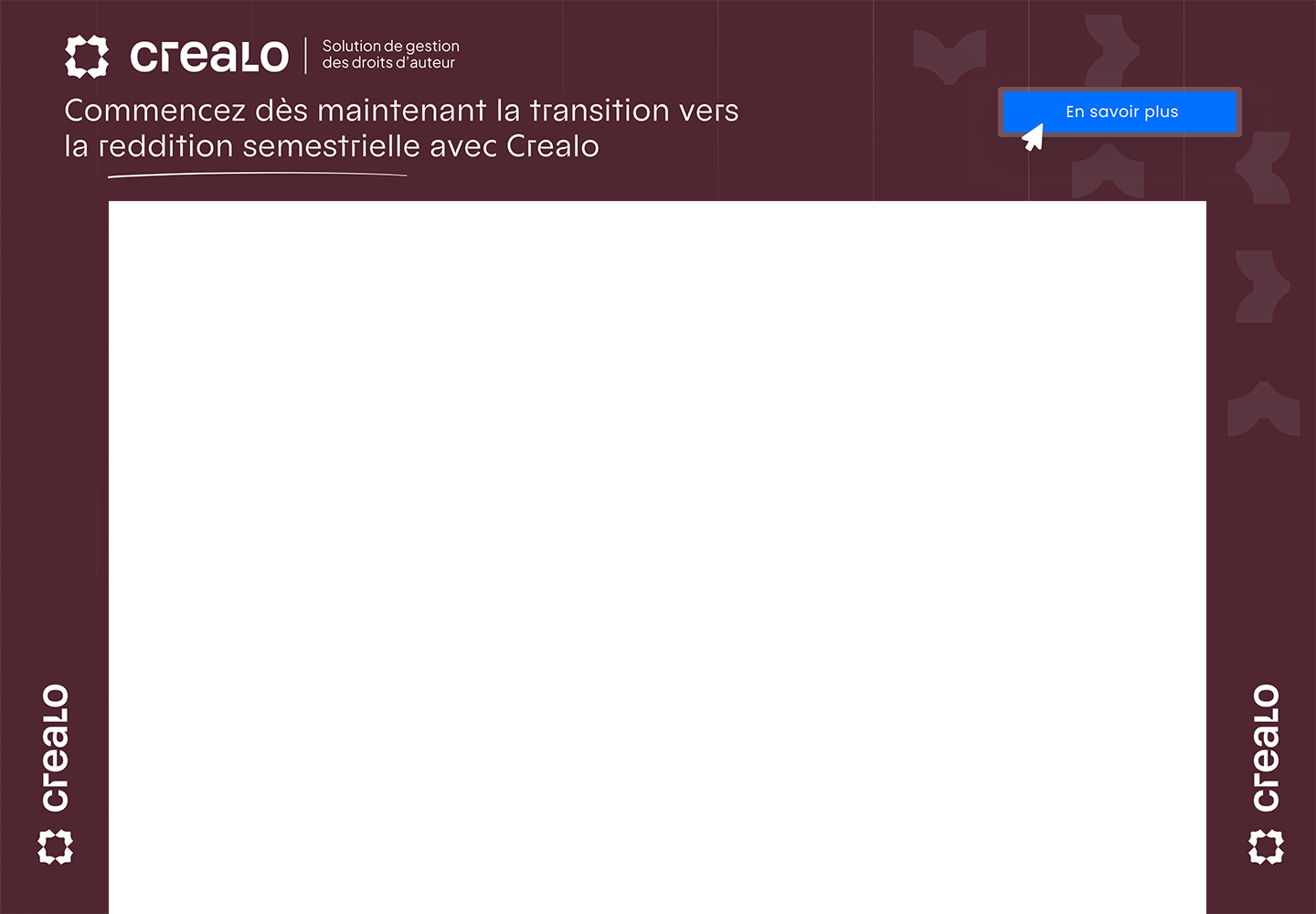Livres Hebdo : Début avril, les sénatrices Laure Darcos et Sylvie Robert ont déposé une proposition de loi visant à réformer les droits d'auteur, ajoutant au contrat d'édition un principe de minimum de droits d'auteur garantis. Qu'est-ce que cela change concrètement ?
Stéphanie Le Cam : Comme le principe d'avance sur droits, ce minimum garanti est une sorte de contrepartie à l'exploitation de l'œuvre. Or jusque-là, le régime juridique auquel était soumise l'avance supposait que celle-ci soit remboursée a posteriori, une fois l'œuvre commercialisée et rémunératrice. En pratique, les éditeurs n'ont jamais exigé ce remboursement, mais il manquait un cadre légal. Dans la future loi Darcos, la notion d'amortie figure toujours et l'entérine. C'est une légère avancée. Avec le minimum garanti, on interdit désormais que l'éditeur puisse demander un remboursement de l'avance. La proposition de loi indique aussi que ce minimum de droits d'auteur garanti est définitivement acquis lorsque le manuscrit a été remis à l'éditeur. Qu'importe si celui-ci décide de poursuivre ou non l'exploitation de l'œuvre. Autre point positif : les invendus, qui donneront désormais lieu à une rémunération, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Zones d'ombre
Sait-on à combien est fixé le minimum de droits d'auteur garanti ?
Justement, la formulation de la proposition de loi n'indique ni le montant du minimum, ni s'il est obligatoirement praticable. S'il n'y en a pas, cela signifie-t-il que le contrat d'édition n'a plus d'existence juridique ? On navigue un peu en eau trouble. Mais il y a un autre point juridique essentiel qui m'interpelle. La proposition de loi dit que le minimum garanti s'exerce au moment de la remise du manuscrit à l'éditeur. Et c'est assez logique, puisque ce principe est intégré au contrat d'édition qui porte exclusivement sur l'exploitation de l'œuvre. Mais ce système n'a pas été pensé, par exemple, dans le cas d'une commande passée à l'auteur. Autrement dit, le travail de création en lui-même ne fait toujours pas l'objet d'une rémunération à part entière.
Avez-vous pu mettre cette notion sur la table, en présence des sénatrices et des autres professionnels du livre ?
Pendant cinq ans, nous avons mené des concertations avec le Syndicat national de l'édition (SNE), la Charte, le Conseil permanent des écrivains (CPE) et les sénatrices. Il y a eu des échanges considérables et il nous semblait que nous étions arrivés à un accord transposable par voie légale. Or le résultat est très éloigné de ce que nous avions demandé.
Quelles avaient été vos requêtes ?
Nous souhaitions un minimum garanti, non amortissable, non remboursable, ainsi qu'une somme acquise et directement corrélée au travail de création. Mais ces mentions soit ne figurent pas, soit ne sont pas formulées comme telles, ce qui pourrait davantage fragiliser les auteurs. Nous avions également demandé de lisser les taux de droits d'auteur. À ce jour, ces derniers sont divisés lorsque l'œuvre connaît d'autres exploitations que celle du livre papier. Par exemple, pour un poche, il n'est pas rare de voir le taux de droits d'auteur abaissé à 4 %.
Selon vous, quelle serait la meilleure façon d'améliorer les conditions rémunératrices des auteurs ?
Je crois qu'il faut absolument reconsidérer le statut de l'auteur et son activité. Pour l'écrasante majorité des auteurs adhérents à la Ligue - et nous avons des figures aussi installées que Manu Causse, Frédéric Maupomé, Denis Bajram ou Samantha Bailly -, l'exploitation d'un livre ne représente qu'environ 30 % de leur rémunération globale à l'année. Cela signifie qu'ils vivent principalement des interventions publiques, des activités de médiation culturelle, ou encore des dédicaces et des ateliers d'écriture. Il nous faut dépasser l'imaginaire poudré et obsolète de l'auteur en robe de chambre, tout entier dévoué à l'écriture et enfermé dans son rapport à l'éditeur. Je crois qu'il faut davantage s'inspirer de l'image un peu startuper de l'auteur qui crée du contenu sur les réseaux sociaux et fidélise sa communauté. En bref, il nous faut assumer et faire valoir une identité professionnelle.