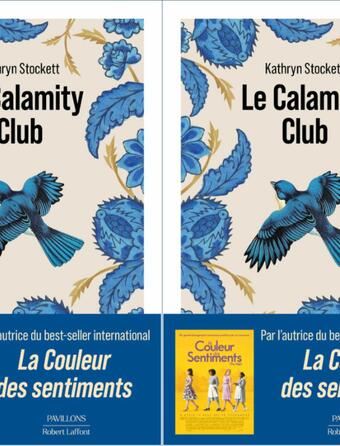Les hommes signe le retour chez Joëlle Losfeld du Richard Morgiève d’Un petit homme de dos, ce texte magnifique avec lequel l’écrivain hors case était entré en littérature, paru il y a trente ans chez Ramsay et que l’éditrice avait repris en 1995 avant de publier Mon petit garçon, Bébé-Jo, La demoiselle aux crottes de nez ou Mondial cafard. Depuis, le garçon n’a cessé d’écrire, signant chez Calmann-Lévy (Mon beau Jacky), Denoël, Pauvert (les poignants Ma vie folle et Ton corps), récemment chez Carnets Nord United colors of crime, Boy et Love, trilogie qui reparaît en septembre prochain.
Les hommes, ce sont ceux de sa jeunesse, de ses 25 ans. Des hommes comme lui nés dans les années 1950, et leurs pères, vrais ou faux, qui ont traversé la Deuxième Guerre mondiale qui hante tant de ses livres. C’est l’histoire de Mietek Breslauer, un "Polack" parisien, un voyou orphelin, "un petit bandit juif". Et c’est lui qui la raconte. Mietek est un ex-taulard. Il porte cheveux longs et "sapes de loub" - Perfecto et santiags -, trois bagues qui forment un coup-de-poing américain mais permettent de "contourner le port d’armes". Il se parfume au vétiver quand il va retrouver Karine, la prostituée russe qui dit l’aimer et lui donne de l’argent sans qu’il le lui demande. Il boit du Vichy et roule en DS 21. Plus tard il aura une SM.
Mietek fréquente d’autres hommes de la marge : petits braqueurs, filles "d’intérêt public", flics ripoux, ferrailleurs de banlieue, "brocos", mécanos "Seigneurs sans terre mais pas sans loi". Complices de coups et frères de galère. Des femmes aussi, de tous les âges, traversent sa vie de solitaire. Elles le trouvent beau, sont séduites, même si toutes ne veulent pas de lui comme la lesbienne junkie qu’il a rebaptisée Ming. Et il y a surtout Cora, la toute petite fille qui voit en lui un père.
En 1974, Paris est encore Paname. Un décor de film noir à la Melville ou à la José Giovanni, comme Classes tous risques. Les prolos tels que Mietek vivent encore dans son centre et sa périphérie proche. On y trouve des squats de camés dans le 20e, des bars à flippers tenus par des Algériens, des hôtels de passe rue Saint-Denis. On y fume tout le temps et partout. On y téléphone dans les sous-sol des cafés, près des WC.
Entre Calaferte, Genet et Albert Simonin, Richard Morgiève écrit de l’intérieur, sous le capot, les mains dans le cambouis. Il retrouve la justesse de la voix, le vocabulaire d’époque. La poésie de la rue avec du sang, de la sueur et du sperme, où on compte "le fric" en "plaques", on dit "chourer", "zonzon", "bibine". Sa langue originelle. "Mes mots poussaient sur les terrains vagues, dans les poubelles, au bord des comptoirs", dit le voyou qui, à la fin du roman, en 1981, se met à écrire. Richard Morgiève aime les hommes ambigus, pas forcément aimables. Comme son voleur de voitures, dur dehors, doux dedans. Redresseur de tort et sale type. Justicier et justiciable. A ce monde viril disparu et à ses codes, à ces morts oubliés, il dédie cette folle "histoire des bagnoles et des hommes", comme une épitaphe sur des tombes inconnues, une reconnaissance de dettes, une promesse honorée. Véronique Rossignol