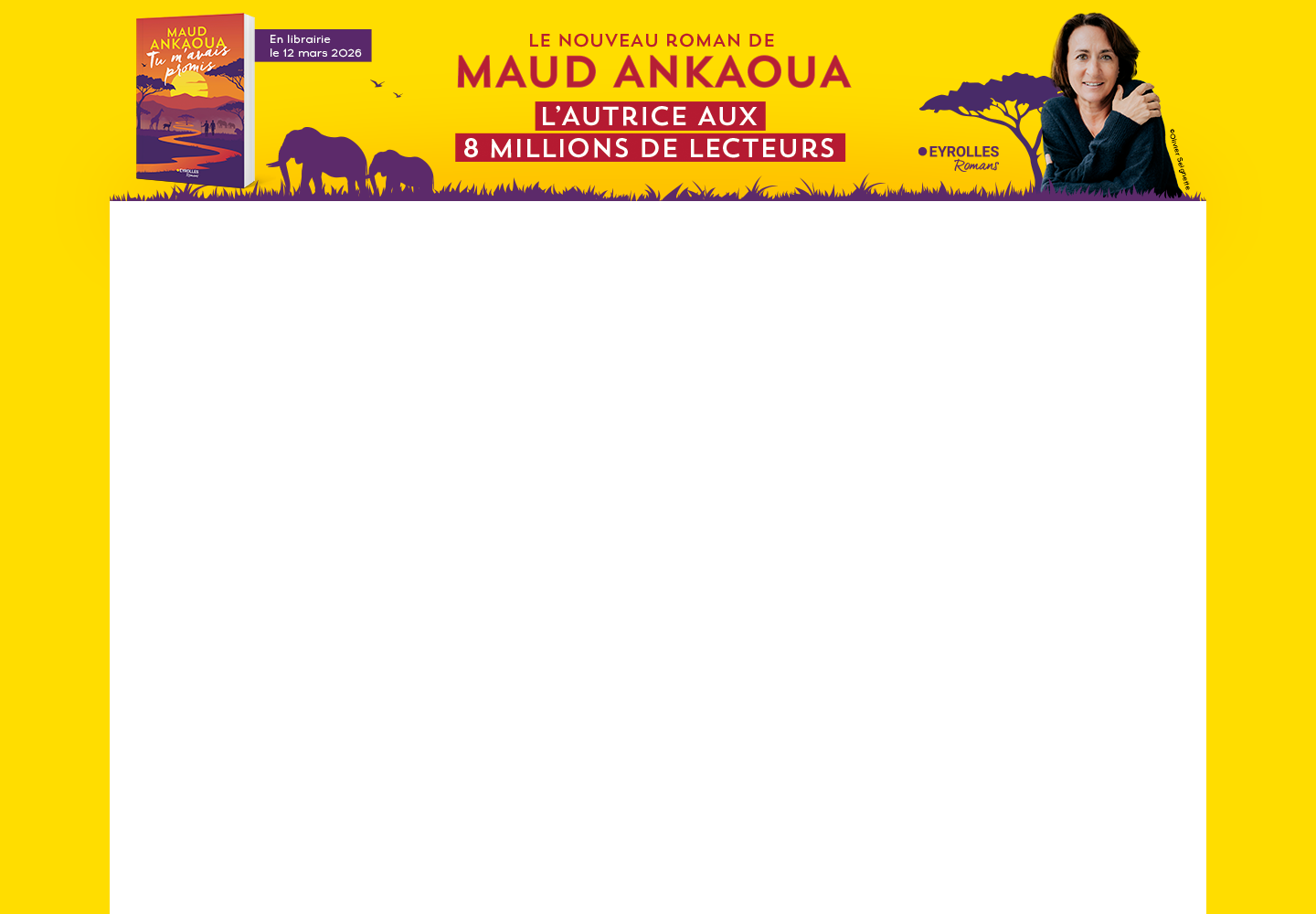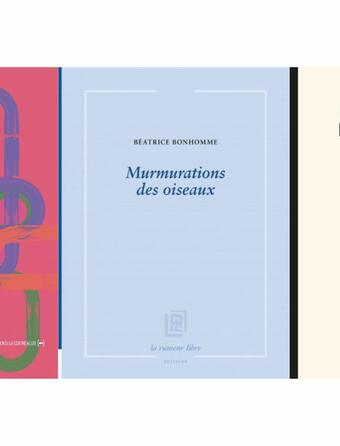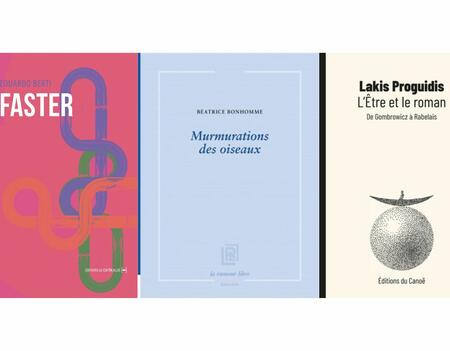On appelle cela les "disaster studies". Ce courant en vogue aux Etats-Unis, mais aussi en France avec un Jean-Pierre Dupuis par exemple, étudie la manière dont la perspective de catastrophes diverses peut nous éclairer sur la manière de changer notre comportement. En somme, se donner les moyens de penser la fin.
Michaël Foessel- Photo EMMANUELLE MARCHADOUR/Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Michaël Foessel ne fait pas autre chose dans cet essai dense, brillant, rythmé par des "intermèdes" astucieux. Ce spécialiste de Kant, maître de conférences à l'université de Bourgogne et membre de l'Institut universitaire de France, pose les termes du débat philosophique en reprenant cette généalogie de l'idée de fin du monde, où entrent nos conceptions de l'histoire et du temps.
Qu'est-ce que l'apocalypse peut avoir à nous dire ? Et si la fin du monde avait déjà eu lieu ? Et si nous étions contraints de penser l'après ? Autant de questions auxquelles Michaël Foessel s'attaque en critiquant les visions par trop pessimistes d'un Günther Anders (1902-1992) avec son "obsolescence de l'homme". Mais c'était juste après Hiroshima...
Dans les années 1970, on avait assisté à un emballement autour de la "théorie des catastrophes" de René Thom. Cependant, il ne s'agissait pas de société, mais de mathématiques. Cette fois, derrière le mot «catastrophe", Michaël Foessel déploie toute la richesse d'une réflexion pour que nous puissions tirer la leçon des ruines et que nous évitions la confusion entre le monde et la vie. Son grand cours de chaos ne vise rien d'autre que de démonter la logique du pire. En rappelant que le monde à venir est aussi un enjeu politique capital. Une façon de redonner une présence au futur.