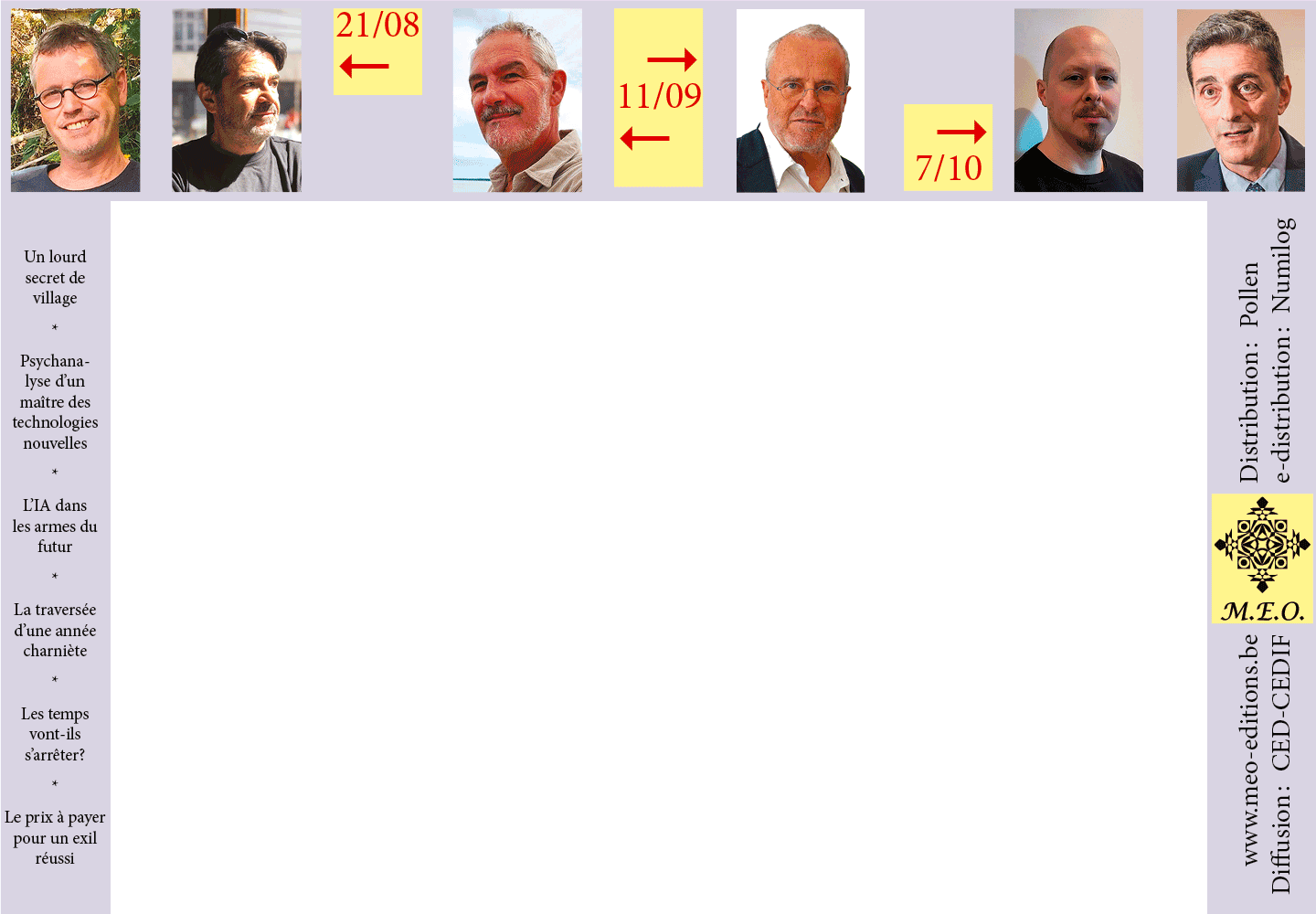Fils de poète, ce n’est déjà pas une sinécure. Mais fils de poétesse… Alors quand il s’agit de Marina Tsvetaeva, on touche au cœur de la douleur et de la grâce. Gueorgui Efron (1925-1944) est né dans la banlieue de Prague, mais il a grandi dans celle de Paris jusqu’à 14 ans. Celui qui était surnommé "Murr", en hommage au chat d’E.T.A. Hoffmann, regagne l’URSS en 1939 avec sa mère. Mais les autorités soviétiques ont déjà arrêté son père, Sergueï Efron, agent du NKVD, qui sera exécuté le 16 août 1941, et Ariadna, sa sœur, déportée pour huit ans. C’est en cette année 1939, tandis que se prépare la Seconde Guerre mondiale, que Murr commence à tenir son journal, en russe, et en français pour un quart du texte.
Ces deux langues illustrent bien le fragile équilibre d’un adolescent lui-même fragile qui se cherche entre deux mondes et entre deux façons de le penser. Dans sa langue maternelle, il est littéraire, scrupuleux. Dans sa langue d’adoption, il se lâche, il utilise volontiers des expressions familières - "C’est le soir et je n’ai rien à foutre" - et charge les "couillons" de la NRF ou sa mère qui l’"emmerde". C’est pourtant elle, l’une des plus éblouissantes poétesses du xxe siècle, qui l’a initié au plaisir des mots et de l’écriture.
Le rapport avec Marina Tsvetaeva, qui se pend le 31 août 1941, domine ce témoignage bouleversant, celui d’une existence au bord du gouffre. Murr lui reproche de n’avoir aucun sens pratique contre la misère et de persévérer à survivre de traductions sous-payées. Elle pointe son esprit moqueur et sa froideur.
Puis survient le désastre. Le fils se retrouve seul, orphelin, errant de Moscou à Tachkent, vide de lui-même comme il le dit souvent, sans argent, tourmenté par la faim, malmené par la guerre et par les bombardements, broyé par la terreur stalinienne, attendant sa mobilisation pour en finir. A 19 ans, il est tué au combat, le 7 juillet 1944, sur le front biélorusse.
Comment écrire le malheur et y résister à ce point ? Ce document déchirant donne sa réponse : par la culture. Le jeune homme qui veut devenir dessinateur est un boulimique de lecture. Il dévore tout, de toutes époques, de tous pays, et surtout la littérature française, des classiques jusqu’à Simenon en passant par Colette, Gide, Valéry ou Kessel. Il vend des livres pour des quignons de pain, pour se rendre au concert, au théâtre ou au cinéma.
Certes, c’est un peu long, mais c’est très russe, sans romantisme, sans afféterie, juste avec ce qu’il faut d’excès et de désespoir. On entre presque par inadvertance dans l’intimité de cet adolescent qui s’ennuie, flâne et voudrait perdre son pucelage. On s’installe avec lui dans une époque tragique, on observe la condition des écrivains et on est épouvanté de ce qui advient. L. L.