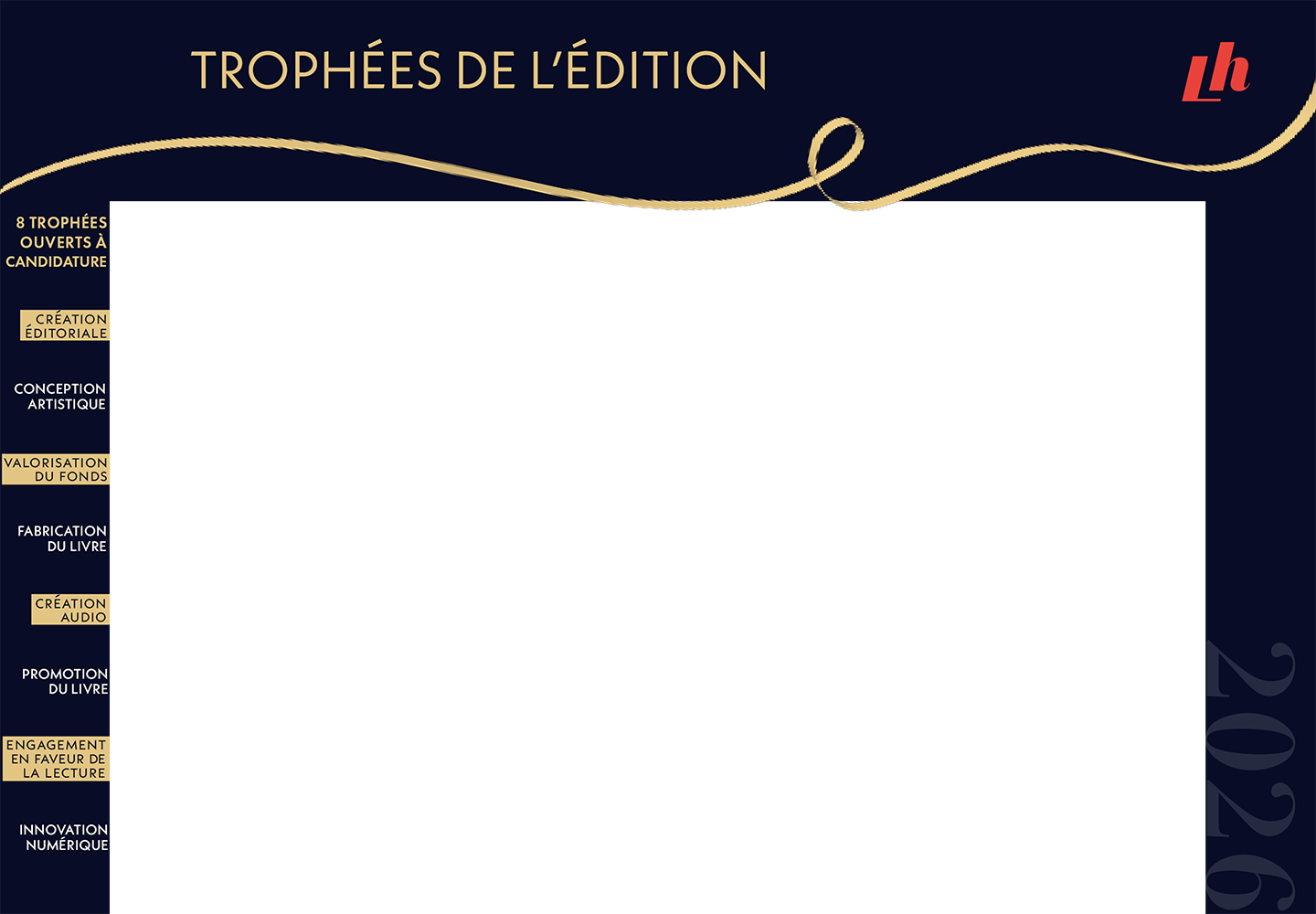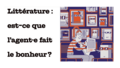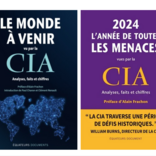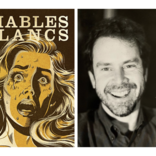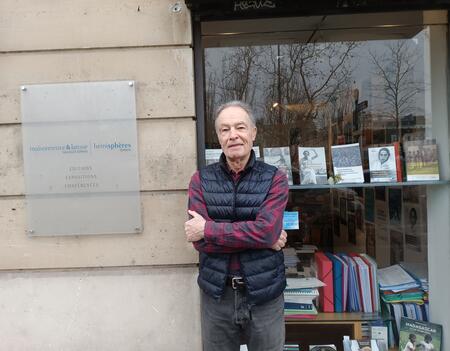On doit à Georges Borchardt l’introduction aux États-Unis d’auteurs majeurs comme Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Elie Wiesel, Monique Wittig, Marguerite Duras ou encore Samuel Beckett. Homme discret mais central, l’agent littéraire, aujourd’hui âgé de 97 ans, incarne un lien vivant entre la littérature française et le monde anglophone, entre mémoire et transmission.
Pour Livres Hebdo, il revient en compagnie de son épouse Anne sur sa vie façonnée par l’exil, la littérature et les rencontres. Né à Berlin en 1928, réfugié en France pendant la guerre, il a survécu à la perte de sa famille dans les camps en se cachant, adolescent, dans le sud du pays. Arrivé seul à New York en 1947, il y a construit peu à peu un destin hors du commun, fondant en 1967 avec sa femme Anne sa propre agence littéraire, guidé par la fidélité aux textes et aux amitiés durables.
Livres Hebdo : Avez-vous grandi dans un environnement littéraire ?
Georges Borchardt : J’ai toujours aimé lire. J’étais passionné par la collection Contes et Légendes chez Nathan, dont je voulais tous les volumes. À Noël ou à mon anniversaire, je recevais des livres ou un peu d’argent pour les faire relier.
Au lycée Janson, pendant la guerre, mon professeur de français me faisait apprendre des textes par cœur : j’étais bon élève et il vantait ma prononciation. Il m’a aussi fait jouer au théâtre ; à 13 ans, j’avais les rôles féminins principaux. J’ai même songé à devenir acteur, avant d’y renoncer. Après la Libération, je suis allé lui rendre visite.
Vous qui avez perdu plusieurs membres de votre famille dans les camps de concentration, quand vous partez aux États-Unis en 1947, est-ce avec l’idée de défendre un passé, de préserver une mémoire ?
G.B. : Non, au contraire. Je suis parti avec mes deux sœurs aînées. J’avais 14 ans quand mon père a été déporté, et cela nous a rendus très proches. À la libération d’Aix-en-Provence, elles ont travaillé pour l’hôpital militaire américain. Elles y ont rencontré des Américains et m’ont entraîné avec elles. Elles voulaient découvrir ce paradis. Nous voulions recommencer notre vie, repartir à zéro.
« J’avais seulement de petits auteurs à l’époque, comme un certain auteur irlandais inconnu, Beckett, qui voulait écrire en français. Personne n’en voulait »
Pourtant, vous avez défendu Nuit d’Elie Wiesel, qui évoquait les camps de concentration.
G.B. : C’est vrai. Personne ne voulait publier Nuit : on ne parlait pas des camps à l’époque. Après bien des refus, un ami éditeur l’a accepté pour 250 dollars. Aujourd’hui, c’est notre plus grand succès, vendu à près de 500 000 exemplaires par an et étudié dans tous les établissements scolaires. Elie Wiesel, alors inconnu, est devenu une figure majeure – il a même aujourd’hui un timbre à son effigie. Avant nos mariages respectifs, nous aimions nous appeler et dîner parfois ensemble dans un petit restaurant italien.
Vous savez, ces sujets restaient tabous. Cela me rappelle la relation entre De Gaulle et son éditeur chez Plon, par ailleurs ancien collaborateur. De Gaulle m’a toujours dit : « Je sais bien qu’il a collaboré... mais ce n’est plus le cas aujourd’hui ! » On préférait ignorer. Même avec Robbe-Grillet, qui en avait été plus ou moins un, nous n’en parlions jamais. On discutait plutôt de la cuisson des sardines : il me reprochait de toujours les laisser trop longtemps sur le gril [Rires].
Comment en êtes-vous venu à ouvrir votre propre agence ?
G.B. : J’avais déjà de bonnes connexions. De retour à New York, j’ai reçu une lettre de Paul Flamand, directeur du Seuil : « Si vous fondez votre agence, je vous laisserai représenter le Seuil aux États-Unis. » À 24 ans ! Je n’avais pas confiance en moi. J’ai d’abord repris un poste dans une agence où j’avais travaillé. Puis je me suis dit : pourquoi pas ? Je savais que ça ne me rapporterait pas beaucoup d’argent et je voulais devenir plus compétent. Comme j’avais servi dans l’armée américaine, je pouvais faire des études gratuitement, alors je me suis inscrit à NYU. Dans l’ascenseur, j’ai rencontré la cheffe du département de français. Le lendemain, elle me proposait trois cours de grammaire. Parmi mes étudiantes, il y avait Anne, qui posait toujours des questions pointues sur les adjectifs et les noms…
L’agence a dû être précaire au début ?
G.B. : Oh oui ! J’ai vite arrêté les cours, il fallait choisir. L’agence n’était pas prospère. J’avais seulement de petits auteurs à l’époque, comme un certain auteur irlandais inconnu, Beckett, qui voulait écrire en français. Personne n’en voulait. J’ai quand même obtenu 1000 dollars pour trois livres, dont une pièce : En attendant Godot. Comme les romans se vendent toujours mieux que les pièces, j’ai obtenu 400 dollars pour chaque roman, et seulement 200 pour la pièce. Aujourd’hui, entre les ventes et les représentations – une toute nouvelle adaptation se joue d’ailleurs sur Broadway en ce moment – on encaisse encore des sommes considérables, sans parler des e-books et des audiobooks qui sont venus s’ajouter.
Vous avez un souvenir marquant de ces débuts difficiles ?
G.B. : Je n’avais pas de quoi payer mon loyer. J’ai d’ailleurs organisé la vente aux enchères des mémoires de De Gaulle… dans mon salon qui me servait aussi de chambre ! Je recevais ainsi les éditeurs dans la salle de bain, c’était étrangement la seule pièce présentable. Puis Anne a commencé à travailler avec moi. J’ai alors osé représenter aussi des auteurs anglophones. Beaucoup de choses dans ma vie se sont faites par hasard.
Anne Borchardt : Toute ta vie est un miracle. Comment un homme qui est arrivé aux Etats-Unis sans parler un mot d’anglais à 19 ans a-t-il pu s’en sortir ainsi !
G.B. : Oui, mais tu m’as beaucoup aidé. J’étais le dernier candidat pour devenir agent ! Et pourtant, j’ai fondé une agence, j’ai servi dans le bureau de International PEN, je suis devenu président de l’association des Authors’ Representatives (ARR) où j’ai pu établir un code moral qui oblige les agents à avoir des comptes séparés.
Cela n’était pas le cas auparavant ?
G.B. : Non, car en principe, chacun faisait ce qu’il voulait aux USA. Mais il y a des gens malhonnêtes à tous les niveaux. Il fallait y remédier. Le métier d’agent fascine depuis toujours. Beaucoup s’imaginent que pour être agent, il faut mettre les pieds sur son bureau, un cigare à la bouche, et dire, je veux un million !
« Mes rapports avec Gallimard ont toujours été particuliers »
Quelle était l’image des agents littéraires à vos débuts ?
G.B. : Très mauvaise. Quand j’ai négocié avec l’éditeur américain Viking pour un de mes premiers auteurs, il y avait en grandes lettres dans le bureau du directeur : « The agent is to the publisher what the knife is to the throat. » Ça donnait le ton ! Les éditeurs préféraient à l’époque les rapports directs avec les auteurs. Puis, peu à peu, ils ont refusé de recevoir les manuscrits sans agent. En France, cela a pris encore plus de temps.
En France, les agents peinent encore à émerger !
G.B. : En effet. Je me souviens de Jenny Bradley, la première à exercer ce métier en France, qui avait vendu les droits de Saint-Exupéry et Gide aux États-Unis. J’ai travaillé pour elle à la Bradley Agency à mon arrivée à New York, mais elle ne m’a jamais pardonné d’avoir ensuite créé ma propre agence concurrente. En 1961, mon amie Michèle, rencontrée à NYU, est parti à Paris pour son doctorat ; je lui ai proposé de poursuivre notre travail là-bas. En 1968, elle est devenue indépendante et peu à peu, Michèle s’est imposée comme l’une des principales agentes littéraires de Paris. Aujourd’hui, l’agence Michèle Lapautre est dirigée par sa fille Catherine, avec une équipe qui fonctionne très bien.
A.B. : D’ailleurs, Catherine jouait avec notre fille à la campagne quand elles étaient petites ! Catherine disait toujours « Miam, miam les myrtilles ! » C’est drôle de la voir maintenant à la tête d’une des plus grandes agences parisiennes. On s’était toujours vraiment attachés aux personnes, au-delà du professionnel.
En parlant de la France, quelles étaient vos relations avec les éditeurs français ?
G.B. : Mes rapports avec Gallimard ont toujours été particuliers. Après mon service en Islande avec l’armée américaine, j’ai rencontré Dionys Mascolo, alors directeur des droits, compagnon de Duras et militant communiste : il m’a mal accueilli en uniforme américain, me demandant comment je pouvais vivre « dans le royaume du capitalisme » ! Plus tard, j’ai gardé de bons souvenirs avec l’éditrice Monique Lange, qui m’invitait à la piscine et partageait des infos entre deux longueurs. J’aurais voulu être agent de Gallimard, mais ils exigeaient que je quitte le Seuil. Impossible : Paul Flamand était mon ami. C’est grâce à lui que j’ai commencé, et nous avions une relation sincère. Il venait souvent à New York, nous a emmené au Mont-Saint-Michel, et recevait dans sa maison de vacances. Avec le Seuil, les liens dépassaient le professionnel. Tous les vendredis, un petit groupe d’éditeurs déjeunait au bistrot : j’étais l’un des rares non-éditeurs. Chacun cherchait à briller en parlant de livres pas toujours lus – un art très français !
A.B. : J’aimais aussi beaucoup Jérôme Lindon, directeur des Éditions de Minuit – maison que nous représentons encore aujourd'hui – qui appelait Georges « l’agent qui lit ».
G.B. : Les vies individuelles jouaient un rôle central dans ce milieu. Cela rendait les rapports humains passionnants.
« J’ai rencontré Pompidou dans l’appartement de Christian Bourgois »
Et avez-vous d’autres anecdotes marquantes avec des auteurs ou des acteurs du monde éditorial français de ces années-là ?
G.B. : Oh, des centaines ! J’avais des rapports personnels avec beaucoup de monde de l’édition. Le rôle d’agent était plus vaste à l’époque. J’ai rencontré Pompidou dans l’appartement de Christian Bourgois, j’ai reçu des assiettes de la part de René Julliard avec les initiales des gros auteurs de la maison comme Françoise Sagan et Jean d’Ormesson, j’ai prêté à Laurent de Brunhoff mon pyjama quand ce dernier est venu dormir chez nous... Je revois également Michel Butor lire Les Malheurs de Sophie à notre fille Valérie, ici, dans notre appartement. Elle lui disait toujours : que tu es drôle, monsieur Butor ! Nous nous connaissions tous très bien.
Le milieu littéraire français est tout petit…
G.B. : Exact, et nous avons constaté aussi les rivalités ! Je me rappelle, lors d’une journée chaude de juin, où j’avais été invité dans le jardin de Gallimard, j’ai bien ri en voyant Sartre dans un coin et Camus à l’opposé, les deux entourés de jeunes filles !
Regrettez-vous parfois de ne pas avoir fait carrière en France ?
G.B. : Dans un sens, j’aurais aimé faire ce qu’a fait Michèle à Paris. Mais à ce moment-là, j’étais déjà devenu trop américain. Nous voulions que notre fille grandisse ici, et puis, tout se passait à New York : conférences, auteurs, éditeurs… Mais nous sommes tout de même constamment entourés de notre héritage littéraire français, surtout quand je vois l’influence du Deuxième sexe, dont nous avons vendu la deuxième traduction, dans les études de genre par exemple.
Pour conclure, vous sentez-vous reconnu pour tout ce travail au service de la culture française ?
G.B. : Pas vraiment. Nous avons fait publier plus de 2 500 livres français, sans jamais recevoir d’aide du gouvernement français. Au contraire, ils ont financé une agence concurrente, The French Publisher’s Agency, à hauteur de 100 000 dollars. On m’a décoré tel un général – ordre du Mérite, Arts et Lettres, Légion d’honneur – mais jamais de soutien financier.
Cela m’a poussé à travailler davantage avec les auteurs anglophones. Et puis j’ai eu beaucoup de chance de rencontrer Anne. Les Américaines étaient différentes : plus indépendantes, plus audacieuses. J’ai tout de suite su que c’était elle, la vraie trouvaille du siècle. Enfin bref. Et vous, qu’est-ce qui vous amène dans cette galère littéraire ?