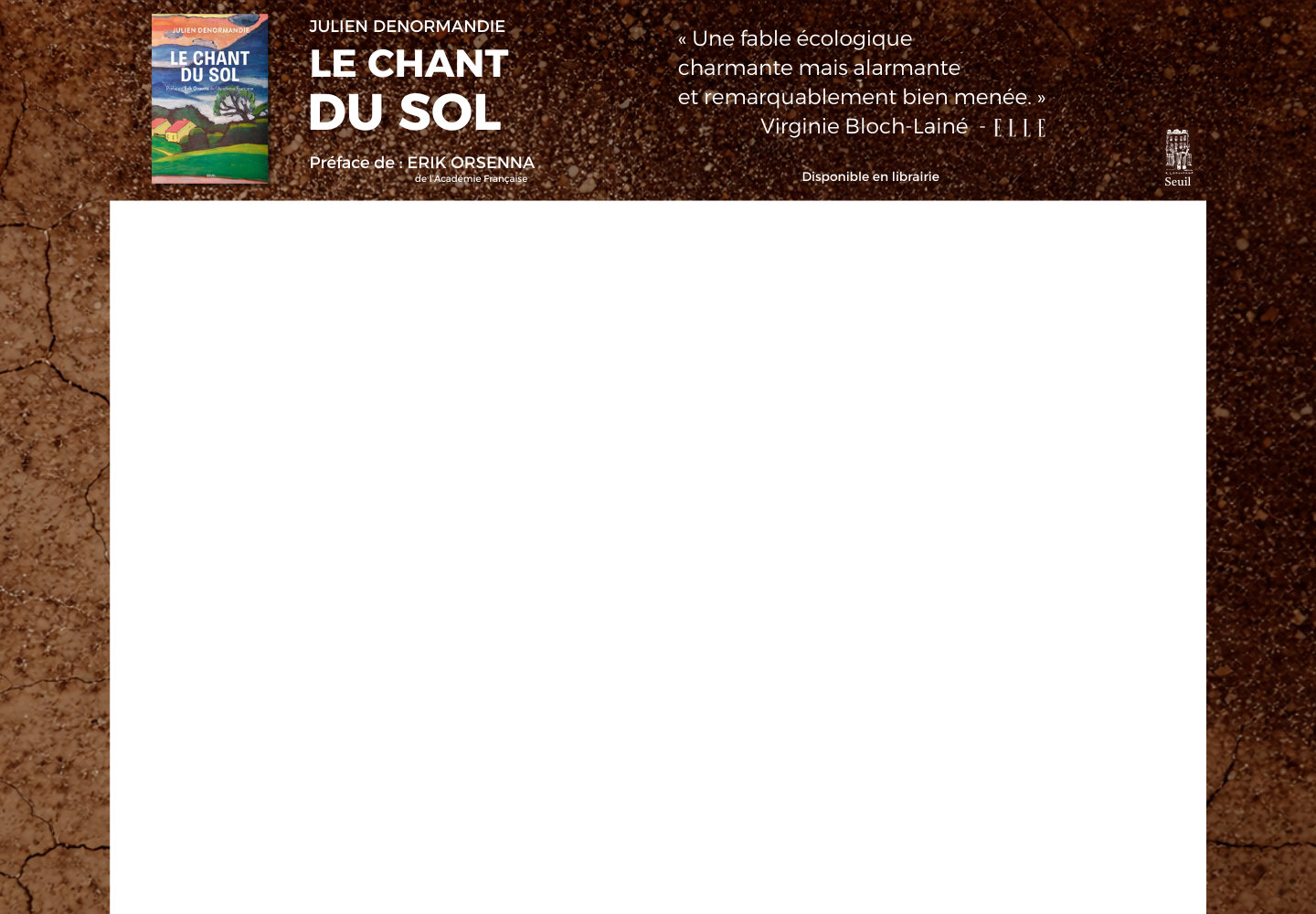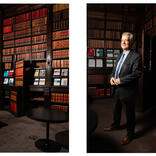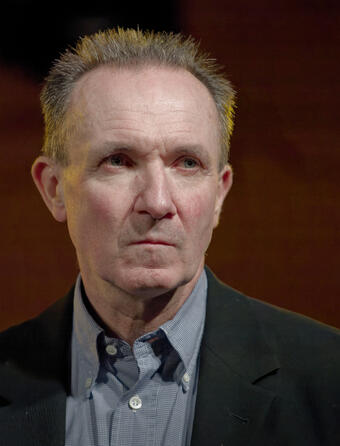Par deux arrêts majeurs prononcés le 10 septembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation a mis un terme à la longue controverse juridique relative à l’articulation entre le droit français des congés payés et le droit de l’Union européenne. [Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-22.732 / Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-14.455]. Ces décisions, rendues en formation plénière de chambre, aboutissent à une mise en conformité du droit national sur deux points essentiels : le sort des congés payés en cas de maladie survenant pendant cette période et la prise en compte des jours de congés dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Droit au report des congés payés en cas de maladie
La question du sort des congés payés lorsque le salarié tombe malade durant cette période était la « dernière pièce manquante du puzzle » législatif français, non réglée par la loi 2024-364 du 22 avril 2024.
Historiquement, la jurisprudence française (notamment un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 1996) considérait que le salarié qui tombait malade au cours de ses congés payés ne pouvait exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'avait pu bénéficier, l'employeur ayant rempli son obligation. Cette approche est devenue contraire au droit de l’Union. La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a souligné la différence fondamentale entre la finalité des congés payés, dédiés au repos, à la détente et aux loisirs, et celle de l’arrêt maladie, visant la guérison et le rétablissement du travailleur. La CJUE s'est opposée aux dispositions nationales qui ne permettaient pas à un travailleur, en incapacité de travail survenue durant ses congés annuels, de bénéficier ultérieurement du congé coïncidant avec la période d'incapacité. En 2022, la cour d’appel de Versailles avait déjà innové en autorisant ce report. La France avait été contrainte de réagir suite à l’engagement d’une procédure d’infraction par la Commission européenne en juin 2025.
Par l’arrêt n° 23-22.732 (Cass. soc. 10-9-2025), la Cour de cassation a aligné l'interprétation de l'article L. 3141-3 du code du travail sur l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE. Désormais, le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie. La Cour de cassation a cependant ajouté une condition pour que ce droit au report soit effectif : le salarié doit notifier l’arrêt maladie à son employeur. Bien que cette décision soit définitive sur le principe, elle soulève encore des questions pratiques, notamment concernant le régime de report applicable et les délais de prescription.
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
La Cour de cassation s'est également prononcée sur le mode de calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, écartant la règle française antérieure qui créait un désavantage financier pour le salarié prenant ses congés.
Jusqu’à l’arrêt du 10 septembre 2025, le droit français, en application de l’article L. 3121-28 du code du travail, exigeait l’exécution d'un « temps de travail effectif » pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Par conséquent, les jours de congés payés (ou de maladie) étaient exclus de ce calcul.
Or, la jurisprudence de la CJUE considère que toute pratique ou omission de l'employeur qui a un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé. C'est le cas lorsque la prise d'un congé payé engendre un désavantage financier, même si celui-ci est différé. Le droit au congé annuel payé et celui à son paiement constituent deux volets d'un droit unique. Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la CJUE avait déjà jugé que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE s'opposait à une disposition conventionnelle excluant les heures correspondant au congé annuel payé pour déterminer si le seuil des heures supplémentaires était atteint.
Dans l’arrêt n° 23-14.455 (Cass. soc. 10-9-2025), concernant un litige opposant des salariés de la société Altran technologies à leur employeur, la Cour de cassation a rappelé qu'en cas de litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur, le juge national a l'obligation de garantir le plein effet de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale contraire. En conséquence, la Cour a décidé d'écarter partiellement l'application de l'article L. 3121-28 du code du travail dans la mesure où il subordonne à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour ce seuil.
Les congés payés sont donc dorénavant pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, ayant posé un jour de congé payé au cours d’une semaine, peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute cette semaine. La cour d'appel de Versailles avait été censurée pour avoir exclu les périodes de congés payés de l'assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires.
Une harmonisation majeure avec le droit de l’Union
Ces deux arrêts du 10 septembre 2025, rendus par la Cour de cassation, consacrent une harmonisation majeure avec le droit de l’Union en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, garantissant l’effectivité du droit au repos annuel payé. Ils marquent l'abandon définitif des anciennes positions françaises qui étaient devenues obsolètes face aux principes européens.
Alexandre Duval-Stalla

Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.