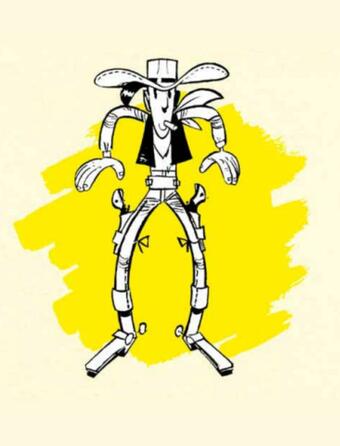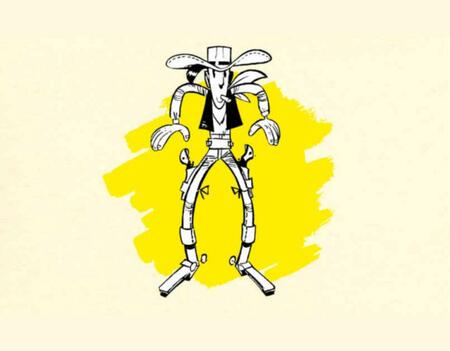Ils ont accepté d’emblée la proposition de Livres Hebdo. Ils sont arrivés à l’heure au rendez-vous. Ils prennent le temps d’un échange détendu, à bâtons rompus, et se prêtent volontiers au jeu des photos. Décontraction et professionnalisme : mardi 19 avril dans les locaux du magazine, Alice d’Andigné, directrice éditoriale de la littérature française chez Stock, Louis Chevaillier, directeur éditorial du domaine français de Phébus, Maud Simonnot, attachée littéraire chez Gallimard, et Benoît Virot, fondateur et directeur du Nouvel Attila, tous entre 35 et 38 ans, incarnent parfaitement la nouvelle génération d’éditeurs littéraires qui contribue à façonner l’offre éditoriale en France. Dans le milieu depuis dix à quinze ans, collaborant à des maisons de taille et de nature très différentes, ils se connaissent et n’hésitent pas à échanger entre confrères sur leur production.
Maud Simonnot (Gallimard) - Il y a un écart assez net entre ce que l’on reçoit et ce que l’on publie. J’ai l’impression de recevoir un peu moins de poésie que lorsque j’ai commencé il y a une quinzaine d’années. Elle a été remplacée par des formes qui découlent un peu des réseaux sociaux. D’ailleurs, je n’en peux plus des manuscrits de gens qui, après un burn-out, sont partis un an en Inde et le racontent dans leur journal après avoir inondé Facebook, Twitter et Instagram ! Quant aux thèmes, il y a toujours eu une production importante sur la Deuxième Guerre mondiale, mais le champ s’élargit à d’autres conflits comme la guerre d’Algérie. Comme si le temps d’en parler était arrivé.
M. S. - Chez Gallimard, 6 000 manuscrits par an. Le plus dur, c’est de ne pas être blasé : tous les jours il faut affronter cette montagne de manuscrits. Souvent, au bout de quelques pages, on s’aperçoit que ce n’est pas vraiment intéressant. Heureusement, une dizaine de fois par an, cela arrive encore d’avoir le cœur qui bat, et cela suffit pour porter le reste de l’année.
Benoît Virot (Le Nouvel Attila) - Au Nouvel Attila nous recevons deux manuscrits par jour.
Louis Chevaillier (Phébus) - En un an et demi, j’en ai reçu autour de 2 000 par la poste, et publié un seul parmi ceux-là. Ce sont souvent les mêmes sujets qui reviennent, sur le quotidien mais traité d’un point de vue un peu psychologisant.
M. S. - L’écriture thérapeutique, c’est encore le nerf de la guerre !
B. V. - Ma stagiaire appelle la plupart de ces manuscrits "grosse névrose". Sinon, toutes les semaines nous avons le nouveau Bukowski, avec des choses très trash, limites SM, par un auteur qui a raté sa vie et qui pense enfin faire de son livre un succès. C’est un peu lassant. Quand la personne a un peu de style, on encourage, on écrit une réponse personnalisée parce qu’il y a peut-être une voix en germe qui mérite d’être poussée. Mais je ne dirais pas qu’il y a une évolution du fond, mais plutôt une évolution des formes en fonction de la notoriété de la maison. Il y a aussi de plus en plus d’hybridation entre une voix prosaïque et une voix poétique, entre le théâtre et la fiction. Mais je crois qu’il y a quand même une crise du sujet. Pour l’instant, nous accompagnons plutôt l’émergence de voix ou de regards.
L. C. - Pour l’essentiel des manuscrits, on arrête la lecture au bout de trois pages, et le sujet n’a même pas la possibilité de se développer. C’est aussi une question de distance avec les personnages. Quand le cadrage n’est pas le bon, ou que la caméra n’est pas placée au bon endroit, ça se ressent tout de suite.
Alice d’Andigné (Stock) - Je ne crois pas tellement à la crise du sujet. En revanche, la distance par rapport aux personnages ou aux voix est en effet fondamentale. L’éditeur doit rester un peu modeste : c’est une chose qu’on peut cerner, pas reconstruire si elle n’y est pas au départ. De mon côté, je reçois aussi à peu près deux manuscrits par jour, recommandés ou pas recommandés, en plus de ceux des auteurs de la maison qu’il faut accompagner et qui ne donnent pas forcément une version aboutie de leur texte dès la première fois. Il paraît que notre métier est en crise, mais je ne me sens pas vraiment proche du chômage technique !
A. d’A. - En littérature, il y a un grand écart entre le temps court et le temps long. Le temps court, c’est la réaction immédiate à des phénomènes de société. Le temps long, c’est le temps dont peut avoir besoin un auteur pour mûrir un sujet, un roman, pour s’en emparer et l’aboutir. Nous aussi avons envie de comprendre ce qui se passe dans la société, et c’est vrai qu’on a vu apparaître il y a quelque temps la forme du mail, du SMS, du tweet, mais pour moi c’est presque anecdotique.
L. C. - Certains romans sont nécessaires, et l’on sent que l’auteur devait les écrire. Ce peut être une façon de dire le monde d’aujourd’hui, mais aussi le monde d’hier. Une phrase m’avait marqué en exergue de Rhum, l’aventure de Jean Galmot de Blaise Cendrars. L’auteur a dédié son livre "aux jeunes gens d’aujourd’hui fatigués de la littérature pour leur prouver qu’un roman peut aussi être un acte". A un moment donné, il y a un geste. A nous, éditeurs, d’essayer de prolonger ce geste.
M. S. - Je n’ai pas l’impression que l’on subisse les phénomènes de société ou les modes. Dans mes derniers coups de cœur, il y avait l’histoire d’une pieuvre amoureuse et la parodie d’un roman picaresque. Les gens qui nous envoient des manuscrits et que nous publions échappent à tout, car ils sont eux. Il y a des courants, mais je pense que certains sont montés en épingle. Pour moi, la littérature aujourd’hui est d’une infinie diversité, et certains individus sont peut-être rattachés artificiellement à des modes.
M. S. - Si on réfléchit, l’exofiction c’est qui ? Foenkinos, Beigbeder, Liberati ? C’est un phénomène réel, mais qui correspond à de gros vendeurs, et à une certaine littérature. Cela constitue une thématique, qui va prendre toute la place dans les médias, mais les 500 livres de la rentrée vont au-delà.
B. V. - Je ne sais pas si c’est aux médias et aux libraires, aux très contemporains, de classer l’histoire littéraire. L’autofiction est indéniablement un genre, mais qu’y a-t-il de commun entre Christine Angot et Annie Ernaux ? La question du style, déjà, les oppose, même si un lecteur peut être attiré par l’une comme par l’autre. On peut très bien laisser à la postérité la responsabilité de créer des liens. J’aimerais souligner qu’il y a une infinie diversité littéraire, mais aussi une grande diversité éditoriale. C’est une période très saine, avec beaucoup de nouvelles maisons.
L. C. - Des livres qui sont extrêmement lisibles, qui malaxent la langue mais avec une volonté de lisibilité parce qu’on est dans la transmission. J’ai la sensation que la littérature est aujourd’hui dans l’expression de la pensée et des émotions. Je recherche une littérature plutôt dans les sensations, qui revient à une incarnation, à une connaissance par les cinq sens. Phébus est lié aussi à ça, à cette notion de littérature vers le dehors, le voyage ou l’aventure.
B. V. - Tu veux dire… avec de la chair ?
L. C. - Avec de la chair, oui, mais le mot "chair" va tout de suite déplacer le curseur vers quelque chose de très…
M. S. - Incarné ! Non mais Louis, tu as le droit !
A. d’A. - Fifty shades of Phébus ?
M. S. - Une collection érotique va donc se dégager chez Phébus !
L. C. - C’est terrible, mais lorsqu’on parle de "corps", on a tendance à aller vers la sexualité, or pour le moment, à moins que l’on m’envoie un grand roman érotique, ce n’est pas au programme. Un livre comme celui de Jean Luc Cattacin, un premier roman que j’ai publié en mars, essaie de faire revivre les sensations de l’enfance et cela passe par la matière, par la façon de décrire par exemple la sensation de la pluie. C’est ce que peut apporter la littérature par rapport aux autres écrits.
A. d’A. - Dans un texte, je cherche plutôt une vision du monde, qui peut être très subjective. Je pense par exemple à Sabri Louatah : pour ses Sauvages, il a réinventé une France autour d’une famille, et c’était une vision du monde moderne, hyper imaginative, provocatrice. C’est pour ça que je trouve qu’on a le plus beau métier du monde : on est passeur de visions.
B. V. - Quoi de mieux qu’un auteur qui porte une vision du monde, pour changer une vision du monde et in fine un jour changer le monde ? Mais je crois que cela se voit plus facilement à l’échelle d’une œuvre qu’à l’échelle d’un roman isolé. Pour ma part, beaucoup plus modestement, je recherche des écarts dans le regard, des décalages, des dérèglements. Quelque chose qui me surprenne, autant au sens mental qu’au sens physique.
A. d’A. - C’était la grande réussite de ton Debout-payé.
B. V. - Oui, parce qu’on est dans un décentrement absolu du regard. Gauz, l’auteur, s’est formé à son regard, à son style sur l’humanité, en prenant en photo son propre pays, la Côte d’Ivoire, pendant deux ans. Je me sens à l’aise pour insuffler un minimum de confiance à l’auteur quand il y a quelque chose qui m’a surpris, m’a fait trébucher. D’ailleurs, j’aurais adoré recevoir l’histoire de la pieuvre amoureuse ! La difficulté n’est plus de repérer de nouvelles voix, mais de trouver des voies d’accès en direction des commerciaux, des libraires et des médias.
M. S. - Je me suis souvent posé la question de savoir ce que je cherchais, et je n’ai toujours pas trouvé. Mais j’ai eu une révélation en lisant une interview de Jeanne Moreau, à qui l’on demandait quel était le point commun entre tous les hommes de sa vie. Elle a répondu "moi". Eh bien voilà ! J’ai des émerveillements, des enthousiasmes pour des choses très différentes. Evidemment, ce qui m’enchanterait ce serait des fictions pures, parce qu’on en manque. Mais j’ai publié en janvier Un marin chilien d’Agnès Mathieu-Daudé qui est vraiment le livre d’une conteuse.
L. C. - Je recherche avant tout des personnages. Un personnage, c’est comme un être qu’on croise, il est fait de précision et de mystère. Ce mélange-là existe dans un texte lorsque l’auteur a vécu avec ses personnages suffisamment longtemps. En avril, on publie un livre de Michel Quint. Il y a chez lui une générosité vis-à-vis du lecteur qui me touche. Il travaille la langue de façon à la fois très simple et, par moments, exubérante. La grande littérature, c’est tout simple. Il y a de la très grande littérature qui vous fait du mal, et de la très grande littérature qui vous fait du bien. Cette littérature vers l’ouverture, qui vous pousse à aller vers les autres, on a le droit de vouloir la défendre.
B. V. - Les romanciers ne doivent pas se priver d’enquêter sur un réel qui, lui, est souvent désincarné et déshumanisé. Le premier roman de Jérôme Baccelli racontait le tour du monde en bateau d’un personnage seul, qui communiquait uniquement avec sa femme, par téléphone. On avait un personnage féminin magnifique, puisque la femme était réduite à une voix. Louis adorait le parti prix de l’auteur mais il le trouvait beaucoup trop désincarné pour pouvoir le partager avec d’autres lecteurs, et moi, j’aime bien ce genre de parti pris. C’est une petite contrainte oulipienne qui consiste à faire exister l’intrigue mais sur un plan plus métaphorique, plus mental.
B. V. - A priori, et je dis bien a priori, la littérature française fait moins rêver que la littérature américaine qui, venant d’un pays continent, est déjà favorisée. Mais ça n’a pas toujours été le cas, et puis ça se retrouve aussi au cinéma. La différence d’inspiration entre la nouvelle vague et le néoréalisme italien me frappe toujours. En Italie, un pays littéralement détruit après la guerre, on a eu un intérêt urbanistique, la moitié des films du néoréalisme italien commençaient dans une cité quel que soit le genre. En France, la préoccupation sociale était beaucoup moins présente. Il me semble que ça se sent encore un peu dans la littérature actuelle, mais c’est forcément provisoire.
M. S. - Vous dites que cela fait moins rêver, mais j’ai travaillé en Norvège, et la littérature française ça faisait rêver les Norvégiens, parce que c’était varié. La multiplicité culturelle française est très riche, et donne des romans extraordinaires.
A. d’A. - Et puis on a Modiano, Le Clézio, Houellebecq aussi, qui est connu dans le monde entier. C’est bien la preuve que l’imaginaire français parle.
A. d’A. - C’est quand même un métier où, sauf si on tombe dans l’alcool, ce qui n’est pas exclu, on se bonifie avec le temps. Il y a des choses qu’on apprend à force de discuter, de lire, et d’échanger. Je pense à Luc Lang, avec qui je suis en échange quasi quotidien en ce moment. Il y avait au milieu de son texte ce que je considérais être un problème. Quand j’ai commencé à le lui dire, il a fini ma phrase. L’éditeur arrive en pointant juste les petits problèmes quand l’essentiel est fait.
L. C. - Pour certains textes, il y a ce travail de dentelle sur le style qui consiste à éliminer les quelques scories, et il y a des textes qui demandent un travail très important de structure en amont. Tout l’enjeu est d’arriver à être le moins subjectif possible, à servir uniquement de miroir. Faire en sorte que l’auteur réalise que ce qu’il a fait n’est pas ce qu’il voulait faire.
B. V. - Moi je suis attentif à la forme et à la structure, parce qu’une forme va forcément amplifier le message ou le fond du livre, mais je suis aussi très attentif aux questions d’oralité, de la voix et du rythme. Parfois cela va tenir à trois virgules, à l’inversion de deux chapitres, et parfois ça va être plus profond. Dans son dernier roman, Carrières de sable, Jérôme Baccelli mélangeait un plan réaliste, un plan d’enquête policière, un plan métaphorique et un plan mystique. J’ai suggéré d’affecter chacun de ces genres à une partie du livre. L’auteur m’a entendu mais il a recréé complètement autre chose, il s’est éloigné de ce qu’il avait fait en premier et de ce que je lui avais suggéré.
M. S. - Quand on commence à détricoter quelque chose, c’est une catastrophe en général. Il faut toujours penser que c’est à l’auteur de faire l’essentiel du travail. Et souvent, il nous émerveille parce qu’il arrive à dépasser nos attentes.
L. C. - Tout à coup, la lumière se fait sur un texte qui ne fonctionnait pas.
M. S. - Chez Gallimard, cela n’influe pas du tout. C’est pour cela que j’ai voulu travailler dans cette maison. En tant que lectrice pour le comité, je juge un texte, je me moque de qui l’a écrit, et jamais il n’y a de donnée commerciale ou d’horizon d’attente qui entrent en jeu.
B. V. - Les seuls moments où pourrait intervenir un souci d’ordre communicationnel, c’est sur le paratexte. Pour le titre, pour un choix de photo, de date de sortie. Pour Debout-payé, Gauz aurait souhaité un sous-titre, "La vie intérieure du vigile", et mes commerciaux l’ont convaincu d’y renoncer, parce qu’on avait un titre mystérieux et incitatif qui fonctionnait. Il est très difficile de savoir en amont quel va être votre public. D’ailleurs, pendant des années je me suis dit qu’il fallait absolument construire une colonne vertébrale fictionnelle, et si possible s’écarter des langues trop absconses. Je me rends compte aujourd’hui que peu importe la difficulté de lecture, ce qui compte c’est une passion qui va émerger chez un libraire.
A. d’A. - C’est vrai, le lecteur aime une littérature exigeante. L’an dernier, Eva de Simon Liberati a quand même connu un très beau succès, alors que c’était un livre très écrit, porté par un style assez sophistiqué. Quand nous sommes allés le présenter aux libraires en juin, j’avais très envie de parler de ce livre, mais surtout envie de le donner à lire, pour montrer la beauté de la langue.
M. S. - Les libraires sont toujours présents et à l’écoute. Par contre, je constate qu’il y a un problème d’écho médiatique. On a l’impression qu’à la rentrée il y a dix titres qui marchent, qu’on les retrouve partout et que pour les autres c’est peau de chagrin. Pour un deuxième roman, si l’auteure n’a pas été trapéziste, qu’elle n’a pas vécu avec des tigres du Bengale et qu’il n’y a aucune scène érotique, c’est très difficile d’émerger. C’est un problème en termes de qualité, de quantité et de diversité, mais aussi au niveau des moments dans l’année. Si on ne publie pas en janvier-février, ou entre le 15 août et début octobre, on ne parlera pas de vos livres. C’est un casse-tête pour la programmation.
B. V. - Les libraires sont indépendants, et pourraient résister, parce que la vie sur une table de librairie n’est pas limitée. Malheureusement, l’intérêt du public semble de plus en plus contraint et orienté. Il y a une phrase un peu caustique mais que j’aime beaucoup, qui dit que la dictature censure les livres, et que la démocratie les noie.
M. S. - Le problème, ce n’est pas de trouver des bons livres, c’est d’arriver à les faire parvenir à un public.
L. C. - Et parfois les livres ne peuvent pas être présentés en une phrase ou deux ! La littérature exigeante peut prendre des formes avant-gardistes, mais aussi des formes très simples. Si on pouvait résumer un livre en deux phrases, cela signifierait que ce n’était pas la peine de l’écrire. Pourtant l’exercice est indispensable, devant les libraires et les représentants.
B. V. - C’est le triomphe du pitch, comme au cinéma.
A. d’A. - Je crois qu’on picole moins !
M. S. - Je suis dans une maison où le plus vieux, Roger Grenier, a soixante ans de plus que moi exactement. Et je n’ai pas l’impression qu’il soit si différent de moi.
A. d’A. - A ceci près que Roger Grenier avait écrit ce texte extraordinaire, Instantanés, expliquant qu’autrefois, quand l’éditeur écrivait "Premier mille" sur un livre, cela voulait dire que le tirage réel était à peine de 500. Aujourd’hui, on est quand même très attentifs aux chiffres, aux classements GFK, à ceux d’Amazon. On est aussi assez attentifs aux écarts entre les livres expédiés et les sorties caisses, on regarde si le rythme de vie d’un livre est sain ou pas.
L. C. - C’est vrai qu’on est obligés de réagir si on voit qu’un livre disparaît complètement des radars.
M. S. - Chez Gallimard, nous n’avons pas vraiment le nez sur les chiffres GFK. Les commerciaux sûrement, mais pas les éditeurs. D’ailleurs, c’est un plaisir après avoir travaillé chez Flammarion, où c’était l’excès inverse. Mais il y a des inconvénients des deux côtés.
B. V. - Les outils fournis par les diffuseurs ou par l’observatoire de la librairie indépendante peuvent être extrêmement précis, mais il faut savoir s’en servir avec prudence, et respecter le travail des libraires. D’un autre côté, le libraire ne peut pas uniquement se reposer sur la presse, les commerciaux non plus. Cela me désespère quand pour la troisième fois de l’année les commerciaux me disent : "C’est un coup de cœur de l’équipe, mais sans presse on ne pourra rien faire."
L. C. - Avec Nils Ahl, qui s’occupe du domaine étranger, notre objectif est de réinstaller une ligne claire pour Phébus. D’arriver à faire émerger des auteurs, qu’ils soient plus âgés ou jeunes, mais d’arriver à un tracé qui soit lisible.
B. V. - Rétroactivement, quand j’ai créé Le Nouvel Attila, le défi était de faire exister la littérature française au sein d’un catalogue très identifié à l’étranger par rapport à Attila. Après avoir sorti ma première réédition, j’ai été un "redécouvreur de pépites". Maintenant je suis l’éditeur de Gauz. En fait, quand quelque chose fonctionne trop bien, cela devient le revers de la médaille pour une petite maison. Le défi, ce serait plus d’échapper à son image que d’installer une image.
A. d’A. - Je crois qu’il y a deux enjeux. Le premier, c’est être découvreur, et de faire le tri entre ce qu’on estime ne pas pouvoir porter et ce qu’on estime pouvoir porter. Le deuxième, c’est celui d’être accompagnateur, parce qu’un auteur dans sa vie d’écrivain peut publier des romans différents, de qualité forcément inégale, ou pour un lectorat varié. Et à chaque fois il faut être là pour assumer l’identité du nouveau livre, la défendre.
M. S. - On va avoir des défis personnels, mais aussi par rapport aux changements sociétaux. Je pense aux droits d’auteur : ce qui se passe à Bruxelles est effrayant. Il faut être extrêmement vigilant à ne pas s’enfermer dans une tour d’ivoire. On a aussi ce défi-là, maintenir la littérature dans un monde qui bouge.
B. V. - C’est vrai que la littérature a son rôle à jouer pour rendre compte d’un monde. Malheureusement, mes livres ne touchent pas tout le monde, et une partie des Français ne lisent pas. Mais s’ils peuvent toucher des gens qui changent des choses, et que cela les aide à mieux comprendre le réel, c’est extraordinaire.
Louis Chevaillier, HEC et poète
Louis Chevaillier- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Sorti d’HEC, Louis Chevaillier est d’abord un amoureux de la langue, poète depuis toujours. Entre 17 et 23 ans, ce passionné de poésie a lui-même régulièrement publié des poèmes dans La NRF. Ils ont été rassemblés dans un recueil en 2010 chez Gallimard sous le titre Icare en transe. Depuis mars 2015, il est le directeur éditorial de la littérature française chez Phébus, en tandem avec Nils Ahl, qui pilote le domaine étranger.
Le jeune homme, né en 1981, suit la dizaine d’auteurs publiés chaque année par la maison du groupe Libella, parmi lesquels Stéphane Fière, Michel Quint, Bernard Ollivier, David Boratav ou Gil Jouanard.
Auparavant, ce titulaire d’une maîtrise de lettres a été, entre 2008 et 2014, responsable éditorial de la littérature chez Folio, après avoir travaillé au service marketing de Gallimard.
Maud Simonnot, l’art et la matière
Maud Simonnot- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Armée d’une licence d’histoire de l’art, d’un master d’édition à la Sorbonne (Paris-4) et d’un doctorat de littérature sur l’histoire de l’édition, Maud Simonnot a mis le doigt dans l’engrenage éditorial il y a une quinzaine d’années avec des stages chez P.O.L, Grasset ou à la "NRF essais". Mais elle a véritablement débuté dans le métier en 2005 auprès d’Isabelle Gallimard, en tant qu’assistante d’édition au Mercure de France, avant de partir à Oslo comme attachée à la littérature à l’ambassade de France. A son retour, elle a été deux ans responsable éditoriale chez Flammarion avant d’être embauchée en 2013 chez Gallimard comme attachée littéraire.
A 37 ans, elle fait des lectures pour le comité de Gallimard et est éditrice pour la collection "Blanche". A la rentrée de janvier, elle a accompagné Agnès Mathieu-Daudé, auteure du premier roman Un marin chilien.
Benoît Virot, la ligne sinueuse
Benoît Virot- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Benoît Virot n’aime pas les lignes droites. Après deux ans de classes prépas littéraires, puis des maîtrises de lettres et d’histoire, il intègre le Centre de formation des journalistes. Il travaillera comme secrétaire de rédaction à La Vie du rail, au Nouvel Obs ou à Investir. Né en 1978, il est le fondateur de la revue Le Nouvel Attila (2004) qui deviendra les éditions Attila en 2007, alternant traductions d’auteurs au parcours éditorial sinueux et rééditions. Quand son associé Frédéric Martin et lui-même décident de poursuivre dans des directions différentes, il crée les éditions Le Nouvel Attila en 2014. Il a aussi participé au lancement des revues Jef Klak (2014) et Le Tigre (2007), et il est l’auteur avec Dominique Bordes de Perdus/Trouvés, anthologie de littérature oubliée (Monsieur Toussaint Louverture, 2007). Il intervient par ailleurs à l’ETL (Ecole de traduction littéraire) et anime la collection "Insomnies" chez Tusitala. Au Nouvel Attila, il édite quatre fictions françaises par an comme le premier roman de Gauz, Debout-payé, qui s’est fait remarquer lors de la dernière rentrée.
Alice d’Andigné, littérature comparée
Alice d’Andigné- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Directrice littéraire chargée de la fiction française chez Stock, Alice d’Andigné est arrivée en janvier 2015 après dix ans chez Flammarion, où elle a collaboré étroitement avec sa présidente, Teresa Cremisi.
Titulaire d’un DEA de littérature comparée à la Sorbonne (Paris-4), la jeune femme de 35 ans a débuté en 2004 comme assistante éditoriale en littérature étrangère chez Grasset, travaillant déjà avec Manuel Carcassonne, l’actuel P-DG de Stock. Elle avait fait sa connaissance alors qu’elle était employée, pour financer un master à Londres, à la librairie Le Point, à Paris. En 2005, elle débute chez Flammarion comme assistante éditoriale, avant de devenir responsable éditoriale.
Si elle lit toute la production de romans français de la maison, elle s’occupe plus précisément d’une vingtaine d’auteurs par an dont Christophe Boltanski, Simon Liberati ou Isabelle Autissier. Pour la prochaine rentrée, elle a travaillé avec Luc Lang, Ollivier Pourriol ou Solange Bied-Charreton.