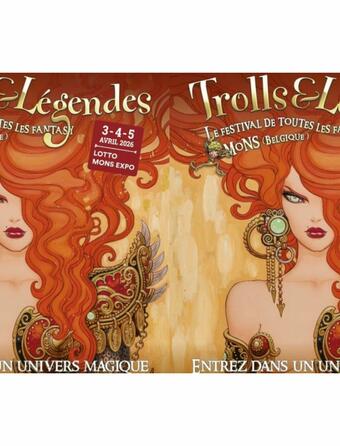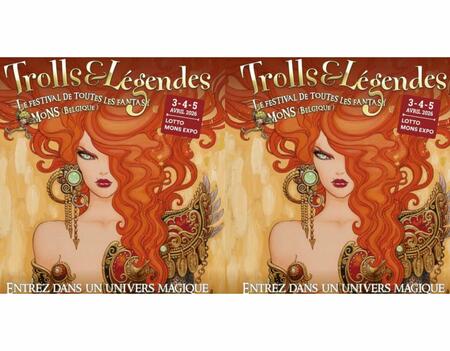Il y a trente ans, elle recevait le prix Renaudot pour La place, qui consacrait cette "écriture plate", parti pris littéraire devenue sa griffe. Dix ans plus tard, en 1993, Journal du dehors élargissait l’horizon. Les années, son grand livre, paru en 2008, est venu coiffer une œuvre romanesque réunie en "Quarto" en 2011 sous le titre programmatique Ecrire la vie. Depuis ce livre, dont l’écriture l’a occupée pendant plus de vingt ans, elle a donné quelques textes à d’autres maisons que Gallimard, qui la suit depuis son tout premier roman, Les armoires vides, publié il y a tout juste quarante ans : chez Nil dans la collection "Les affranchis", L’autre fille, sous la forme d’une lettre à la sœur inconnue décédée avant sa naissance ; aux éditions du Mauconduit, Retour à Yvetot ; et aux éditions des Busclats, L’atelier noir, son journal d’écriture. Mais comme dans le tout dernier, Regarde les lumières mon amour, journal d’une année de visites en hypermarché, écrit pour la collection "Raconter la vie" au Seuil, elle semble n’avoir jamais perdu de vue son projet, jamais dévié de son "chemin d’écriture". "En observant, en écrivant" pourrait être sa devise.
Installée depuis plusieurs décennies en banlieue parisienne, à Cergy, apercevant, par temps clair, la tour Eiffel depuis les fenêtres de son salon, Annie Ernaux aime se tenir en périphérie et ne se voit pas ailleurs que dans cet entre-deux, dedans et dehors à la fois, qui est depuis toujours sa position. Alors, quand on lui demande de commenter l’évolution du monde du livre ces vingt dernières années, son regard embrasse une réalité large, précise dans laquelle elle est toujours très concrètement et intimement incluse.
A quoi correspondent les années 1990 dans votre parcours d’écrivain ?
Ce sont les années de ma "visibilité", avec La place. Mais il y a derrière dix ans de travail, d’interrogation constante sur l’écriture - que je considère comme une période de formation - et un rythme de publication assez espacé, environ trois ou quatre ans. Jamais je n’ai éprouvé de découragement, j’ai toujours poursuivi mon projet. Jusque dans les années 1990, je pouvais percevoir mes devanciers et mes contemporains, parce que j’étais une "entrante" dans le champ littéraire. Aujourd’hui, je connais peu, du moins personnellement, les jeunes auteurs. Je ne sais pas comment ils appréhendent leur place, leur avenir. Je ne vois plus de l’intérieur ce qu’il faut faire, dans les années 2000, pour apparaître comme écrivain.
Justement, quel regard portez-vous de l’extérieur sur les nouveaux entrants ?
Ce qui me frappe, ces derniers temps, c’est une stratégie venue des Etats-Unis - ça s’appelle le "blurb" - qui consiste à mettre sur un bandeau, ou en quatrième de couverture, les éloges d’un écrivain confirmé pour promouvoir le livre. Comme je fais la plupart du temps des retours écrits sur les textes que l’on m’envoie, les éditeurs, de plus en plus souvent, m’appellent pour me demander de reprendre une phrase de mes commentaires. Ce n’est pas du tout la même chose que de rédiger une préface, ce que je fais de façon exceptionnelle. Ce procédé d’adoubement me fait l’effet d’une pratique marketing où l’on vend le roman comme un produit. Sans doute, cela correspond à la difficulté, ou à la croyance en la difficulté que représente, pour les jeunes écrivains, d’attirer l’attention sur leur premier livre. Et derrière, aussi, il y a l’idée que la littérature est menacée, ce qui n’est pas certain.
Vous n’êtes pas convaincue de cette menace ?
Evidemment, comme tout le monde, je constate que les innovations technologiques ont modifié la pratique du livre. L’apparition d’Internet, des smartphones avec le flux continu de musique et de jeux qu’ils fournissent, s’est faite au détriment de la lecture. En tout cas, la lecture sur papier est de moins en moins visible dans les lieux publics. En particulier dans les endroits où l’on a le temps de lire, comme les transports en commun. La désaffection a commencé par le journal, quotidien d’abord puis hebdo. Aujourd’hui, je suis parfois la seule, dans mon compartiment de RER, à lire un livre.
Mais je n’arrive pas bien à mesurer ce recul de la lecture chez les jeunes. J’ai cessé d’enseigner dans le secondaire en 1977 et, à l’époque, je n’étais pas spécialement frappée par le pouvoir de lecture de mes élèves ! Certes, je n’étais pas dans des établissements privilégiés, mais les élèves lecteurs étaient déjà une minorité.
En revanche, ce qui a changé dans les collèges et les lycées, c’est la place des auteurs contemporains dans les programmes et par conséquent le contact des adolescents avec la littérature de leur temps, vivante. Mis à part quelques professeurs qui continuent de considérer que seul compte le jugement de la postérité et ne font étudier que des auteurs morts, les professeurs de français ont ouvert leurs cours ces dernières années aux écrivains contemporains, qu’ils invitent dans leurs classes.
Vous êtes restée fidèle depuis quarante ans à Gallimard. Vos relations avec la maison ont-elles changé depuis vos débuts ?
La maison a beaucoup changé depuis 1974, elle s’est considérablement agrandie, ce ne sont plus les mêmes personnes, mais Roger Grenier est toujours là, et Yvon Girard, Pierre Gestède… Je la ressens vraiment comme ma maison, même si j’y passe rarement en dehors de la sortie d’un livre, qu’on ne me voit pas hanter les couloirs. J’ai une relation amicale, jamais conflictuelle, avec les gens de la maison. Il y a une histoire de Gallimard, à laquelle, volens nolens, en quarante ans, ma propre vie est mêlée. Et ma mémoire, comme celle du jour où j’ai franchi pour la première fois le seuil du, alors, 5, rue Sébastien-Bottin, quand Gaston Gallimard était vivant.
A qui confiez-vous vos manuscrits ?
Au début, je n’ai pas eu d’éditeur référent : personne n’attendait mes textes. A partir de Passion simple, Pascal Quignard s’est étonné de cette situation et, pour Journal du dehors, il a joué un rôle de conseiller. Puis, de 1997 jusqu’à son départ de la maison en 2005, j’ai donné mes livres à Teresa Cremisi. Pour Les années, c’est à Thomas Simonnet, qui avait déjà suivi la mise en forme de L’usage de la photo, que j’ai confié spontanément mon manuscrit. Il me semblait le bon lecteur pour ce texte atypique : jeune, pas auteur lui-même… Je ne m’étais pas trompée, il est un excellent éditeur et j’ai entièrement confiance en son regard.
Les premières fois, quand je remettais mes manuscrits, j’étais partagée entre une peur atroce et un grand orgueil. Je pensais : "si vous n’en voulez pas, tant pis…". Mais je n’ai jamais essuyé un refus. On ne m’a jamais demandé une modification. Et je suis très reconnaissante à Gallimard de la grande liberté qui m’a été laissée. On a compris qu’il fallait me laisser aller à mon rythme, ne rien me demander : je n’aurais pas supporté la pression. Aujourd’hui, je me dis moins qu’on pourrait refuser un manuscrit, mais j’ai toujours aussi peur.
Comment a évolué l’accueil critique ?
En ce qui me concerne, et j’ai pu une nouvelle fois le constater à l’occasion de la parution de Regarde les lumières mon amour, qui a eu un large écho dans les médias, les critiques négatives, violentes même, sont les mêmes qu’il y a vingt-cinq ans. Les ennemis ont changé de nom mais les arguments sont identiques : "ce n’est pas littéraire". De façon générale, il me semble que la vision de la littérature n’a pas beaucoup évolué non plus. Ce qui est littéraire a été décrété et ne se discute pas. Par ailleurs, si les livres écrits par des femmes semblent être plus visibles, il y a aussi toujours en arrière-plan un sexisme du milieu, latent, diffus, qui est littéralement accablant. J’observe les sélections de certains prix, le plateau des invités des émissions comme "La grande librairie", les encyclopédies de littérature… C’est à l’image des palmarès du Festival de Cannes : les écrivains femmes sont toujours minoritaires. Pour simplifier très fortement, on pense aujourd’hui encore que la littérature, c’est un écrivain mâle. Ce n’est jamais dit ouvertement mais ça reste ça. On est très nombreuses à le constater, on en parle entre nous mais, comme pour tous les dominés, il est très compliqué de dénoncer ce sexisme et de s’en défendre.
Comment a évolué votre pratique ?
L’ordinateur a beaucoup modifié ma façon de travailler à partir du milieu des années 1990. Je continue d’écrire à la main puis je saisis le texte, ce qui m’offre surtout la possibilité de modifier la structure. En fait, cela double le travail. Je crois que la plupart des jeunes auteurs écrivent aujourd’hui directement sur l’ordinateur. Moi, j’ai besoin des manuscrits. Il est sûr que la saisie directe change la manière d’écrire, que l’on n’a pas le même rapport à la phrase. On voit bien qu’il y a une écriture blog qui émerge, un style plus uniformisé, plus parlé, très affectif, caractérisé par une constante expression de soi. Je me demande souvent comment les gens peuvent parler ainsi d’eux. Quand je pense que l’on m’a reproché de trop parler de moi… Mais je n’ai jamais écrit pour m’exprimer, ce n’est pas du tout cela qui m’intéresse.
Je trouve incroyable aussi tous ces écrivains qui ont un site où ils assurent leur autopromotion, où ils vont vanter leur camelote aux lecteurs. Tout cela va dans le même sens : vendre, se vendre. Quand je participe à des rencontres, ce que je fais moins aujourd’hui qu’avant, c’est pour expliquer, montrer aussi qu’il y a une part inexplicable.
Vous intéressez-vous à l’actualité littéraire ?
J’ai beaucoup de curiosité vis-à-vis des livres qui paraissent et des jeunes auteurs. Emmanuelle Pagano, Lola Lafon, Emmanuelle Richard, Edouard Louis…
Dans Regarde les lumières mon amour, vous cherchez dans le rayon librairie d’un hypermarché le dernier livre de Jean-Marc Roberts et vous ne le trouvez pas… Où vous procurez-vous vos livres ?
J’avais l’habitude de commander mes livres près de chez moi, dans une petite librairie de Pontoise, puis la libraire a déménagé, le rapport personnel a disparu. Je vais désormais le plus souvent au Grand Cercle que j’ai vu se transformer en espace culturel. Mais je me dois d’être honnête, quand il ne s’agit pas de nouveautés, je commande aussi sur Amazon, seul endroit où je peux trouver des livres anciens, sortis par exemple il y a vingt ou trente ans et qui ne sont plus disponibles ailleurs. L’avantage déterminant est qu’ils arrivent directement dans ma boîte aux lettres. Je constate que j’ai été gagnée moi aussi par une forme d’impatience de lecture, par le besoin de rapidité qui s’est imposé partout. Je suis devenue plus pressée.
Etes-vous une adepte de la liseuse ?
On m’en a offert une mais je n’y lis pratiquement que les gros livres avec lesquels j’ai toujours eu du mal. Sur liseuse, ils m’apparaissent moins gros ! En ce moment, A l’est d’Eden, que je n’avais jamais lu. J’ai commencé aussi L’homme sans qualités qui n’est pas un livre très aimable. J’en suis à la page 300. Peut-être que sur liseuse, je le finirai. C’est pratique évidemment quand on voyage. Mais j’ai lu ainsi La fin de l’homme rouge de Svetlana Alexievitch puis j’ai eu besoin d’avoir le livre, alors je l’ai acheté. Et du coup, je l’ai relu. Souvent, les jeunes auteurs me donnent leur texte en fichier que je lis sur écran. Quand, une fois paru, ils m’envoient le livre imprimé, c’est tellement différent et tellement mieux !
Les années, votre dernier ouvrage paru chez Gallimard, est sorti il y a déjà six ans. Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Depuis ce livre, qui a eu la gestation la plus longue de tous mes textes et dont j’appréhendais la publication car j’avais peur d’un rejet total, j’ai été très dispersée. Actuellement, j’ai deux textes en cours d’écriture dont un, difficile, que je vais peut-être abandonner. Même si je me sais héritière du passé, des classiques, du nouveau roman, je me sens comme responsable de ne pas reproduire ce qui a été fait. La question de savoir à quel genre appartiennent mes livres, que l’on m’a beaucoup posée au début, ne m’intéresse pas. Seule la question de la forme de chaque texte m’importe. Je n’ai plus les premières ébauches des Armoires vides, mon premier texte, mais je me souviens que je n’avais pas de modèle. J’hésitais entre le "je" et le "elle" et, pour trancher, j’ai tiré au sort. Mais, cette fois-ci, les difficultés que je rencontre avec ce texte en cours sont au-delà de la forme, engagent profondément ma vie, peut-être même en tant que je n’ai trouvé comme recours pour vivre que d’écrire.