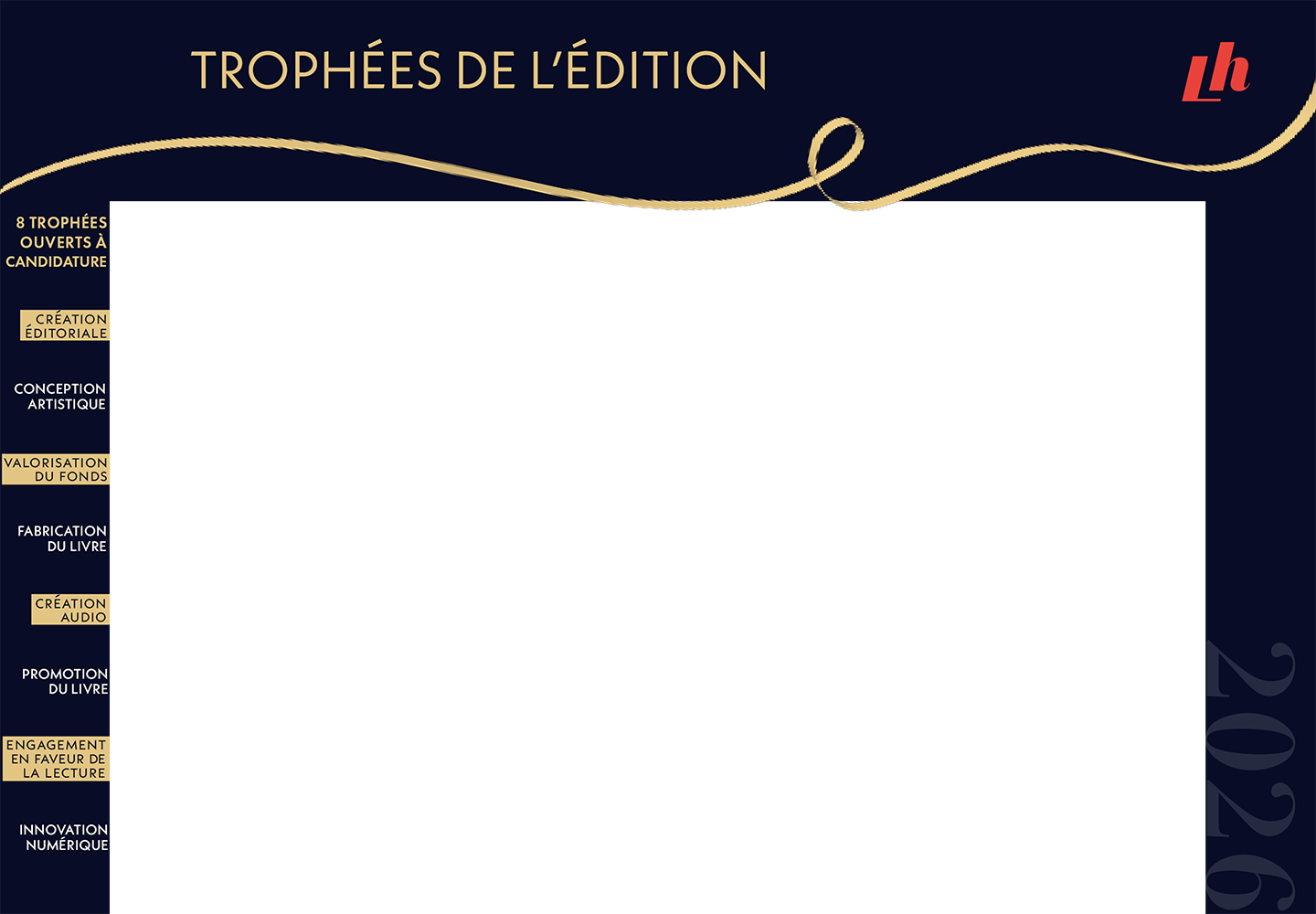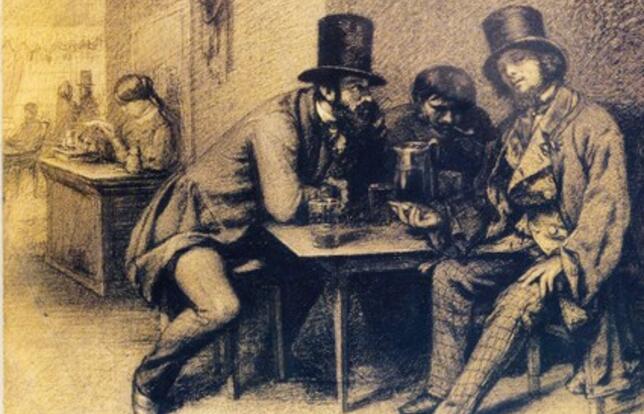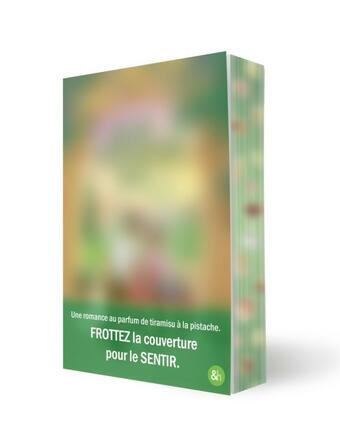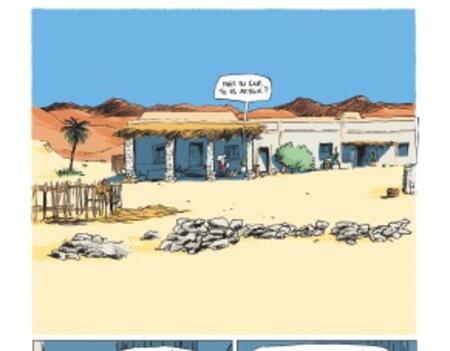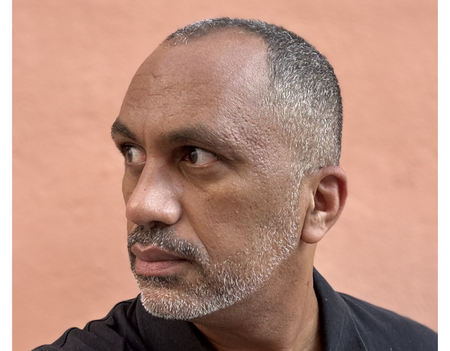Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
En 1845, Henry Murger, fils de concierge parisien, a 23 ans. Il veut faire profession d'écrivain, mais tire le diable par la queue, comme beaucoup de ses camarades autoproclamés artistes qui hantent les cafés du Quartier latin. Murger a l'idée de croquer sa génération dans une série d'historiettes qui paraissent dans une revue littéraire, Le Corsaire. Ces Scènes de la vie de bohème, qui deviendront un livre en 1851 (réédité ce mois-ci en poche Garnier-Flammarion) valent à Murger une notoriété immédiate, en même temps qu'elles "lancent" la bohème. Murger meurt en 1861. Son ami Alfred Delvau, écrivain et collaborateur du Figaro, lui-même bohème patenté, lui rendra un bel hommage posthume dans Henry Murger et la bohème, que Mille et une nuits vient de refaire paraître. Aujourd'hui, le grand public, même lettré, ne connaît plus guère Henry Murger, mais cette bohème qu'il a popularisée (à défaut de l'avoir inventée) est restée. Mieux : imprégnant l'imaginaire collectif, la bohème s'est imposée comme l'un de nos grands mythes modernes, qui n'a cessé d'inspirer artistes de tout poil et de toute envergure.
Comme tous les mythes, celui-ci n'a pas échappé à son idéalisation un peu naïve. Pourtant, la vie de bohème, ce n'était pas toujours cette "vie de pa-ta-pa-ta-chon" que chantaient Bourvil et Georges Guétary dans les années 1950. Mais la bohème fut multiple : il y avait "la bohème des snobs et celle des mansardes, la bohème romantique ou la bohème révolutionnaire", rappelle Luc Ferry, qui signe, au Cercle d'art, un bel album sur L'invention de la vie de bohème. La bohème snob a pour lointaine descendante la "bourgeoisie bohème" d'aujourd'hui - les fameux "bobos". Mais la vraie, l'authentique bohème, qui a beaucoup nourri cet autre mythe de "l'artiste maudit", se nourrissait de "vache enragée" (titre d'un roman d'un autre bohème célèbre : Emile Goudeau) autant qu'elle faisait enrager le (vrai) bourgeois.
Pour tout comprendre de la bohème littéraire, on recommandera l'ouvrage de Jean-Didier Wagneur et Françoise Cestor. Jean-Didier Wagneur était déjà, en 2000, de l'aventure de la réédition de Dix ans de bohème d'Emile Goudeau, chez Champ Vallon, qui devait relancer l'intérêt pour la bohème. "Réédition remarquable, enrichie d'une excellente préface", souligne d'ailleurs Luc Ferry dans son propre ouvrage. En attendant l'essai qu'il destine à Fayard, Jean-Didier Wagneur nous offre cet automne, toujours chez Champ Vallon, un pur "cristal de bohème", si l'on nous permet ce jeu de mots : une monumentale anthologie des principaux textes de la bohème littéraire. La préface est, là encore, excellente, qui montre bien comment, au tournant de la monarchie de Juillet, apparut une nouvelle classe de candidats à la vie littéraire (écrivains mais aussi journalistes), issue des couches moyennes, et qui dut ferrailler pour se faire une place dans une société en proie à la fièvre industrielle et capitaliste. Les "bohémiens littéraires" - ce "doublon sémantique" - étaient nés. La crise pourrait bien leur redonner une seconde jeunesse.