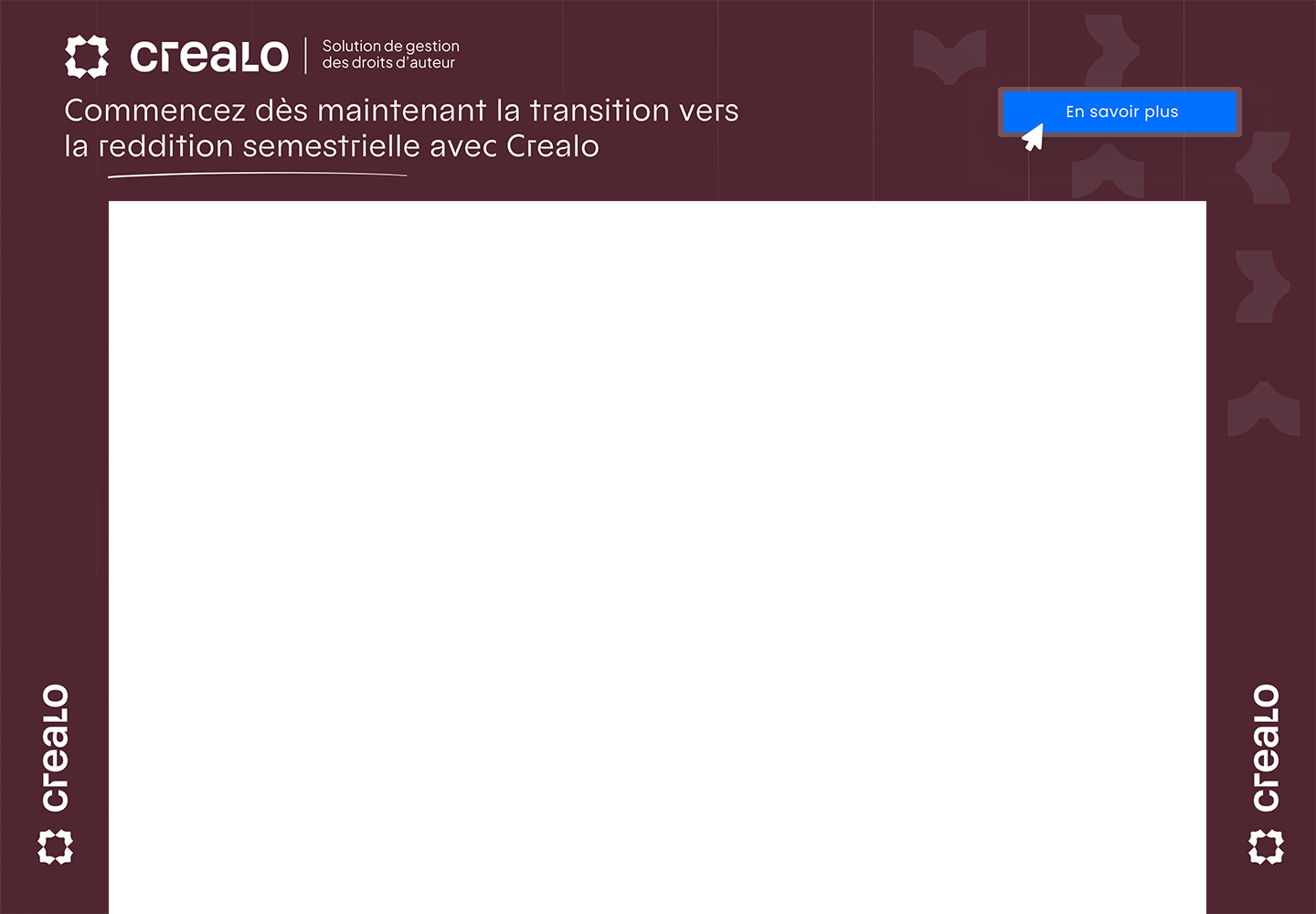Paris, fin des Trente Glorieuses. Amblard Blamont-Chauvry ne se laisse pas encombrer de gloire, ni de son souvenir. Ni de rien d’ailleurs. Il est là seulement, aimable proposition, tel un joli oiseau posé sur sa branche versaillaise, gazouillant pour son seul et souverain plaisir. Ce jeune homme bien né, bien mis, bien élevé, bien bâti, charmant petit monstre d’égoïsme, énarque et polytechnicien seulement parce qu’il ne saurait s’agir de désespérer les beaux quartiers, qui sait qu’un nom tel que le sien ne le prédestine pas aux projets d’avenir (et s’en trouve fort aise), attend qu’on lui dise à quel courant d’air sourire. Sa marraine, la comtesse de Florensac, qui tient salon pour le ban et surtout l’arrière-ban du petit personnel pompidolien, s’en chargera. Dévoué, Amblard épousera donc Isabelle Surgères, demoiselle de fer, ayant substitué pour l’essentiel aux plaisirs de la chair ceux, plus exigeants, de l’ambition personnelle. Ce qui dispense son mari de s’en inventer une et lui permet de revenir plus volontiers vers sa maîtresse, l’adorable Coquelicot, connue un jour de visite de la reine d’Angleterre et gardée pour les joies adultérines d’une accueillante auberge en vallée de Chevreuse. Bref, que ce soit à Paris, Versailles ou Washington (où les exigences du corps, diplomatique celui-là, l’envoient un temps), Amblard Blamont-Chauvry ne sert pas à grand-chose, mais ce rien-là au moins ne manque pas de gueule. Et après tout, dit-il, "né sans passion, je vis sans douleur".
Voire… Les spécimens en voie de disparition, parmi lesquels ce charmant et vain Amblard, qui se pressent pour un ultime tour de scène plein de panache, ne sont pas insensibles aux grandes questions (que faire de sa vie? où est passée ma liberté? comment aimer?) qui agitent le commun des mortels. Simplement, ils se les posent à demi-voix. C’est tout le prix de ces Belles ambitieuses, nouveau roman du toujours piquant Stéphane Hoffmann, que de "documenter" ainsi la fin d’un certain esprit français. Esprit français qui, en ces pages, tient d’ailleurs plus d’Evelyn Waugh ou de Saki que d’un quelconque écrivain hexagonal. Rien ne manque à ce roman en habits de fête éteinte, ni l’humour, ni la mélancolie. O. M.