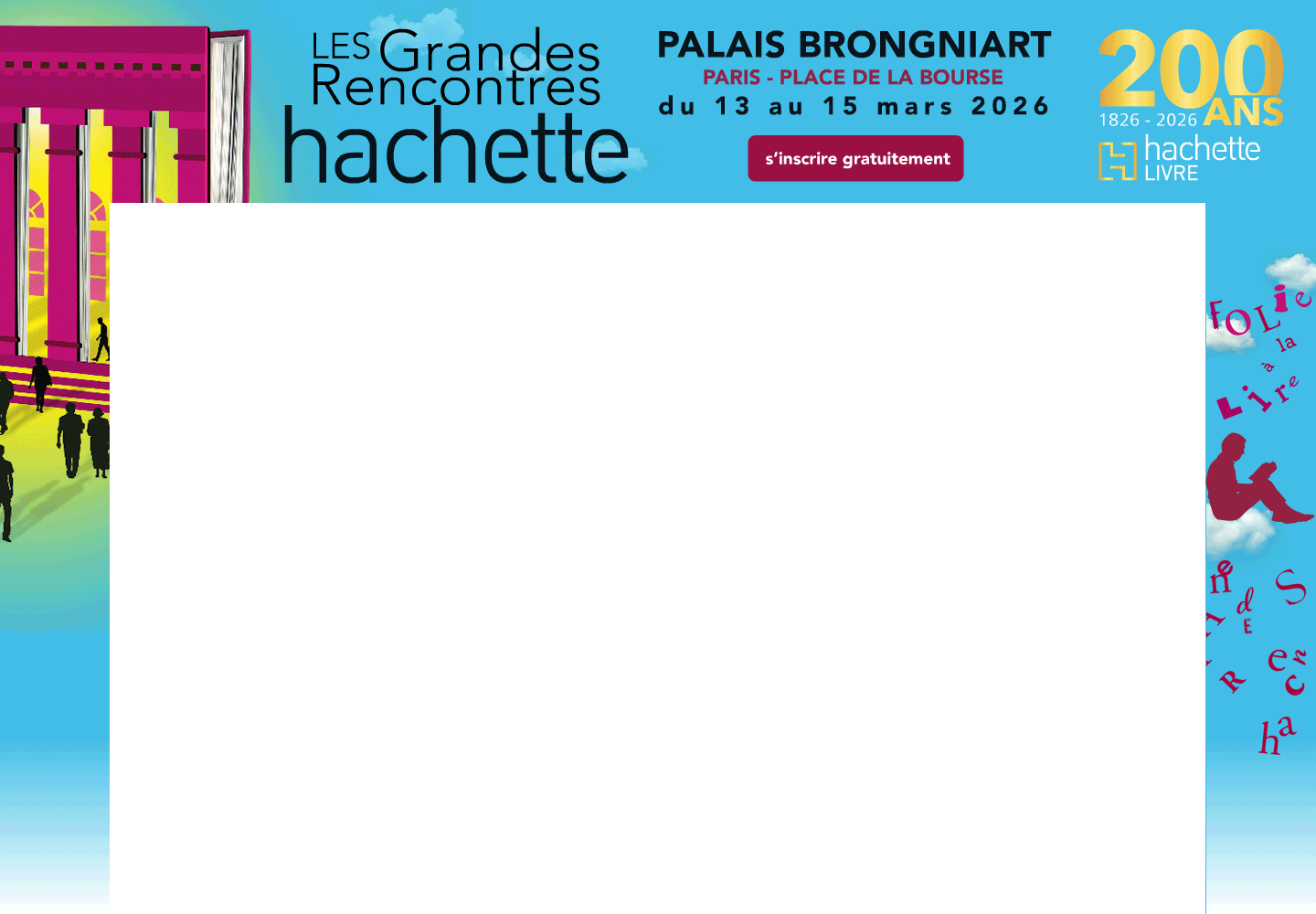Novembre 1975, le Tout-New York est en émoi. En cause, la publication dans les pages du magazine Esquire d’un texte trop longtemps attendu. Depuis la parution de De sang-froid et plus encore de Petit déjeuner chez Tiffany, son auteur, Truman Capote, règne sur les élégances, littéraires et autres, de Manhattan. Il se murmure que son prochain livre, attendu avec ferveur, surpasserait en qualité tout ce qu’il a pu écrire jusque-là et serait une version américaine de la Recherche. Esquire en offre un premier aperçu, un long chapitre en fait, intitulé "La Côte basque 1965". En fait de Proust, c’est un jeu de massacre orchestré par un enfant rageur qui dévaste sa chambre et brise un à un ses jouets. Ses premières lectrices, Babe Paley, Pamela Churchill, Slim Keith, Marella Agnelli, Gloria Guinness, toutes ces femmes riches et belles, ces "socialités" qu’il appelait ses "cygnes", voient exposés dans la lumière crue leurs secrets les plus honteux, intimes et, pire, leurs peurs et leurs chagrins. Elles ne pardonneront jamais à celui à qui elles avaient cru faire l’aumône de leur amitié cette trahison manifeste. Et Capote ne finira jamais d’écrire Prières exaucées ; le rideau est tombé à jamais.
C’est cette histoire, cette histoire au fond plus douce-amère qu’il n’y paraît, que nous narre Melanie Benjamin dans Les cygnes de la Cinquième Avenue. D’elle, on connaît peu de choses si ce n’est un précédent roman, une exofiction déjà, consacrée à la femme de Charles Lindbergh, La femme de l’aviateur (Michel Lafon, 2014). Manifestement, elle s’y entend en matière de "rich and desserte housewives" et de promesses non tenues. Les cygnes de la Cinquième Avenue s’organise autour de l’amitié paradoxale nouée entre Capote donc, et la plus belle autant que fragile de ses protectrices, "Babe" Paley, femme d’un magnat de la télévision. Paradoxale, car tout indique que cette amitié un tantinet amoureuse, même si débarrassée de tout présupposé sexuel, est sincère, fondée sur le fait que ces deux êtres aussi diamétralement opposés sont les seuls à savoir leur secrète ressemblance. Autour d’eux, ce n’est que luxe, beauté, volupté (mais le calme est aux abonnés absents), comme dans la scène centrale du roman, ce "bal en noir et blanc" qui déjà singe quelque chose du deuil. Melanie Benjamin laisse s’exprimer tour à tour Truman et Babe, tandis que Diana Vreeland passe dans le lointain. Tout cela vous a un petit air de Liliane Bettencourt et François-Marie Banier. Un petit air de jamais-plus, de désastre et de mort. Encore fallait-il de ce requiem extraire les notes les plus justes. C’est toute la réussite de ce livre que d’y être parvenu sans pathos ni jugement moral. Olivier Mony