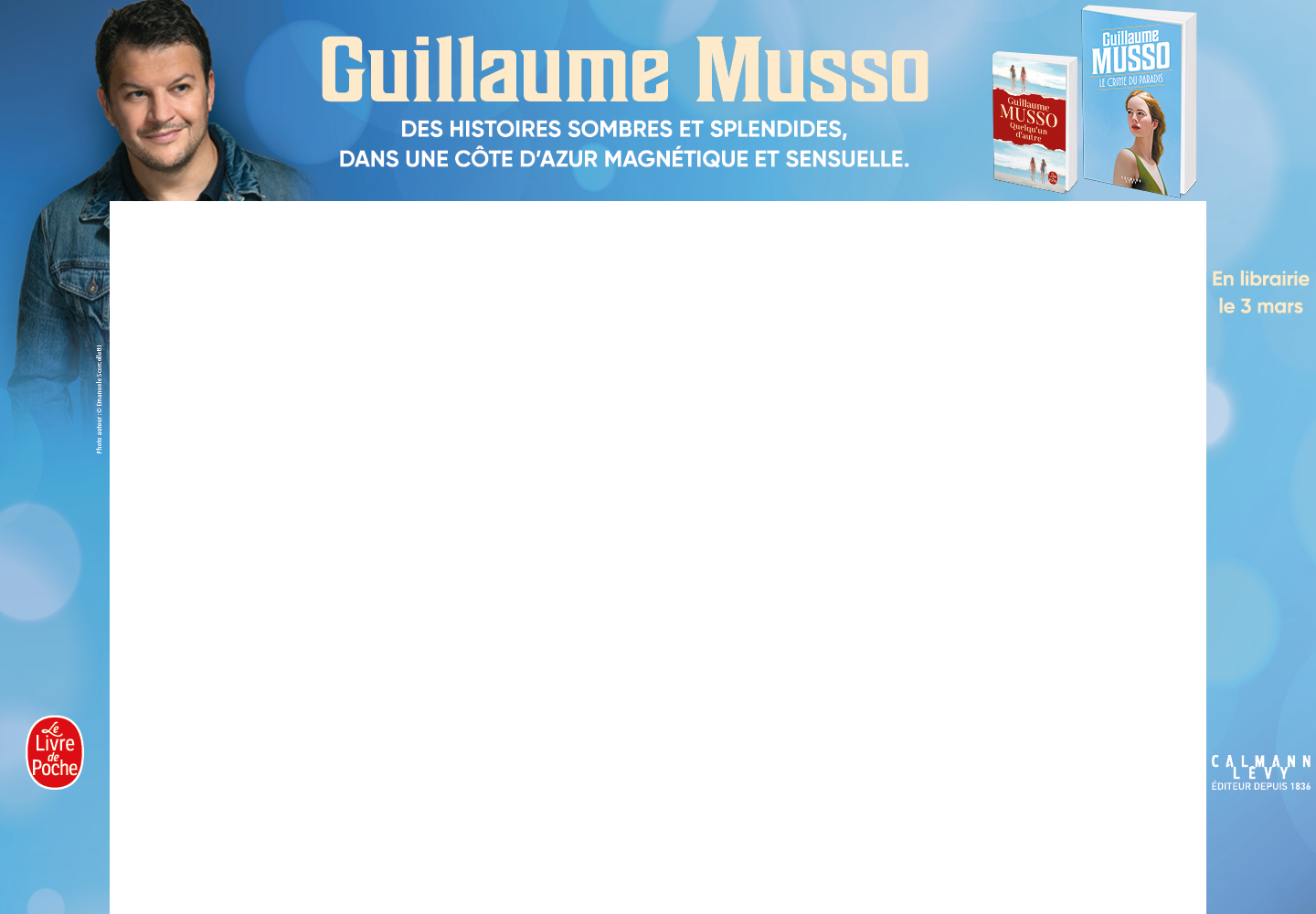Ce texte est une variation autour d'un des personnages de votre dernier roman Les sources (Buchet-Chastel, 2023). Pourquoi avoir choisi de développer cette voix en particulier ?
Vie de Gilles est un aperçu, une fenêtre ouverte sur le chantier en cours de mon prochain roman à paraître chez Buchet-Chastel. Le précédent livre que j'avais publié aux éditions du Chemin de fer relevait du même processus : la nouvelle Gordana était le chantier du roman Nos vies. Pour celui-ci, je suis partie sur la piste d'un des personnages des Sources, Gilles, qui est l'enfant le plus exposé car, comme c'est un garçon, il est promis à prendre la suite de l'exploitation. C'est aussi le premier personnage que je présente dans Les sources.
Vie de Gilles fonctionne comme un diptyque, deux scènes précises qu'une quarantaine d'années sépare... Qu'avez-vous souhaité souligner par cet écart temporel ?
Dans la première nouvelle, Gilles a 8 ans et se confesse pour la première fois. Il est évident qu'on se trouve là dans un état du monde qui n'est pas celui du monde rural aujourd'hui, où un certain nombre de rituels ont quasiment disparu. Cette temporalité montre que la vie passe au-dessus des personnages, aussi bien dans Les sources que dans Vie de Gilles. Et cette temporalité s'inscrit pour le meilleur et pour le pire. Ici, on sent qu'elle s'inscrit davantage pour le pire que pour le meilleur.
Le livre s'achève sur une formule violente que Gilles emploie pour qualifier son existence : « vie de merde »...
Absolument, et il le dit « sans hargne, dans un sourire cabossé ». C'est un personnage très opaque. Il a un rapport difficile aux mots. À 8 ans, il entretenait un rapport singulier au monde, aux choses, aux êtres. Une quarantaine d'années plus tard, ces prémices se sont confirmées. Il n'a pas échappé à la menace qui semblait peser sur lui depuis le début de son existence. Cela se révèle d'autant plus quand on se retrouve dans le flux de conscience de la sœur, qui se heurte à cette opacité malgré les attentions qu'elle lui porte. La vie de son frère lui échappe.
Pourquoi avoir choisi d'imaginer la vie de Gilles en modifiant l'intrigue des Sources, puisqu'ici, les parents ne se séparent pas, comme c'est le cas dans Les sources ? Votre prochain roman va-t-il poursuivre cette voie-là ?
Le chantier des Sources a été violent. À la fin, je n'avais qu'une hâte, c'était de ne plus y penser. D'où le travail sur Cézanne (Cézanne. Des toits rouges sur la mer bleue, Flammarion, 2023) qui m'a occupée pendant plusieurs mois. Je ne pensais donc pas du tout à cette piste, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas ouverte dans mes fichiers mentaux - ils ne sont jamais fermés en écriture comme en création. Si je viens à bout de ce chantier en cours, et non l'inverse, on aura affaire à un roman en tableaux plutôt qu'en chapitres, comme dans Histoire du fils. Entre la nouvelle Gordana et la première partie de Nos vies, il y avait très peu de variantes. Entre ce diptyque et le roman en cours, il y en aura davantage.
Pour mettre des mots sur le silence des personnages, était-ce inévitable d'en passer par un récit introspectif omniscient ?
Je traduis un certain rapport au monde. Gilles accepte les normes du monde dans lequel il vit. Il sait, par exemple, qu'il ne faut pas poser de questions à Denis (un camarade autoritaire du catéchisme), parce qu'il va s'énerver. Mais, à côté de ça, il sent qu'il a un point commun avec Denis : une manière d'être là sans être là, de s'échapper intérieurement. Et il aime le faire. Extérieurement, il est conforme au milieu dans lequel il vit. Et il y a aussi en lui une part de retrait, de refus, d'aspiration à autre chose. Dans la deuxième nouvelle, cela prend une dimension presque tragique. Comme si c'était le destin qui commençait à se dérouler pour lui. L'accès aux mots pour dire l'intimité, ça fait souffrir, ça empêche de dormir, de vivre.
Votre langue saisit le réel à vif. Comment travaillez-vous cette écriture ?
Il faut absolument qu'il y ait la présence la plus aiguë, la plus précise possible du réel, de l'insupportable, inépuisable et enchanteur réel avec toutes ses contradictions, ses abîmes, ses vertiges. Ça passe donc beaucoup par le registre des sensations et jamais par celui du psychologique. Je traduis des gestes, des attitudes, des sensations et des silences. Je viens de relire le roman de Charles Ferdinand Ramuz, Derborence. Ce livre est une leçon de silence, et une leçon d'écriture, qui m'a touchée. On est dans un univers paysan d'un bout à l'autre, directement saisi, où il n'y a pas d'enrobage. J'aime l'expression latine « in medias res ». Je crois que je ne peux pas emprunter de détours, de circonvolutions. Donc je gratte, je coupe, je dévisse, je rabote.
À travers vos différents livres, vous donnez à lire des milieux, des paysages, des personnages dans leur ensemble en adoptant différents points de vue. Qu'est-ce que cette multiplicité révèle ?
Je tiens énormément à la question des flux de conscience et de l'éventail des points de vue. C'est un travail qui me passionne. Vous imaginez bien que, quand on reste à la troisième personne, on rentre dans un régime d'ambiguïté qui est absolument terrible avec les « ils » et les « elles ». Il faut peser chaque pronom. Parfois, je laisse volontairement planer l'ambiguïté. Mais le plus souvent, il est hors de question que ce soit flottant. C'est le travail de la langue et c'est le pays que j'habite.
Vous explorez de façon très précise un univers qui vous est familier, celui de la paysannerie et ses transformations...
Le monde paysan est une sorte de basse continue dans mes livres. C'est un univers qui m'est très familier, dont j'ai une conscience aiguë même si cette vision est partielle et parcellaire. L'agriculture et la paysannerie ont énormément évolué en quarante ans. Cette mutation peut par moments ressembler à une mort. Ces sujets sont cuisants. Mes livres montrent ce qui est passé sur ces vies-là. Il y a du désarroi chez les paysans, qui les conduit parfois au suicide. Je ne peux donc pas écrire ce que j'écris et ne pas laisser entrer dans mes textes ces ondes sismiques là.
Ce texte est accompagné de peintures de Denis Laget. Quel lien entretenez-vous avec l'image ?
C'est une chance extraordinaire de travailler avec des artistes, de croiser les chemins artistiques. J'ai eu très fréquemment l'occasion ces six dernières années d'être sollicitée par des photographes. En regardant une photographie, je sens si mon flux textuel peut y trouver place. C'est ce que j'appelle une entrée en matière, car il s'agit bien d'aller dans la matière. C'est l'inverse de mon travail d'écriture, où les images préexistent. Pour ce texte, les éditions du Chemin de fer m'ont proposé de choisir entre différents plasticiens. Il se trouve que je connaissais déjà le travail de Denis Laget, que j'aime énormément. J'étais très contente qu'il accepte et d'autant plus lorsque j'ai vu ce qu'il avait peint pour ce livre. Le texte a beaucoup de chance d'être mis en écho avec cette peinture très incarnée, très charnelle.
Vie de Gilles
Les éditions du chemin de fer
Tirage: 6 000 ex.
Prix: 14 € ; 64 p.
ISBN: 9782490356515