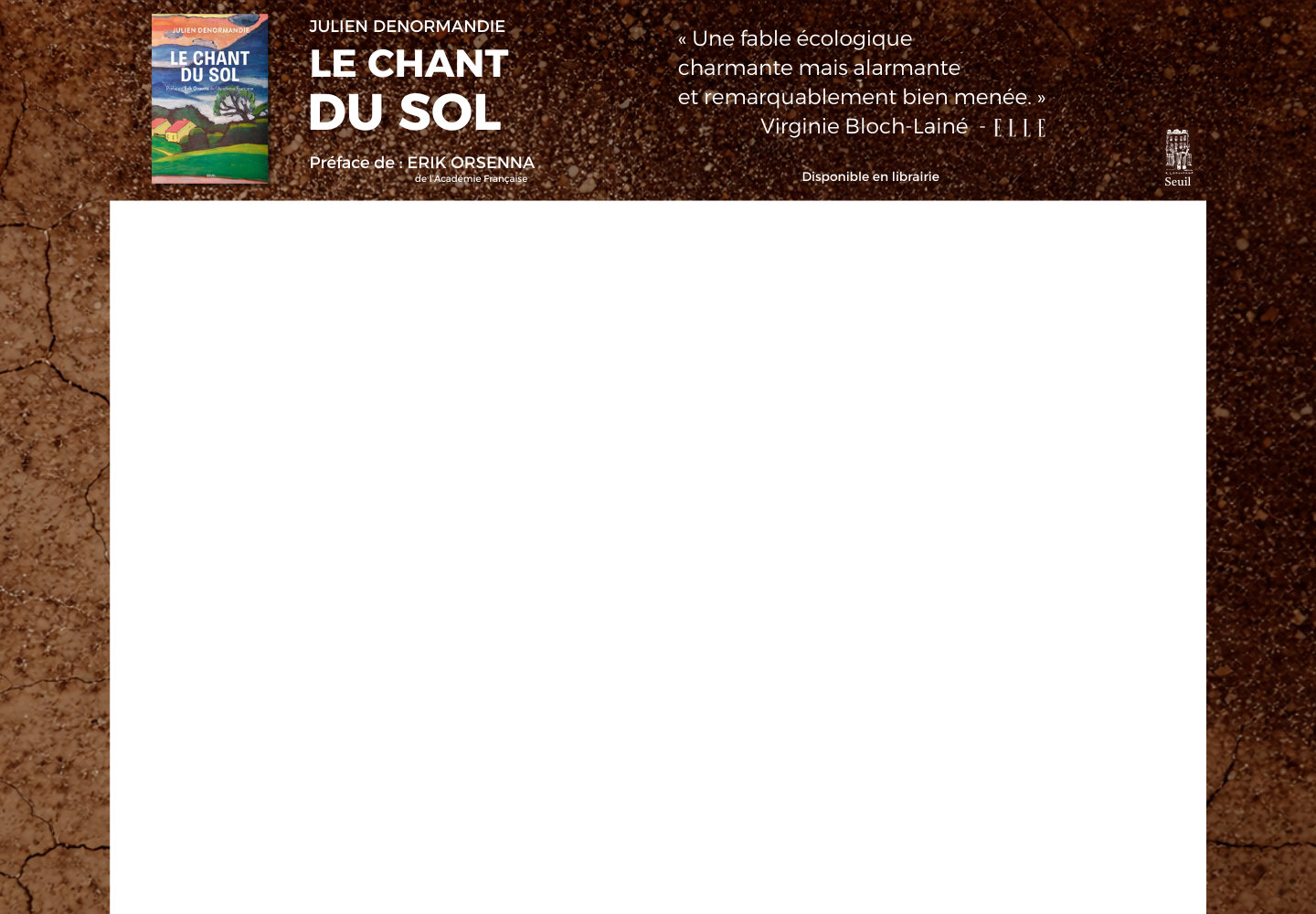Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Si l'on n'est pas soi-même pied-noir - communauté à la fois soudée et si diverse -, il est difficile de se rendre compte de la réalité de cette diaspora, qui a inspiré tant de livres, souvent graves et beaux, à ses écrivains, comme Jean-Noël Pancrazi. La plaie toujours ouverte des départs, avant ou juste après 1962, la nostalgie d'un pays passionnément aimé, les regrets de ce qu'on y a laissé, perdu. Et, par-dessus tout, ce sentiment de déracinement, ce taedium vitae qui ne passe jamais, augmenté par la rancoeur d'avoir été floué, trahi par la patrie.
Cinquante ans après les accords d'Evian, anniversaire dont la célébration, de ce côté-ci ou de l'autre de la Méditerranée, va être fort intéressante à observer, la "pied-noiritude" s'estompe peut-être chez les jeunes, nés ici, mais elle demeure puissante chez les aînés, ceux de "là-bas".
Comme celle d'autres écrivains, Louis Gardel par exemple, son enfance algérienne a inspiré, nourri l'oeuvre de Jean-Noël Pancrazi. Après quelques infidélités géographiques, notamment du côté de la République dominicaine, il a désiré revenir aujourd'hui à ses fondamentaux, peut-être parce qu'il a frôlé la mort l'année dernière. Retrouver ses racines les plus profondes - l'Algérie, donc, mais aussi la Corse, terre de ses aïeux où mourut son père -, c'est aussi une façon de se ressourcer, de renaître. D'où cette Montagne, récit sobre et bref, intense et, peut-être, de tous les livres de l'auteur, le plus personnel. Porté par un style haché, haletant au sens propre, presque d'asthmatique.
Tout commence à l'âge de 8 ans, dans la région de Sétif, où le père du narrateur était simple cadre dans une minoterie. Tous les pieds-noirs n'étaient pas de riches "exploiteurs" qui s'engraissaient à la sueur des indigènes... Le jeune garçon, pusillanime, hésite à rejoindre ses "petits camarades » dans la camionnette de la minoterie, conduite par le frère du chauffeur habituel, qui les emmène en balade chercher des scarabées dans la montagne, en principe défendue en raison des "événements". Finalement, il préfère rester tout seul. Hasard ou prédestination, il a eu mille fois raison : les "petits camarades » ne sont jamais revenus, dont on a retrouvé les corps égorgés. Le chauffeur, lui, a disparu. Malgré les rafles, les représailles à l'aveugle, personne ne connaîtra jamais ce qui s'est passé, ni le coupable. Et le narrateur, lui, devra vivre toute sa vie avec le syndrome de culpabilité du survivant.
Après 1962, le garçon et sa mère rentreront en métropole ; le père, lui, tentant de demeurer encore afin de leur envoyer de l'argent - jusqu'à ce qu'il soit menacé puis expulsé. La famille se fixera tant bien que mal près de Perpignan, mais sans se sentir chez elle nulle part. Sauf peut-être en Corse. Là où tout finira et où le narrateur revient, comme en pèlerinage. En Algérie, en revanche, il n'est jamais retourné.