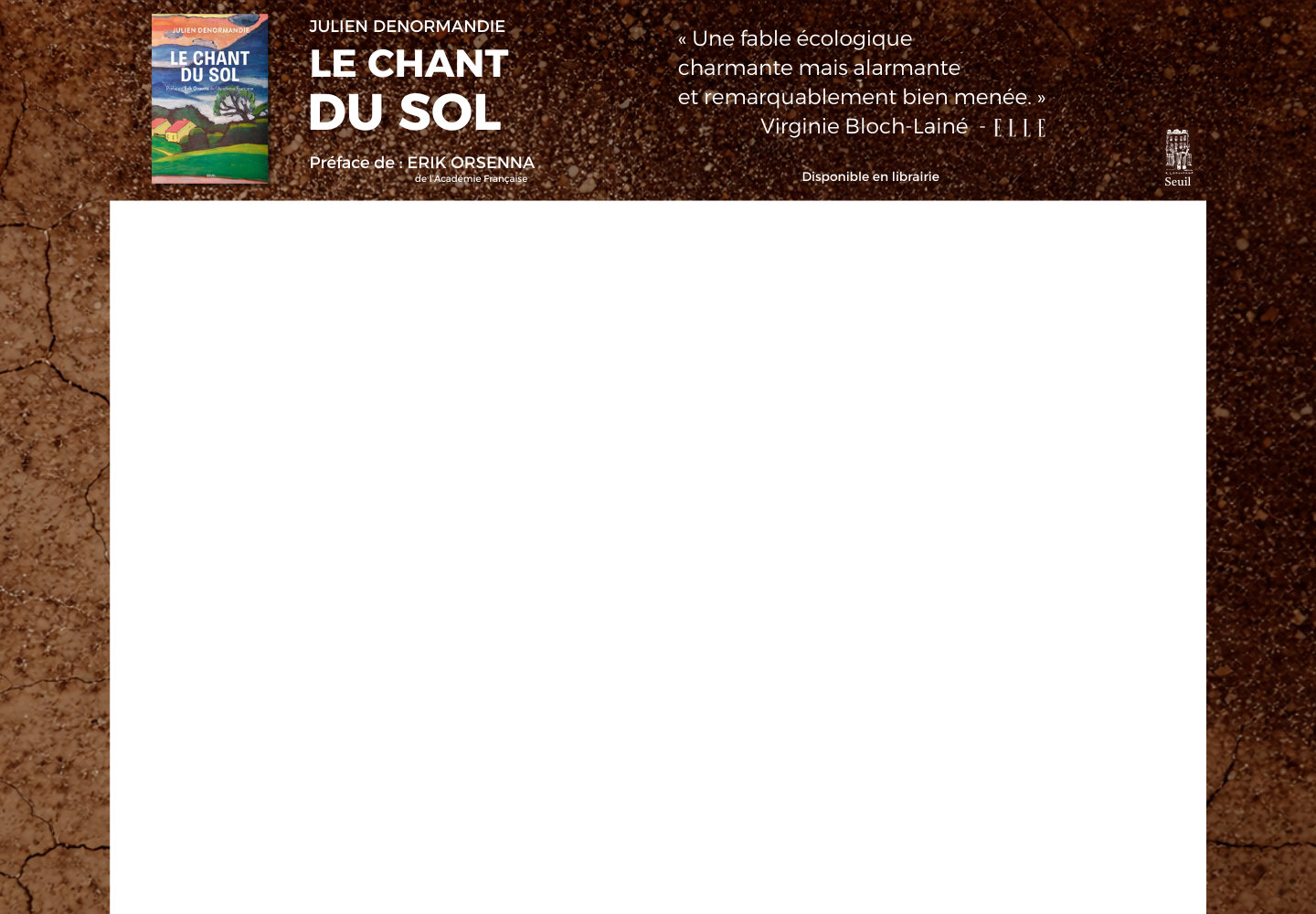Ceux qui ont aimé le film de Maria Schrader, Stefan Zweig - Adieu l’Europe, avec un Josef Hader impeccable dans le rôle de l’écrivain, savoureront le bel ouvrage de George Prochnik. Ceux qui n’ont pas vu le film iront le voir après sa lecture. A la manière dont Zweig travaillait sur ses biographies, en ne retenant que les moments où tout bascule, George Prochnik s’attache aux dernières années, celles de cet impossible exil. Le thème n’est pas anodin chez cet essayiste américain. Sa famille, elle aussi, a émigré aux Etats-Unis après l’accession d’Hitler au pouvoir. Il entrecoupe son enquête sur Zweig de quelques réflexions sur sa propre histoire, ce qui rend cet ouvrage passionnant. D’autant que ce thème du départ, le plus souvent définitif, est on ne peut plus d’actualité avec ces réfugiés qui fuient des Etats meurtriers.
Ce qui trouble, c’est la notion d’impossibilité dans cet exil. On en saisit la raison à mesure que George Prochnik avance dans son investigation. Il se rend en Angleterre, aux Etats-Unis - pays que Zweig n’a jamais aimé - ou au Brésil, "terre d’avenir", dira-t-il, où pourtant il se donne la mort à 60 ans avec sa deuxième femme, Lotte, qui n’avait elle que 33 ans. A mesure qu’il voyait le monde se refuser à lui, Zweig avait décidé de le quitter.
George Prochnik nous fait comprendre la psychologie de Zweig, sa méfiance envers la politique et l’engagement, sa lenteur à condamner les nazis - ce que lui reprochera Hannah Arendt -, son utopie européenne humaniste, son pressentiment de la catastrophe. On retrouve cela dans le dernier volume de la correspondance avec Romain Rolland qui couvre la période 1928-1940, c’est-à-dire quasiment de la parution de La confusion des sentiments jusqu’à l’écriture de son Balzac, deux ans avant son suicide à Petrópolis. Entre les deux écrivains, l’amitié s’effiloche comme un tissu que l’on aurait frotté trop vivement. L’auteur de Jean-Christophe est militant, il soutient Staline, il croit dans le communisme pour améliorer le monde. Zweig ne voit que des dictatures, un mépris souverain de la culture et il écrit à son ami en 1936 qu’il faudrait créer "un fanatisme de l’antifanatisme".
Depuis 1934, depuis qu’on a brûlé ses livres, depuis qu’il est exclu parce que Juif, Zweig cherche un endroit où se poser. Il ne le trouve pas. Alors il termine Le monde d’hier, comme "une bouteille à la mer jetée dans la mer de l’avenir". Mais l’homme est usé. George Prochnik, qui a rencontré les derniers témoins de cette tragédie, montre tout ce qui manque à un exilé. Mais il y a une chose qu’un écrivain peut très rarement quitter : c’est sa langue maternelle. Cette langue dans laquelle il a pensé, il a écrit et qui fut utilisée pour véhiculer les pires atrocités. Zweig ne s’en remettra pas. En 1941, à New York, devant un parterre d’écrivains célèbres réunis par le Pen Club, il déclare : "Il est de mon devoir de demander publiquement pardon à chacun de vous pour tout ce qui est infligé à vos peuples au nom de l’esprit allemand."L. L.