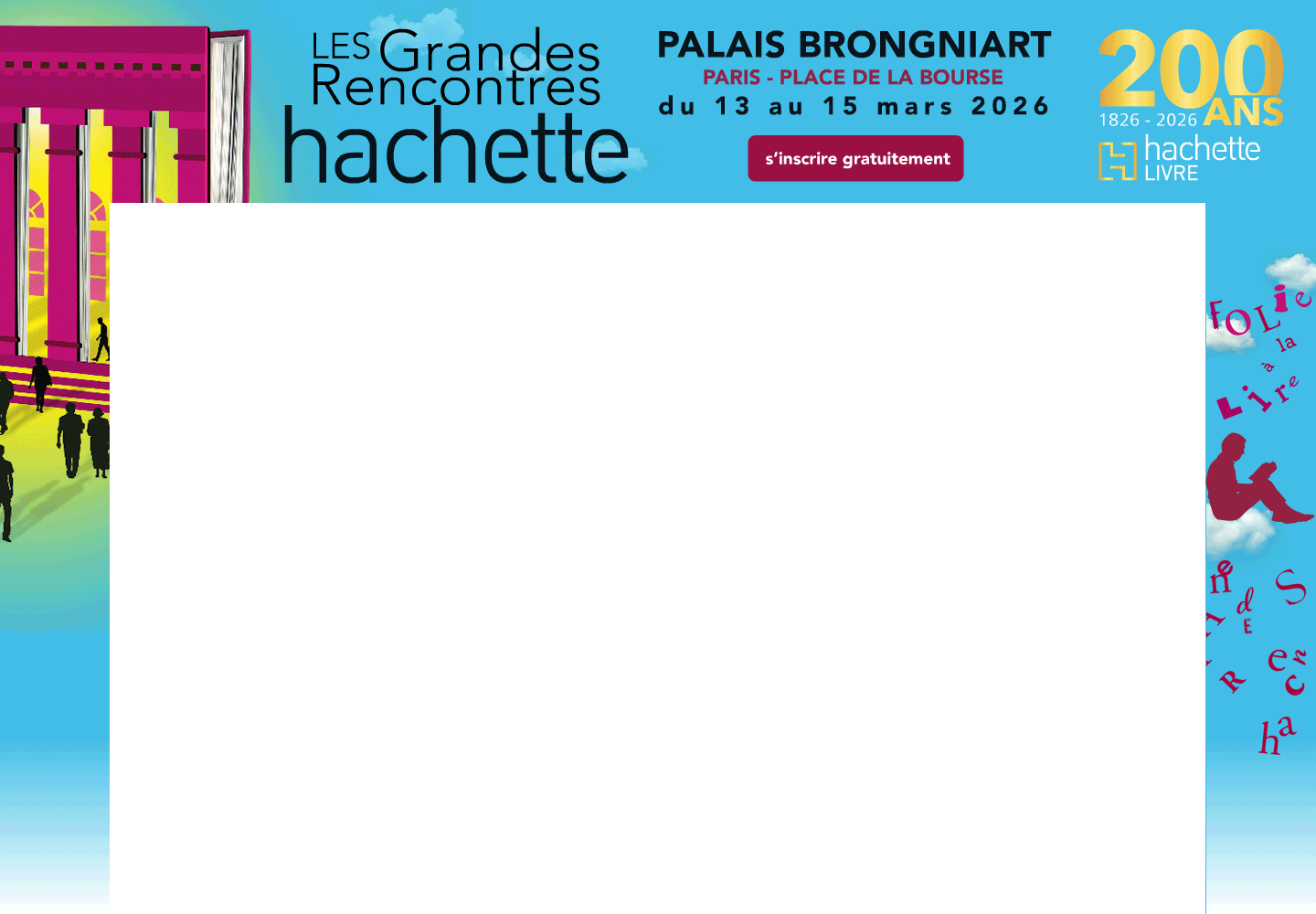S’il fallait décerner (après tout, pourquoi pas ?) un prix du meilleur incipit, pour l’année 2017, "C’était autrefois", celui du nouveau livre de Michel Braudeau, Place des Vosges, devrait en toute justice l’obtenir.
Autrefois, donc. C’est-à-dire, dans l’ordre du souvenir, pas plus tard qu’hier. En ce temps-là, l’amour pouvait être libre, autant que - fût-ce au prix de leur solitude - les enfants de la guerre, la révolution restait un horizon indépassable, les fleurs avaient du pouvoir, l’avenir promettait de durer longtemps. Plus tard, quand tout serait consumé, on appela cela les années 1970 (qui, comme chacun sait, naquirent un soir de mai à Paris sur la rive gauche de la Seine). La belle affaire.
C’est dans les marges de cette histoire qui se voulut grande et parvint tout de même à se transformer en mythologie portative pour tous ses endeuillés que baguenaude l’auteur de Naissance d’une passion (Seuil, 1985) dans ce très réussi, mélancolique et vif à la fois, Place des Vosges. C’est là, dans un immeuble de la place, que s’installe le jeune (il a 25 ans) Braudeau, un jour de 1971. Il y restera, passant d’un appartement et d’un désir l’autre, dix ans. Le temps de se trouver une identité moins floue, ou d’apprendre au moins à composer avec elle. Entre-temps et au fil des pages donc, que du beau et du demi-monde (dans le désordre le plus fécond qui soit, celui des souvenirs). Voici Pierre Goldman rencontré au lycée et jamais tout à fait perdu de vue. Voilà, tout en bienveillance et en vive intelligence, Jean Cayrol, le premier éditeur de Braudeau. Dans le bureau d’en face, aux éditions du Seuil, le redoutable François Wahl. Severo Sarduy passe par là. On attend Jean-Marc Roberts qui sera l’ami d’une vie. De retour dans Paris, il faut composer avec l’envahissante et paranoïaque présence d’un Jean-Edern Hallier au charme dévoyé. On se lie d’amitié (c’est peut-être le plus beau portrait du livre) avec Thomas Harlan, cinéaste allemand, ami de toutes les marges et fils tourmenté du réalisateur nazi Veit Harlan. On y aime de longues, tristes et souvent riches femmes. Bien entendu - c’est la loi du genre -, c’est une sonnerie aux morts. Mais cette musique-là n’a rien de militaire : c’est celle d’une infinie douceur de voix éteintes au fond du jardin. Olivier Mony