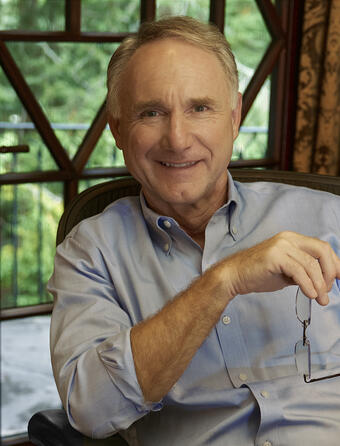Dans l’une de ses mémorables méditations sur les mythes, Roberto Calasso expliquait que Cadmos le Phénicien avait semé l’alphabet afin qu’à défaut de vivre avec les dieux, les hommes sachent en désigner les reflets et s’attachent à en former les simulacres. Le don des langues est un don du ciel ; et les mythologies en sont l’accomplissement le plus achevé. De sorte que pour notre si cher et savant ami, dont la disparition nous attriste profondément et crée un terrible vide dans la communauté des éditeurs et intellectuels européens, il y avait quelque chose d’indissociable entre la civilisation de l’écrit et de l’imprimé et celle du sacré, du divin. Sa crainte, bien entendu, était que le déclin de l’une aille de pair avec l’effacement de l’autre, au profit d’une société unidimensionnelle, n’ayant d’autre horizon qu’elle-même, atone et inconsistante, techniciste et consommatrice.
En mille lieux de nos héritages culturels et linguistiques, sans primauté accordée à ce patrimoine littéraire occidental qu’il avait parcouru de part en part, Roberto Calasso était allé chercher ces marques de l’invisible qui ont formé l’esprit des hommes et de leurs sociétés. Mais l’érudit qu’il était ne cachait pas son inquiétude à l’égard des temps présents, de cet "innommable contemporain" fruit d’une très longue histoire de sécularisation qui avait vu l’homme moderne peu à peu se conformer à ce que la société, et uniquement la société, attendait de lui. Dans ces circonstances, il en était lui-même venu à se demander s’il ne fallait pas "pour la pensée une période de dissimulation, de vie clandestine et camouflée, d’où s’apprêter à resurgir, [le temps] de reconnaître les puissances dont on parle, avant même de les nommer et de hasarder à théoriser le monde". Il fallait semer à nouveau l’alphabet.
Esprit de finesse
Roberto Calasso s’est éteint à Milan des suites d’une longue maladie. Je garde, parmi tant d’autres souvenirs, l’image de l’éditeur venu à Paris il y a quelques années pour y réfléchir avec ses confrères européens à l’avenir du livre, à une époque où l’édition numérique inquiétait encore. Avec l’esprit de finesse qui le caractérisait, il nous avait invités à garder toujours à l’esprit cette distinction entre forme et format, dont la confusion était entretenue à dessein par les nouveaux acteurs internationaux de la distribution, toujours prêts à gommer les marques éditoriales "locales". Notre tâche d’éditeur était de maintenir hautement la primauté de la forme intellectuelle sur le format technique, voué à la normalisation de la production. Nous étions les garants de la diversité des œuvres de l’esprit, laquelle supposait un certain ordonnancement des productions, un dialogue d’œuvre à œuvre agencée dans nos catalogues, nos collections. L’informe était toujours, pour lui, le visage de la culture éteinte, dominée par la tyrannie de l’actuel – entre conformité et uniformité.
On comprend dès lors à quel point son itinéraire exemplaire d’éditeur n’était que l’autre facette de son engagement d’intellectuel. C’est ce qui nous autorisait, nous autres Français, à lier son action au souvenir d’André Malraux, qui n’avait jamais cessé lui-même d’être éditeur lorsqu’il était écrivain – et réciproquement. Au sein d’Adelphi, la maison à la création de laquelle Roberto Calasso avait participé avec Roberto Balzen et Luciano Foà en 1962 et qu’il avait dirigé puis présidé, il avait composé un catalogue qui devint l’un des plus importants et prestigieux de l’édition italienne et internationale. La diffusion de la littérature d’expression française la plus exigeante en Italie lui doit beaucoup, l’indépendante Adelphi ayant accueilli à ses catalogues des œuvres d’Alfred Jarry, Paul Valéry, René Daumal, René Guénon, Milan Kundera, Emmanuel Carrère et bien sûr, du plus romancier d’entre tous comme disait Gide, de Simenon. Mais l’œuvre éditoriale d’Adelphi est immense, tant dans le domaine italien que germanique, en littérature comme en philosophie, en sciences ou dans ce domaine des textes orientaux que Roberto Calasso connaissait si bien…
… Une amplitude de catalogue qui te ressemblait tant, très cher Roberto, toi l’immense lecteur qui t’es toujours tenu au plus près des textes que tu choisissais de publier, au point d’avoir pris l’habitude de rédiger les "quatrièmes de couverture" des quelque mille ouvrages de tes collections ! Toi qui avais aussi tant à nous apprendre sur notre propre culture, sur notre littérature et ses maîtres. La France avait eu besoin de toi, le savant italien à l’esprit si subtil, pour réapprendre à lire Flaubert ou Lautréamont, pour mesurer la déferlante Baudelaire sur nos consciences, mais aussi pour réhabiliter l’œuvre critique de Sainte-Beuve !
Invitations à voyager
Des Védas indiens à la mythologie grecque, de la Venise de Tiepolo au Paris des impressionnistes et à la Prague de Kafka, tes livres ont toujours été des invitations à voyager dans les grands héritages spirituels de l’humanité, antiques ou modernes, autour d’un même trésor. J’ai été très honoré d’en avoir été l’éditeur français et d’avoir pu bénéficier de ta confiance, jusqu’à ce dernier livre que tu nous as proposé, dûment intitulé Le Livre de tous les livres, longue immersion interprétative dans l’Ancien Testament, en cours de traduction par Jean-Paul Manganaro.
Tu nous disais, cher Roberto, qu’une vie sans histoire – et donc sans littérature ni mythologie – ne méritait pas d’être vécue. L’incarnation était pour toi un roman, une épopée. Aussi servir la cause des livres dans la dimension la plus artisanale et concrète de nos métiers, sans distinguer par principe entre ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui, fut pour toi une manière de sacerdoce, une façon d’entretenir le feu sacré transmis par nos pairs.
"Quand la vie s’allumait, dans le désir, dans la peine ou même dans la réflexion, les héros homériques savaient qu’un dieu agissait en eux." Quelle belle et durable leçon as-tu donnée là à nos esprits cartésiens et voltairiens, indifférents à cet appel ! Avec la passion du conteur, l’enthousiasme du meilleur professeur, le goût sûr et l’application de l’éditeur, tu as su exprimer et accomplir cette révélation de ce qui en nous, "à notre surface" même comme le disait Hofmannsthal, nous dépasse.
Ton exemple, comme ton souvenir amical, nous oblige pour les temps à venir.
Antoine Gallimard