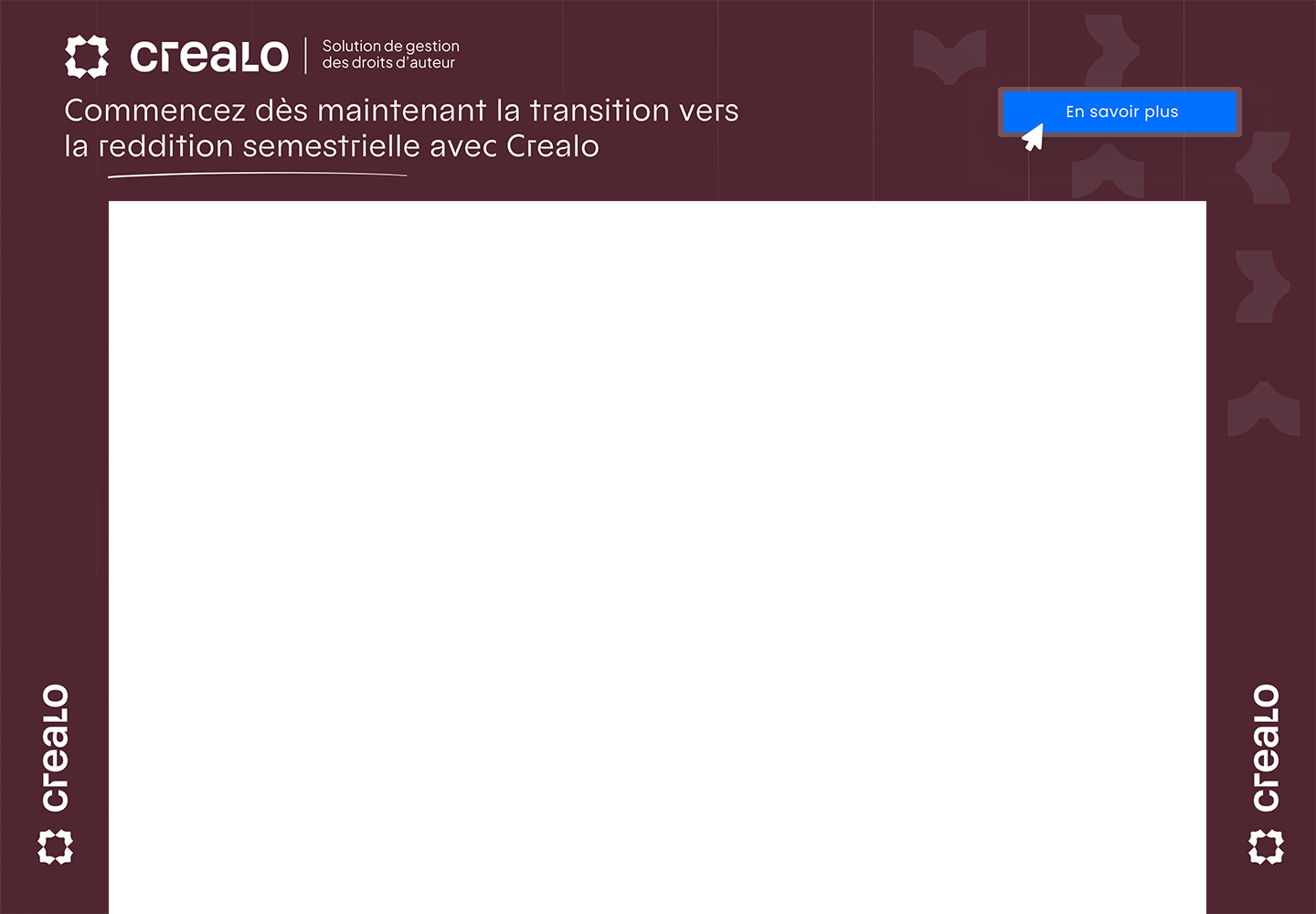Livres Hebdo : Vous revenez ici aux sources, à Pointe-Noire, dans votre Congo-Brazzaville natal, et à cette veine picaresque qui a caractérisé votre entrée en littérature...
Alain Mabanckou : Il était essentiel pour moi, après des livres qui étaient plus dans une sorte d'introspection et proposaient un regard intérieur comme Lumières de Pointe-Noire (Seuil, 2013) ou Les cigognes sont immortelles (même éditeur, 2018), de revenir à l'esprit d'enfance, au bonheur de conter, d'exagérer, de questionner ce qui est au-delà de la réalité. Souvent quand on parle de merveilleux en littérature, on pense aux Latino-américains, à Pedro Páramo de Juan Rulfo, aux romans de Gabriel García Márquez entre autres... Mais nous avons aussi ce merveilleux en Afrique, et en l'espèce, au Congo-Brazzaville. Ce réalisme merveilleux traduit la peur de ce qui n'existe plus. D'ailleurs nous n'aimons pas mentionner ce qui n'existe plus, nous ne parlons que de ce qui est palpable. Dans Le commerce des Allongés, j'ai recherché le juste milieu entre ce qui a disparu et ce qui demeure encore. Ce roman peut se lire comme un inventaire de toutes les croyances qu'on m'a inculquées et qui me hantent depuis mon enfance, en ce temps où il n'y avait pas de frontières entre la vie et la mort.
Alain Mabanckou (born 24 February 1966) is a novelist, journalist, poet, and academic, a French citizen born in the Republic of the Congo, he is currently a Professor of Literature at UCLA. He is best known for his novels and non-fiction writing depicting the experience of contemporary Africa and the African diaspora in France.[1] He is among the best known and most successful writers in the French language[2] and one of the best known African writers in France. In some circles in Paris he is known as the Samuel Beckett of Africa.[3] He is also controversial,[4] and criticized by some African and diaspora writers for stating Africans bear responsibility for their own misfortune.[5] He has argued against the idea that African and Caribbean writers should focus on their local realities in order to serve and express their communities. He further contends that categories such as nation, race, and territory fall short of encapsulating reality and urges writers to create works that deal with issues beyond these subjects.[6]- Photo © SÉBASTIEN MICKE/SEUILPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
N'est-ce pas la rationalité occidentale qui qualifie de « magique » ce qui en vérité fait partie de la réalité dans tant d'autres cultures, où le merveilleux fait partie du réel ?
Le côté magique au Congo est en effet vu comme quelque chose de tout à fait ordinaire : il nous enchante et nous effraie à la fois. Nous rejetons l'idée de la disparition. Pour nous, il faudra toujours une explication plausible quant à la mort. Mon personnage, Liwa, est jeune, il estime qu'il ne méritait pas de mourir, et il doit par conséquent revenir dans le monde des vivants pour démêler cette situation au plus vite.
Justement à propos de ce défunt personnage qui revient parmi les vivants pour nous raconter son histoire... Qu'est-ce qui vous a inspiré cette prosopopée ?
L'idée m'était venue quand j'étais retourné dans mon pays natal entre 2007 et 2008. Dans la ville de Pointe-Noire, tout le monde ne parlait que de cet homme récemment décédé mais qui, pourtant, déambulait encore dans les rues des quartiers populaires. On rapportait qu'il n'avait pas réglé un certain nombre de choses qui l'empêchaient de reposer en paix. Le soir, il venait voir ses proches. Dans la cuisine, les ustensiles se mettaient à bouger. Les gens vivaient dans la terreur... J'ai commencé à écrire une douzaine de pages d'une histoire simplement intitulée L'histoire du mort qui ne voulait pas aller au cimetière. Il s'agissait d'une sorte de synopsis écrit, comme dans Le commerce des Allongés, à la deuxième personne du singulier. Cela permettait selon moi de se détacher de l'histoire, d'accorder dans le même temps une certaine proximité, de créer une ambiguïté entre mon narrateur et le lecteur qui est juste derrière lui et observe la succession des événements. Pour le coup, les auteurs italiens comme Italo Calvino ou Dino Buzzati, dans leur manière de « gérer » le merveilleux ou l'absurde, m'ont beaucoup inspiré lorsqu'il s'agissait de répondre à la grande question qui traverse tout le livre : « Peut-on vivre heureux après la mort ? »
L'expérience de lecture, en tout cas, est joyeuse. Comment avez-vous imaginé ces scènes où tout marche à rebours ?
J'avais à cœur d'illustrer l'idée d'un monde à l'envers. La forêt congolaise est peuplée d'esprits, bons comme mauvais. Pour déjouer les esprits maléfiques, il ne faut pas aller droit devant soi, mais à reculons. Toujours faire le contraire. Si vous souhaitez rentrer chez vous, prenez un chemin opposé à celui qui mène vers votre maison... Vivre dans le sens des contraires, tel est, sans jeu de mots, le calvaire de ceux qui viennent de mourir jusqu'au jour où ils sauront se débrouiller. Il suffit, pour cela, de leur administrer deux ou trois baffes pour les remettre dans le bon sens...
Si les « allongés », revenus d'entre les morts, sont très présents, les êtres réellement debout dans ce roman sont les femmes.
C'est sans doute mon roman le plus féminin. Les femmes ne sont néanmoins pas absentes de mes précédents livres. Dans Verre Cassé, qui se déroule dans un bar, perçu comme un univers plutôt masculin, la cliente Robinette est la femme qui domine les hommes. Ma mère Pauline aussi est une figure omniprésente dans mes fictions et ma poésie. Dans Le commerce des Allongés, cette fois, c'est la grand-mère qui est à l'honneur, et derrière l'aïeule protectrice et nourricière, c'est le portrait de toutes ces femmes qui travaillent dans le grand marché de Pointe-Noire, qui valorisent la petite économie à travers la tontine, un système de prêts d'argent très répandu entre les pauvres par le biais des cotisations collectives afin de régler les problèmes de chaque membre du groupe... Ces femmes, ici, représentent l'altruisme, alors que les hommes, lorsqu'ils ont un peu de pouvoir, ont tendance à en abuser et à installer de l'égoïsme. Le portrait que je fais de la grand-mère de mon personnage principal est une façon d'illustrer combien les grands-mères soutiennent souvent l'équilibre de la famille, surtout lorsque le père a quitté la mère.
Vous vivez aujourd'hui aux États-Unis où vous enseignez la littérature. Comment cette manière de second exil (après la France), dans un pays anglophone, affecte-t-elle votre façon d'écrire ?
La langue française, hors de la France, résonne avec une certaine sobriété majestueuse. Cette simplicité est ce que vous devez viser en tant qu'écrivain. Être sobre en littérature, en particulier dans le roman, c'est faire oublier le labeur, c'est effacer les coutures. L'œuvre devient un plat qu'on déguste sans se douter de toutes les étapes par lesquelles est passé le cuisinier. Loin de Paris, dans un territoire où on ne parle pas le français, la langue se pratique dans votre imaginaire, elle n'est pas corrompue par les« bassesses » quotidiennes. J'ai déployé une langue que je souhaitais débarrassée de lourds habits portés par ceux-là qui ne mesurent pas la puissance et l'efficacité qu'on pourrait insuffler au sujet, au verbe et au complément. Les ingrédients de la phrase la plus simple sont soutenus par les seules images...Dans Le commerce des Allongés je me suis aussi laissé aller à plus d'émotion. Je pense ici au personnage surnommé « La Femme Corbeau ». Cette femme incarne la revanche de la maternité. Elle prend le parti de tous les enfants abusés. C'est elle qui dit au personnage principal qu'il ne faut retourner chez les vivants que dans le dessein d'accomplir quelque chose de noble. Revenir dans le monde des vivants, non pour se venger égoïstement mais pour réaliser quelque chose qui ferait avancer l'humanité.