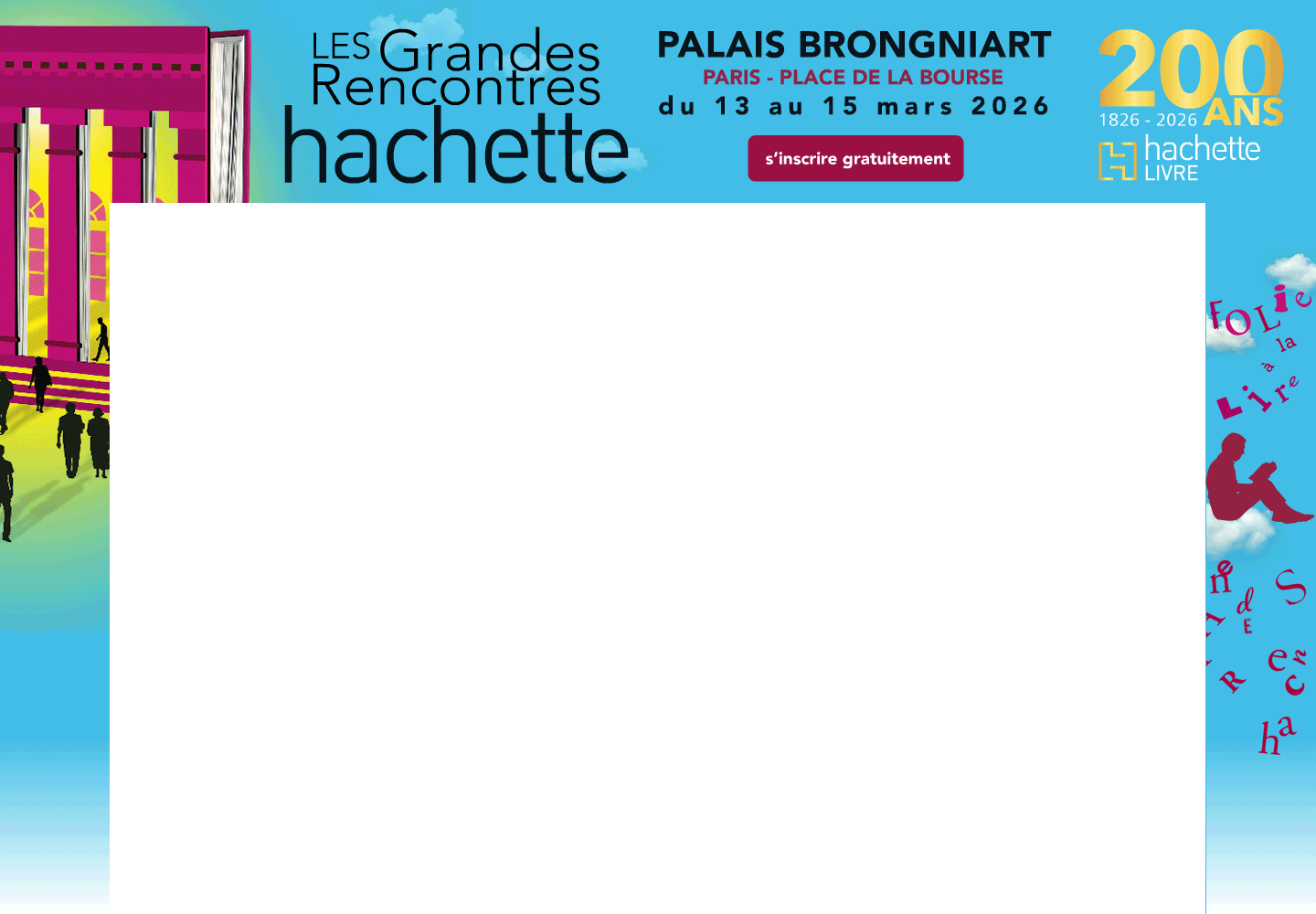Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
De ses dandys, dans La Gazette du bon ton, Harper’s Bazaar ou Vanity Fair, Francis Carco disait qu’ils "avaient des têtes d’oiseaux et des bouches de batraciens". Charles Martin (1884-1934) était à l’élégance pour le dessin ce que furent en même temps Poiret pour la mode ou Satie (qu’il a aussi illustré) pour la musique : une certaine idée de la grâce mâtinée d’insolence. Et il est troublant de constater que, pour Martin au moins, les teintes édéniques de son inspiration se nourrissent aussi du chaos et de la mort, d’années passées dans la boue des tranchées. Loin de s’adonner, dans la représentation qu’il en fit, à la vulgarité cocardière alors en vogue, il se tient sur la ligne de front de son inspiration, et ses soldats (mais aussi ses aéroplanes, ses landes dévastées, ses nuages filants…) n’ont rien à envier au délié des élégantes des salons parisiens. Ce pourrait être hors de propos ; c’est au contraire profondément troublant, comme l’affirmation du triomphe ultime de la beauté.
Dans Charles Martin, féerie pour une grande guerre, les éditions Michel Lagarde et l’historien de l’art Emmanuel Pollaud-Dulian, à qui l’on doit déjà la récente monographie autour du Salon de l’Araignée (1) (auquel Martin collabora), entreprennent cette fois-ci d’exhumer les dessins que Charles Martin réalisa pour les deux livres consacrés à "sa" guerre : Sous les pots de fleurs ("pot de fleurs" étant l’expression argotique désignant le casque du poilu), préfacé par Pierre Mac Orlan, et le roman du trop oublié Marcel Astruc, Mon cheval, mes amis et mon amie. Dans le flot de publications que suscite l’inflation commémorative des temps, celle-ci est l’une des plus modestes, mais pas la moins essentielle. Elle nous apprend que l’enfer est parfois aussi un paradis perdu. O. M.
(1) Voir LH 973, du 8.11.2013, p. 57.